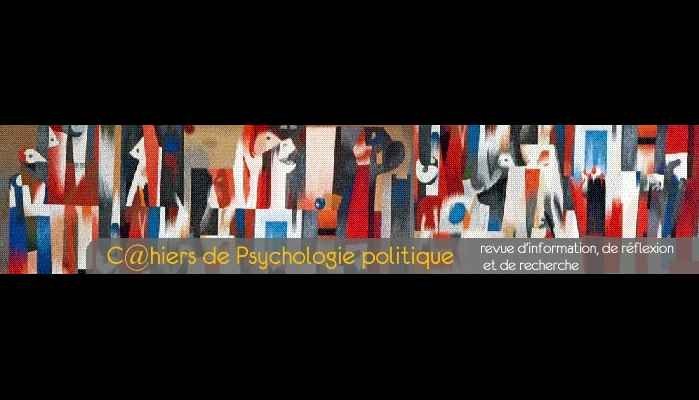Les normes carnavalesques des romans de l'extrême contemporain
Axel Richard EBA est Enseignant-chercheur au Département de Lettres Modernes à l’Université Alassane OUATTARA de Bouaké. Spécialiste de Littérature et Civilisation françaises, ses axes de recherche portent sur le Kitsch, Marcel Proust, la Société de consommation, les Industries culturelles et l’Intelligence artificielle dans le Roman. Il a publié un article : De la psychologie du Kitsch en Côte d’Ivoire : pour une approche socio-dynamique de la Culture ivoirienne et L’intelligence artificielle dans Klara et le Soleil de Kazuo Ishiguro. Il est Membre de l’Association des Rencontres internationales proustiennes d’Illiers-Combray (ARIPIC).
Introduction
Depuis les travaux de Michel Chaillou et de ses collaborateurs, il semble désormais établi qu’il existe une littérature de « l’extrême contemporain ». Ils ont utilisé l’expression pour désigner les productions littéraires entamées depuis les années 1980. Cependant, il reste évident à l’esprit de Michel Chaillou que « les limites de l’extrême contemporain se déplacent d’année en année » (Chaillou, 1987, 33). Il règne encore une opacité autour du concept vu que la classification des œuvres littéraires peut s’effectuer de manière chronologique ou selon les redondances esthétiques, en fonction des mouvements idéologiques, etc. Pour ce qui nous concerne en l’état actuel de la recherche, les bornes temporelles de l’extrême contemporain vont de 1980 à 2024. Au sein du chronotope français, les romans édités dans ce canevas sont traversés par des critères identifiables à trois niveaux essentiels avec des valeurs spécifiques de démarcation. Sous la plume des écrivains comme Leslie Kaplan, Jean-Paul Goux, Marguerite Duras, Tassadit Imache, Franck Magloire, Aurélie Filippetti, François Bon, Pierre Senges, Guy Tournaye, François Taillandier, Camille Laurens, Judith Perrignon, Guillaume Muso, Aurélien Bellanger, Nathan Devers et bien d’autres, le roman remodèle les formes esthétiques, promulgue de nouvelles valeurs éthiques et affiche une mesure esthésiométrique.
Les romans de l’extrême contemporain ont un plan esthétique axé sur l’héritage des traditions romanesques et le culte de l’innovation poussé à son paroxysme. C’est pourquoi à ce niveau, les critiques littéraires soulignent les retours du sujet et du récit dans la co-construction de la fiction ; laquelle porte à son aise des enjeux éthiques tels que l’accueil des étrangers, le souci de la jeunesse hypermoderne, la place de la femme autonome, la dignité humaine face à la mort, les relations interculturelles. En cela se manifeste la dimension esthésiométrique qui sous-tend l’idée d’une sensibilité auctoriale axée sur des questions portées par l’actualité médiatique ou par l’activité intimiste. Ainsi, l’expression de soi et des autres caractérise la création romanesque de la période 80-24. L’observation des tendances de l’extrême contemporain révèle, en effet, que la plupart d’entre elles « s’inscrivent dans les quêtes innovatrices » (Marzouki, 2019, 113), elles-mêmes prenant source dans le foyer carnavalesque de Mikhaïl Bakhtine. Ce critique russe est l’architecte d’une méthode particulière d’analyse du roman. Il développe dans le cadre de ses travaux de nombreux concepts pour nommer les situations inhabituelles dans les contes de Rabelais et les romans de Dostoïevski. Il est le concepteur de la carnavalisation qui matérialise le renversement du texte romanesque par l’insertion de la culture populaire dans le système fictif de narration d’un monde imaginaire calqué sur le réel populaire. Du Moyen-âge à l’extrême contemporain, le roman évolue en fondant son esthétique sur les dynamiques sociales pour mieux les éclairer, les dénoncer ou s’en éloigner. Bakhtine formalise le renversement en détectant dans les romans rabelaisiens et dostoïevskiens des tendances marginales incluses dans le texte (Eba et Tié Bi, 2022, 231).
L’aspect carnavalesque a été moins mis en lumière dans les études sur l’extrême contemporain. Les deux spécialistes de La littérature française du présent, Dominique Viart et Bruno Vercier, ont seulement évoqué les héritages, la modernité et les mutations des romans de la génération 80 sans citer Bakhtine officiellement. Leur monographie ne donne pas une nature obvie à la carnavalisation qui, pourtant, imprègne insidieusement les normes des romans d’aujourd’hui. La présente étude entend restaurer cette négligence en soutenant l’hypothèse que les romans de l’extrême contemporain donnent un nouveau souffle au carnavalesque en dépassement du simple jeu des renversements et du réalisme grotesque. Les choses actuelles se font avec une subtilité qui donne une certaine normalité au phénomène inscrit dans les codes génétiques du roman français de l’X-Contemporain. Elle a, également, pour objectif central d’identifier les normes carnavalesques en filigrane dans les Romans X-C[1]. Au regard des pratiques nouvelles dans la discursivité romanesque, la théorie dialogique de Mikhaïl Bakhtine est opératoire pour localiser les zones des normes et des non-normes des auteurs sélectionnés. Pour ce faire, la démarche de l’étude opte pour une mise au point théorique de l’a-normalité carnavalesque avant de dégager les traits normatifs du genre.
1. De l’anormalité à la normalité du carnavalesque
La carnavalisation a été théorisée par Mikhaïl Bakhtine à partir des œuvres de François Rabelais. Elle mettait en jeu les formes populaires contenues dans le genre romanesque du Moyen-âge et de la Renaissance. Ce concept, au moment de sa promotion, a été réduit à une aberration scientifique. Par la force du temps, le carnavalesque a gagné en légitimité en raison des pratiques sociales et littéraires promotrices du renversement et de la culture populaire.
1.1. L’anormalité et le carnavalesque
La contribution prend pour point de départ la réflexion sur la réception des travaux de Mikhaïl Bakhtine (1895-1975) dans la période de leur émission en Russie, c’est-à-dire dans le courant des années 1929-1960. Un tel pas d’approche de la recherche est idéal pour réexaminer le concept de la « carnavalisation » du point de vue de la normalité imposée par les institutions universitaires quant à l’appréciation ou la dépréciation des théories provenant des savants qui mettent à mal les normes scientifiques établies. Pour ce faire, il est important de poser le postulat de base en prenant appui sur la pensée de Pontoizeau Pierre-Antoine relativement à la normalisation sociale. Dans le cas échéant, les institutions universitaires visent la normalisation des recherches scientifiques en favorisant « l’exhibition de modèles et de stéréotypes désirables qui font office de normes » (2024, 1). En s’éloignant de ces normes, le scientifique s’expose à la marginalisation ; chose qui a été le cas avec Mikhaïl Bakhtine. Selon les sources historiques, Bakhtine a trouvé des limites au formalisme russe en proposant une méthode nouvelle d’approche du texte littéraire ; celle-ci paraissait hors-norme à l’époque. Elle lui a même valu quelques quolibets pour la raison de son anormalité prégnante. Cependant, l’originalité du théoricien russe a fait de lui le précurseur des approches dialogiques, à savoir l’intertextualité, l’hypertextualité, la sociotextualité, l’intermédialité, l’autotextualité. La présente section entend passer en revue les raisons pour lesquelles les opinions de Mikhaïl Bakhtine ont été taxées d’hors-normes par l’institution universitaire de normalisation des recherches en sciences humaines et sociales.
Dans la préface de l’ouvrage Esthétique et théorie du roman, Michel Aucouturier, rappelle le scandale qui a eu lieu à « l'Institut de littérature mondiale de Moscou » en 1946 lors de la soutenance de thèse de Bakhtine. Après sept (7) heures de délibération, le titre de docteur lui a été refusé, en compensation il obtint celui de « candidat ès sciences » (1978, 9). Un tel évènement a été provoqué par la démarche ʺanormaleʺ entreprise pour écrire sa thèse qui a été publiée en 1965 sous le titre L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-âge et sous la Renaissance. Son travail a donné naissance à la théorie de la carnavalisation, laquelle instaure l’idée de l’investissement de la culture populaire dans la prose rabelaisienne. Cette idée a été étendue dans le temps grâce aux activités des épigones influencés par la technique de rédaction et la théorie du roman de Bakhtine. Le théoricien russe reconnait qu’il est allergique à « la méthode formelle ou morphologique » (1978, 25). Il se refuse à épouser les normes linguistiques qu’il estime enfermées sur elles-mêmes avec des secteurs d’investigation comme les facteurs du langage, la phonétique, les rimes, le rythme, les figures de style limitées au texte poétique. Il désapprouve la mode du scientisme, de 1’érudition superficielle, du ton docte, anticipateur et prétentieux (Bakhtine, 1978, 24). Il démontre que le roman développe un autre contenu de recherche portant sur la créativité débordant la simple « littérarité » promue par le Cercle linguistique de Moscou, notamment par Roman Jakobson.
Pour Mikhaïl Bakhtine, « l'analyse esthétique ne doit pas s'orienter sur l'œuvre dans sa réalité sensible, systématisée par la seule connaissance, mais sur l'œuvre telle qu'elle apparaît quand l'artiste et le spectateur orientent vers elle leur activité esthétique » (Bakhtine, 1978, 32). L’analyse est donc une construction dialogique entre l’écrivain-artiste et le lecteur-critique en fonction d’une activité intentionnelle génératrice de fictions inédites. Les idées d’investigation de Bakhtine étaient dissonantes par rapports aux lois et principes linguistiques provenant du Cours de linguistique générale (1916) de Ferdinand de Saussure. Il posa l’hypothèse d’une plus grande valeur à étudier les valeurs sociohistoriques contenues dans la production romanesque. Ainsi, les prescriptions ou les normes des deux grands cercles formalistes (Moscou et Petrograd) de la période 1915-1924 ont donné une coloration anormale aux méthodes heuristiques bakhtiniennes. Le théoricien considérait dès 1924, et peut être avant tout le monde que le roman était une « mise en pièce ʺsacrificatoireʺ» (Bakhtine, 1970, 30). En extension de cette vision, le texte littéraire est consubstantiellement hétérogène dans sa nature profonde (thème, histoire) et dans ses artifices discursifs (énonciation, parole). C’est un leurre pour les membres du cercle linguistique de Moscou et celui de Petrograd de croire à une cohérence inextricable des qualités intrinsèques de l’œuvre littéraire. Si la norme dans le courant 1915-1929 était d’étudier la langue comme moyen de communication à travers des signes phonétiques ou verbaux, pour Bakhtine la vraie richesse du texte se trouve dans la prise en considération de la parole comme moyen distinctif de l’usage de la langue. À l’époque, l’anormalité s’appliquait au fait de donner un contenu oratoire et culturel à l’immanence du texte. Au-delà de la matière, se trouve la psychologie de l’auteur dont l’analyse démontre efficacement le langage carnavalesque activé lors des « propos sans suite », des « oppositions non exclusives », de la « ménipée (satire) », de la « polyphonie », des « répétitions » (Kristeva, 1969, 100-101).
Mikhaïl Bakhtine ne définit pas de manière pédagogique une technique scientifique d’animation du texte. Il se laisse guider plutôt par une spontanéité éclectique en abordant le texte qu’il conçoit comme un tissu « slovo » à déficeler pour voir que les fils de conception ont diverses provenances. Un point de conflit avec les cercles linguistiques résidait dans le fait, pour Bakhtine, de penser que le texte n’est pas une production authentique. Il est le fruit de plusieurs sources d’influence que l’écrivain dévie en un seul canal d’émission. En mobilisant plusieurs ressources (linguistiques, sociales, politiques), l’écrivain manifeste une volonté de communication et d’affranchissement des normes préétablies de la conception du genre qu’il s’agisse de roman, de poésie ou de théâtre. Initiant une révolution du langage, l’écrivain évoque un décor sociolinguistique dont le critique se charge de montrer l’endroit et l’envers à partir des rets composés du rire, du comique, de la parodie, du grotesque, du plurilinguisme, de la polyphonie, de l’hybridation, et bien d’autres facteurs tels que le style, le polylinguisme, la différenciation langagière. La propension de Mikhaïl Bakhtine à créer des concepts donne à son discours une philosophie particulière du langage. Il s’investit plus à commenter les signes dialogiques que de gloser sur les signes linguistiques. La différence est que la première classe confère au mot un contenu extralinguistique avec une signification plus large et la seconde renferme les plus petites unités d’expression du langage. Les commentateurs de Bakhtine (Kristeva, Todorov…) ont pu faire ressortir la polyvalence du théoricien en dépit du fait que la théorie carnavalesque au moment de sa formulation a donné lieu à des modalités ʺanormalesʺ de caractérisation des textes. Mais avec le temps, la carnavalisation a pu bénéficier d’une requalification pour devenir un modèle d’analyse et une mode dans la pratique littéraire.
1.2. La normalité du carnavalesque
Il ressort du point précédent que la carnavalisation est un concept créé par Mikhaïl Bakhtine dans ses travaux portant sur Rabelais. Au départ, elle paraissait anormale à exposer la puissance du texte littéraire. Cependant, avec le concours des circonstances, les idées bakhtiniennes ont commencé à avoir une place importante dans les débats scientifiques vers 1960. En raison de l’innovation qui se trouva dans la vision herméneutique de Bakhtine, le texte littéraire n’est plus analysé selon la rigidité mécanique, mais il est appréhendé sous le prisme de ses aspects intentionnels et créatifs. L’institution littéraire qui avait taxé le concept « carnavalesque » d’aberration se rend à l’évidence que la notion dépasse le simple cadre de la théorie littéraire pour, effectivement, manifester les dimensions inconscientes qui animent toute l’humanité. La carnavalisation est, dès lors, l’expression des désirs refoulés des Hommes ; lesquels utilisent les formes culturelles telles que le carnaval au Moyen-âge pour les exprimer dans un temps précis. Avec le dépérissement des fêtes populaires dans la culture occidentale, d’autres sources de déversoir du populaire se sont amplifiées, à savoir la littérature, le cinéma, la danse. La section présente a pour tâche de montrer la pertinence vivace du carnavalesque dans les expressions culturelles pour justifier l’actualité et la normalisation du phénomène. Ce qui était rejeté autrefois, est en phase de trouver les normes de son acceptation dans les cultures relativement postmodernes et hypermodernes.
Les travaux les plus récents postulent que la carnavalisation a une double nature : d’une part, elle est une théorie décomplexée départie de son aura d’anormalité originelle. Les critiques du temps présent l’utilisent sans donner l’impression d’appartenir à une catégorie marginale de scientifiques comme a pu l’être Bakhtine lorsqu’il déplaça les bases heuristiques de l’analyse textuelle. D’autre part, la carnavalisation est une attitude sociale d’expression de la particularité de l’individu ou de l’artiste. En combinant les deux bornes, des travaux remarquables démontrent cette normalité du carnavalesque en tant que thèmes et pratiques. Il est difficile de ne pas citer la Carnavalisation des hiérarchies de genre et du corps dans la fiction de Woolf de Victoria Bilge Yilmaz (2024), la Carnavalisation et anthropophagie dans le métacinéma de Carlos Reichenbach de Carlos Eduardo Pereira (2024) et Carnavalisation et métamorphose, señora de la miel de Fanny Bruitrago de Jenny Elisabeth Muñoz Cardenas (2014). Lorsque la carnavalisation est utilisée comme baromètre de recherche, il est question de démontrer des aspects spécifiques par lesquels la société de l’extrême contemporain se caractérise. Il s’agit de mettre en scène la crise des valeurs et des symboles, générée par la ʺmentalité de l’extrêmeʺ qui commence déjà par l’« incrédulité à l’égard des métarécits » (Lyotard, 1994, 6).
On aura compris que le postmodernisme est une période favorable à la carnavalisation de l’autorité régalienne dans l’imposition des idéologies à suivre. Du point de vue littéraire, la révolte se ressent à travers la remise en cause des normes classiques de rédaction des genres. En effet, « suivant la pensée du philosophe [Jean-François Lyotard], on peut affirmer qu’une pratique est ʺpostmoderneʺ lorsqu’elle remet en question aux niveaux de la forme et du contenu, les notions d’unité, d’homogénéité et d’harmonie » (Paterson, 1993, 2). Avec les nouvelles tendances d’écriture fondées sur le fragmentaire, l’hétérogénéité, la culture urbaine et l’annihilation politique, la carnavalisation trouve les voies de sa normalisation et même de son extension avec quelques romans de l’extrême contemporain. Le concept même d’hypermodernité traité dans les ouvrages de Gilles Lipovetsky et Jean Serroy démontre que la carnavalisation est en fin de normalisation dans les sociétés post-industrielles. Ils affirment que « nous sommes à l’heure hypermoderne du mélange des genres, des transversalités créatives, des dérégulations productrices de liaisons ou de synthèses esthéticomarchandes. À l’âge des croisements hypermodernes, les produits de grande consommation se confondent avec la mode, la mode mime l’art, la publicité revendique la créativité artiste et l’art se rapproche du produit mode et luxe » (Lipovetsky et Serroy, 2013, 78). La phase hypermoderne réhabilite les normes carnavalesques affiliées à l’hybridation, la dérégulation, la consommation, la distribution.
Les identités remarquables de cette période confortent la carnavalisation dans ses prémonitions d’une société occidentale en proie au renversement de ses normes traditionnelles. Cela a été visible dans les romans du XXe siècle. Mindié Manhan Pascal a pu en faire la démonstration dans ses études centrées sur Louis-Ferdinand Céline en démontrant que l’écrivain produit un bal carnavalesque au sein de l’écriture. Dit-il, « dans l’œuvre romanesque de Céline, la sexualité suggestive se manifeste d’une part par l’usage d’un vocabulaire impur, grossier et impudique, et d’autre part par la relation de scènes grotesques de masturbation. » (Mindié, 2013, 158). Les romans québécois ne sont exempts de la mise en évidence de la carnavalisation comme procédé d’écriture. André Belleau s’est évertué à montrer la prégnance du phénomène chez des écrivains comme Jean-Le Maigre, Albert Laberge, Marie-Claire Biais et bien d’autres (Belleau, 1983, 54-64). Il distingue les formes élémentaires du carnavalesque à des niveaux transversaux. Elles portent sur la mise en contact des oppositions telles que le haut et le bas, le sérieux et le comique. Cela permet une participation collective au rire et à la festivité des mots et des actes. Ainsi, toutes les distances entre les êtres, les classes, les genres, les statuts, sont effacées au profit du rapprochement et de la complémentarité. Il peut se dégager dans les faits carnavalesques une tonalité parodique et provocatrice dans l’objectif d’exprimer les sentiments les plus refoulés de « l’inconscient collectif » comme pourrait le dire Carl Gustav Jung. Les instincts basiques et les archétypes consolident les comportements carnavalesques que la littérature met en lumière. Notons que les romans de l’extrême contemporain apportent des déterminants nouveaux à la caractérisation des normes carnavalesques.
2. Les normes carnavalesques de l’extrême contemporain
La création romanesque est celle qui fait l’objet d’une étude générale dans la présente section. À des moments particuliers, l’interprétation se voudra spécifique sur des indices textuels provenant des romans X-C. Cependant, la généralisation est privilégiée pour rassembler au maximum les normes fédérales de l’écriture carnavalesque de l’extrême contemporain.
2.1. Le management de l’oralité carnavalesque
Les lois qui régissent la carnavalisation du texte littéraire ne sont pas inflexibles. Elles sont plutôt dynamiques dans le temps en fonction des contingences sociales. Au niveau de l’extrême contemporain, une révision des standards de représentation des normes carnavalesques donne l’opportunité d’identifier de nouvelles configurations esthétiques du phénomène. Dans ce qui suit, il est question de révéler quelques subtilités actualisées de la pratique qui fait autorité dans les créations artistiques et littéraires promues par certaines maisons d’édition. Nous rappelons, à toute fin utile, que dans l’extrême contemporain, les attributs carnavalesques de l’écriture sont des actifs de promotion de l’innovation littéraire. Ils sont valorisés par les maisons d’édition (Minuit, Olivier, POL) qui veulent s’imposer sur le marché de l’édition en proposant des livres décalés des normes classiques. Comme les recherches sur les industries culturelles le montre, le livre est devenu un produit de consommation de masse qui se vend ʺfacilementʺ lorsqu’il révèle l’intimité de l’écrivain(e) tant personnelle que sexuelle sous forme de confession ou lorsqu’il réaménage les normes canoniques de la création littéraire sous les traits d’une transgression. Dans ce brassage d’intention commerciale et de volonté de notoriété, les romans X-C remettent à l’heure les pendules de l’écriture en utilisant des formes narratives inédites fondées sur l’oralité carnavalesque. Celle-ci est détaillée dans Fictions narratives du XXIe siècle, un ouvrage dont la direction a été assurée par Cécile Narjoux et Claire Stolz.
Une considération typique de la rhétorique narrative, fait savoir que l’oralité carnavalesque est celle qui modifie le récit dans ses mécaniques de distanciation du sujet énonçant et de l’objet énoncé pour une solution de rapprochement consubstantielle. Cette transformation du récit se fait au profit du discours. Autrement dit, « le retour du récit » vu par Dominique Viart et Bruno Vercier dans les romans X-C, est plus discursif que narratif. Qu’est-ce à dire ? Dans la narration du XIXe siècle avec Gustave Flaubert notamment, le récit se construit sous des ambitions pédagogiques avec une volonté de renseigner le lecteur en lui donnant toutes les informations nécessaires à la complétude sémantique du passage narré. Si nous voulons faire une métaphore universitaire, nous dirons que le récit traditionnel est un travail dirigé conduit par l’auteur. Or, avec les romanciers X-C, le récit actualisé est andragogique. L’écrivain(e) estime que le lecteur est outillé à combler les non-dits du texte et favorable à effectuer dans recherches personnelles pour découvrir le sens des implicites. Les romanciers du présent estiment haut le niveau de maturité des lecteurs de la contemporanéité. C’est pourquoi, ils font des récits sous formes de cours magistraux donnant des indications de lecture, voire des orientations de réflexion sans jamais dire clairement la modalité pensive à adopter. L’oralité carnavalesque donne des critères renversants à la scripturalité en faisant d’elle une pratique agoratoire si l’expression nous est permise. Le livre France guide de l’utilisateur de Jean-Charles Massera donne un degré plus précis à cette oralité carnavalesque. L’exemple est le suivant. Il est long pour exprimer en totalité les conditions difficiles d’obtention d’un emploi stable en raison des récessions économiques :
Bonjour et bon courage si vous cherchez un emploi. La récession annoncée par l’OCDE est conforme aux prévisions : il y a déjà de nombreuses files d’attente devant les agences d’intérim. Ça devient dur, très dur, dans le sens où vous avez peu de chances de sortir de la logique intérimaire. Ce matin en banlieue nord vous êtes toujours sans rien pour la journée à Bobigny, Gennevilliers, Saint-Denis et puis plus loin à Cergy-Pontoise. Vous devrez faire preuve de patience d’autant plus que contrairement au début des années quatre-vingt où la moitié des intérimaires trouvait un emploi stable en 12 mois, ils ne sont plus qu’un sur quatre en 1992. L’autre gros point noir c’est bien sûr la vallée de la seine, précisément dans le secteur automobile où la grogne a grimpé d’un cran hier. Pas de changements dans la région de Lille, vous allez de stage de formation en stage de formation entre l’ANPE et les agences intérimaires. Le fait nouveau, ce sont les filières qualifiées, qui sont elles aussi touchées. Attention notamment pour les titulaires de BT et DUT, les employeurs doutent que la formation sanctionnée par ces diplômes soit adaptée aux besoins réels du marché et deviennent très difficiles. Ailleurs, c’est dans la région du sud-ouest que la situation devient préoccupante. Là encore les contrats à durée déterminée paraissent être une solution provisoire. Ici comme sur l’ensemble du pays, le nombre de contrats à durée déterminée a tout simplement doublé entre 1982 et 1993. Essayez cependant d’éviter les contrats emploi solidarité et les formations non rémunérées au-delà de mois. Attention enfin à hauteur de Carcassonne ouest sur l’A61 : là vous êtes ralenti dans les deux sens par des viticulteurs en colère (Massera, 1998, 7-8).
Le livre de Massera est impossible à définir comme un roman ; la narration est difficile à substituer à un récit. Le lecteur se retrouve seul à considérer ses propres impressions devant un texte qui a des allures d’une fiction-essai écrite avec une tonalité ironique qui rappelle le genre expressif du régime carnavalesque du discours. L’édifice de la langue est celui de l’ironie et de la provocation sur des questions sociales délégitimées par le système politique de gestion de la société française au sein de laquelle la période du plein-emploi est dépassée par les nouvelles prérogatives de l’employabilité. Le livre de Massera est un lieu de l’expression de la vie de la cité française, où la parole est libérée par l’écriture et non pas enfermée dans la graphie pour recadrer les politiques publiques. À l’oralité carnavalesque, chaque écrivain apporte une particularité indéniable, en l’occurrence Erwan Desplanques (Si j’y étais [2013]), Jean Rouaud (La Femme promise [2009]), Laurrent Mauvigner (Des hommes [2009]) et Jean Echenoz (Au piano [2003]) privilégient une narration forgée par des interruptions dans la rythmique de la phrase. La ponctuation se veut alors subversive de la grammaire et de la prosodie française avec des circonlocutions qui démontrent que la parole écrite est un déversoir des sentiments les plus intimes, des faiblesses personnelles. Dans un tel cas de figure, les romans X-C sont des lieux de distraction où l’écriture éloigne le lecteur de son objectif central, celui de lire simplement une histoire. Les écrivains le force à établir une correspondance entre les titres des œuvres et les histoires qu’y sont racontées. Le langage énigmatique des titres des romans X-C évite la titraille passive. Des romans comme L’Imprévu (2005) de Christian Oster, Et mon cœur transparent (2008) de Véronique Ovaldé, Les Oubliés (2007) de Christian Gailly, La Délicatesse (2009) de David Foenkinos, Les Lisières (2012) d’Olivier Adam, Fuir (2005) de Jean-Philippe Toussaint, Les Découvertes (2011) d’Éric Laurrent montrent que les romanciers font des mystères au niveau des titres pour susciter la curiosité et éviter les résumés par anticipation. Dans ces romans de l’extrême, le narrateur est souvent un ʺJe socratiqueʺ avec un discours de maïeuticien. Jean-Philippe Toussaint en fait la démonstration avec une longue phrase dans Fuir (2005), mais elle est scindée pour la commodité de l’exemplification :
les yeux fermés et sans bouger, j’écoutais la voix de marie qui parlait à des milliers de kilomètres de là et que j’entendais par-delà les terres infinies, les campagnes et les steppes, les forêts, les lacs, les villes et les montagnes, par-delà l’étendue de la nuit et son dégradé de couleurs à la surface de la terre, par-delà les clartés mauves du crépuscule sibérien et les premières lueurs orangées des couchants des villes est-européennes, j’écoutais la faible voix de marie qui parlait dans le soleil du plein après-midi parisien et qui me parvenait à peine altérée dans l’obscurité de ce train, la faible voix de marie qui me transportait littéralement, comme peut le faire la lecture, la pensée ou le rêve, quand, dissociant le corps de l’esprit, le corps reste statique et l’esprit voyage, se dilate et s’étend, et que, lentement, derrière nos yeux fermés, naissent des images et resurgissent des souvenirs, des sentiments et des états nerveux, se ravivent des douleurs enfouies, des émotions, des peurs, des joies, des sensations, de froid, de chaud, d’être aimé, de ne pas savoir, dans un afflux régulier de sang dans les tempes, une accélération régulière des battements cardiaques, et un ébranlement, comme une lézarde, dans une mer gelée de larmes sèches (Toussaint cité par Cécile Narjoux, 2015, 24).
Dans les romans de l’extrême contemporain, ce que ʺjeʺ sait, c’est qu’il ne sait rien. Il parle donc pour faire accoucher sa propre âme de ses idées, ses peurs, ses doutes, ses envies, ses dépressions, ses passions. Il cherche à se connaitre en visant la connaissance de l’autre en utilisant le ʺjeʺ énonciatif. Déjà en 1973, Jean Rousset trouva que « ce pronom si commun [est] pourtant si étrange, si rebelle à la saisie en raison de sa complexité et de sa mobilité » (Rousset, 1973, 7). Toussaint donne une lisibilité à cette nouvelle posture de narration au sein de laquelle le narrateur est dans une sorte de discours autocentrée avec une énonciation pathétique et non poétique. Le ʺjeʺ qui raconte manifeste les mêmes attributs que la voix off dans les films-documentaires (Bikialo, 2015, 86). Ce pronom et ses variantes sont, par conséquent, chargés de maintenir le rythme de la communication visuelle et auditive en donnant sens aux images montées de toutes pièces sans connaître à l’avance les tenants et les aboutissants des évènements. Ainsi, la connaissance de la fiction s’effectue à travers la discussion triadique sous la forme du dialogisme bakhtinien entre l’auteur, le narrateur et le lecteur. Plus globalement, « les thèses de Bakhtine […] portent au premier chef sur la forme des textes, en tant que s'y marque une certaine posture, en l'occurrence dialogique, par rapport à la parole, même si elles ne s'interdisent pas de prendre en compte les contenus thématiques » (Vouilloux, 1991, 4-5). Le narrateur dialoguiste n’est pas dans la position du savant, il est dans la posture du chercheur : l’un est accompli, l’autre s’accomplit. L’angle d’attaque de la section a été celui de signifier que le retour du récit dans le roman de l’extrême contemporain s’effectue selon les paramètres du discours en dépassement de ceux régulant le système classique de la narration. En ce sens, le locuteur fictif est un maïeuticien qui fait accoucher son âme en priorité à travers un dialogue réflexif. En le faisant, il fait sortir à la surface du récit les observations, les transgressions et les intimités tant appréciées par les lecteurs passionnés par tout ce qui est extrême à l’image de la sexualité ouverte.
2.2. La sexualité pseudo-carnavalesque
L’une des tâches de départ pour animer la présente section est la clarification du concept de « pseudo-carnavalisation ». Pour ce faire, force est de revenir au paradoxe que pose Julia Kristeva dans son approche sémantique de la carnavalisation de Mikhaïl Bakhtine. Elle estime que le phénomène bakhtinien est éloigné du dévergondage que la critique contemporaine entend attribuer à la théorie carnavalesque qui trouve la meilleure formule de son expressivité dans le dialogisme. Selon Kristeva, « il faudrait insister sur cette particularité du dialogue comme transgression se donnant une loi, pour le distinguer d’une façon radicale et catégorique de la pseudo-transgression dont témoigne une certaine littérature moderne ʺérotiqueʺ et parodique » (Kristeva, 1969, 91). Dans l’esprit de Mikhaïl Bakhtine, la pratique du dialogue carnavalesque s’effectue en respectant les limites à ne pas franchir pour rester toujours dans la logique du jeu, de la parodie, de la satire. Revenant à l’extrême contemporain, la sexualité abordée ouvertement et frontalement dans les textes littéraires nous donne, à la suite de Julia Kristeva, l’impression d’une pseudo-carnavalisation ; laquelle signifie une transgression des normes sans contraintes morales. Cette tendance libertine de la sexualité est lisible dans l’ouvrage collectif dirigé par Efstratia Oktapoda, à savoir Mythes et érotismes dans les littératures et les cultures francophones de l’extrême contemporain, paru en 2013.
Le problème que nous posons à partir de ce livre est que la sexualité pseudo-carnavalesque met en lumière l’intérêt et la pertinence du sexe dans l’écriture romanesque de l’extrême contemporain. Notre propos prend volontiers appui sur des romans écrits par des femmes pour aborder la sexualité féminine. Les écrivaines de l’extrême contemporain sont les hérauts du mouvement de libération de la sexualité féminine. Celle-ci est encadrée par des « normes » que Stéphane Legrand définit comme l’exigence de respecter des contraintes et de manifester un « devoir-être » en accord avec une régulation sociale ou idéologique (Legrand, 2007, 153). C’est justement contre toutes les barrières encadrant la sexualité de la femme que les écrivaines inspirées par un sens profond du féminisme luttent. Elles tentent de libérer les femmes des complexes qui leur ont été imposés durant des siècles par le système traditionnel élaboré, d’une part, à rendre dociles les femmes et virils les hommes, et, d’autre part, à renforcer les normes sociales et religieuses de domination de la gent féminine. Mais, la relecture actuelle de la notion de ʺdominationʺ élimine une confusion qui perdure dans le temps et que la période de l’extrême contemporain se charge de restaurer. Pour les écrivaines engagées dans le combat de libération des femmes, les hommes bénéficient d’un « pouvoir de soumission » en raison des acquis sociaux dont ils sont les bénéficiaires depuis des générations ; mais le « pouvoir de domination » revient à la femme qui le revendique. À la lecture des romans comme Baise moi (1994) de Virginie Despentes, Jouir (1997) de Catherine Cusset, Bordeline (2000) de Marie-Sissi Labrèche, La vie sexuelle de Catherine M. (2001) de Catherine Millet, Putain (2001) de Nelly Arcan, Pornocratie (2001) de Catherine Breillat, Sept nuits (2005) d’Alina Reyes, les hommes sont au pied des femmes par le pouvoir du sexe et le contrôle que celui-ci leur donne sur les hommes qu’elles trouvent faibles dans l’espace privé de copulation. De cette faiblesse nait l’idée que la sexualité est plus un pathos qu’un éros, voire une souffrance à la procréation qu’une explosion de plaisir à la copulation. La frustration et l’envie de découverte de l’extase poussent les femmes à se mettre en quête d’expérience sexuelle souvent par l’infidélité ou par l’autosatisfaction. Ces pratiques sont légitimées par les écrivaines de l’extrême contemporain telles Virginie Despentes dont un passage tiré de son roman Les Jolies Choses en donne une illustration :
Claudine est blonde, courte, robe rose qui semble sage mais laisse voir un peu sa poitrine parfaite poupée bien arrangée. Même sa façon de s’avachir, coudes sur la table, jambes étendues, a quelque chose de travaillé […] elle savait déjà que si l’appartement lui plaisait, elle resterait le temps qu’elle voudrait. Elle en avait palpé quelques-uns des comme lui […] Elle a dû faire ce qu’il fallait, puisque dès le lendemain soir, le bonhomme lui-même insistait pour qu’elle s’installe là. À force, il connait ses petites manigances […] La première fois qu’elle coince un mec, elle est sympa comme une nounou entre deux pipes […] Jusqu’au jour où ça ne suffit plus à Claudine, les cadeaux, les attentions, les preuves d’amour. Alors c’est la phase finale : elle s’arrange pour qu’ils apprennent non seulement qu’elle se fait tirer ailleurs, mais surtout combien elle aime ça. (Despentes, 1998, 4-14).
Au-delà de la fiction, l’équation qui se présente est que la sexualité n’est plus le signe d’un engagement mutuel de fidélité entre un homme et une femme qui est dotant plus libre de disposer de son corps et de l’offrir à la personne qu’elle estime digne de lui procurer du plaisir. La femme n’est plus un objet sexuel, elle devient le sujet de sa propre sexualité. Elle se libère du poids moral pour enchaîner les conquêtes d’hommes selon les standards de ses propres goûts. Si dans la société traditionnelle, la femme était passive en attendant le prince charmant ; dans la société de l’extrême contemporain, elle n’a aucune honte à quêter son esclave sexuel. On l’aura compris, les hommes sont descendus de leur piédestal pour devenir de simples sujets sexuels pour les femmes qui refusent la vie de couple et le poids des responsabilités familiales. Selon les nouvelles normes sociales progressistes, il est mieux d’être une femme libertine et épanouie qu’une femme pudique et frustrée dans son for intérieur à l’image de Sévérine dans Baise moi :
La première fois que Sévérine a trouvé une cassette porno qui trainait sur la table du salon, elle a été tellement choquée qu’elle n’a pas protesté. […] Sévérine pose la même question tous les jours […] A croire qu’elle a le con trop raffiné pour qu’on lui fasse du bien avec une queue. […] Elle est conne, sidérante de prétention, sordide d’égoïsme et d’une écœurante banalité […] Il est vrai qu’elle soigne sa conversation. Elle l’émaille des bizarreries dûment accréditées par le milieu qu’elle fréquente (Despentes, 1994, 10-13).
Dans le roman de Virginie Despentes, Sévérine est présentée comme une femme traditionnelle qui refuse de négliger ses valeurs pour ressembler à Nadine dont les attitudes reflètent son esprit libre quant à la pratique sexuelle et à la quête d’expériences insolites en matière de sexualité. Ce roman présente des femmes autour desquelles peuvent s’engager des débats relativement au statut social de la femme résiliente et de la femme déviante. La première des dames est conciliante avec les normes du patriarcat et la seconde est obsédée par le renversement de la moralité bienpensante qui fait fi souvent des conditions désastreuses de vie de celles qui ont vécu le viol, la violence masculine et qui n’ont d’autre moyen de révolte que l’appropriation de leur sexe détourné par la menace, la contrainte durant l’enfance ou l’adolescence. Rappelons que Virginie Despentes a subi un viol qui a marqué sa vie, son écriture et tous les films qu’elle a pu réaliser. Les romans et les œuvres filmiques de cette auteure sont hors-normes, et très souvent choquants. Le choc est aussi visible à la lecture de passages libertins de La vie sexuelle de Catherine M. Ce roman de Catherine Millet vient soulever la question de l’exhibitionnisme en faisant du lecteur un voyeur surexcité par les obscénités des actes sexuels exécutés de façon anormale, en dénuant au mot le sens moral, mais en y conservant les normes qui interdisent à une femme d’avoir une relation sexuelle avec plusieurs hommes en même temps. L’exemple présente la narratrice dans une posture similaire :
Au fur et à mesure du déroulement du repas, je suis consciencieusement baisée, les uns m’entraînant sur un sofa, les autres m’enfilant debout, par-derrière, moi pliée sur la table, tandis que la discussion se poursuit alentour. Au passage, le maître d’hôtel et des serveurs en profitent. Si un orgasme n’a pas déjà interrompu ma masturbation, c’est, à la fin, les garçons de cuisine qui nous rejoignent Me trouver au milieu d’un groupe d’hommes qui vaquent à diverses occupations et qui ne s’interrompent que pour venir me rejoindre avec une sorte de négligence est un schéma récurrent. Un léger déplacement fait de l’oncle un beau-père et de l’assemblée d’hommes d’affaires un groupe de joueurs de cartes (ou d’amateurs de football) qui viennent à tour de rôle me baiser sur un divan tandis que les autres poursuivent la partie (ou s’excitent devant l’écran de télévision) (Millet, 2001, 27).
La lecture de cette scène génère une idée, c’est que la femme dotée de sa jeunesse a des désirs sexuels qui peuvent s’assimiler à ceux de la vulgarité et du libertinage. C’est à se demander si la libération sexuelle de la femme est synonyme de dévergondage sexuel. N’est-ce pas une autre manière d’objectiver la femme dans les bras des hommes ? Pour les autrices, tout dépend du consentement mutuel. Si la femme est à l’aise avec une idée ou une pratique, le jugement moral et marginalisant n’a plus une grande place. Si la prouesse est accordée à un homme qui accumule des femmes, la faiblesse ne devrait pas caractériser une femme qui accumule plusieurs partenaires sexuels. En cela aussi se perçoit l’égalité des sexes en plus de celle du droit. Ainsi, il n’est plus interdit d’afficher son intimité dans les textes et les médias au risque de porter éternellement les stigmates de son passé ou de sa liberté présente. Les femmes peuvent vivre leurs fantasmes en annihilant en elles l’effet réprobateur de la société. La narration du X est un moyen de manifester la force de son identité sexuelle pleinement assumée et, peut-être, revendiquer par-là la pleine reconnaissance de son engagement.
2.3. Le résultat carnavalesque de l’engagement
Les deux sections qui précèdent ce point comportent des informations qui rendent intelligibles les normes carnavalesques présentent dans l’écriture romanesque de l’extrême contemporain. Nous avions parlé de l’oralité carnavalesque dont le rayon d’action atteint le discours intimiste des narrateurs dans les œuvres du temps présent. Ensuite, la sexualité pseudo-carnavalesque a donné lieu à l’exégèse du libéralisme sexuel qui se fait jour dans les écrits de l’extrême contemporain, en particulier dans les écrits féminins. En clausule de cette enquête sur les normes carnavalesques, la recherche porte sur le résultat carnavalesque de l’engagement. Pour plus de précision, il est possible de consulter l’ouvrage Le roman français de l’extrême contemporain, dirigé par Barbara Havercoft. Ici, il est question de mettre l’accent sur la problématique de l’extrême contemporain qui ne favorise pas la mise en lumière de mouvements littéraires avec un chef de file comme cela a pu être le cas au XIXe siècle avec, par exemple, Émile Zola, écrivain phare du Naturalisme, Victor Hugo, prophète du Romantisme et au XXe siècle avec Jean Paul Sartre penseur de l’Existentialisme. Aujourd’hui, les écrivains produisent des textes sans revendiquer une attache foncièrement idéologique. Cela à l’avantage de libérer le texte des thèses et pratiques marxistes contraignantes et connues à l’avance ; mais il y a le désavantage d’affaiblir la production littéraire dans ses brèves tentatives de révolte contre les problèmes sociaux, politiques et technologiques de l’époque actuelle. Les écrivains se prononcent sur des sujets d’actualité sans forcément faire changer les points de vue par la simple force du texte.
La preuve historique de la puissance de l’écrivain est le texte « J’accuse » d’Émile Zola. Sans refaire l’histoire, nous voulons dire que les écrivains de l’extrême contemporain ont une avidité à s’interroger sur les enjeux de leur époque sans pour autant risquer de se mettre en conflit ouvert avec les autorités politiques en charge de la gestion des cités européennes. En conséquence, ils sont plus perçus comme des bouffons de l’industrie du livre que des héros de la cause sociale. Voilà où intervient le carnavalesque, à savoir le renversement de l’écrivain qui fait de lui un vain scripteur. Le fait pour les écrivains de s’engager de manière indirecte, c’est-à-dire avec le texte et non le corps, dans les débats contemporains confère au roman l’effet d’un appel à la constatation et non à la révolte. Les écrivains tels que François Taillandier, La grande intrigue (2005-2010), François Bon, Daewoo (2004), Tassadit Imache, Presque frère (2000), Pierre Senges, La Réfutation majeure (2004) et bien d’autres, cherchent à sortir leurs épingles du jeu en exprimant la réalité et les problèmes du quotidien. Mais la période de l’extrême contemporain est celle aussi des engagements loufoques. Les écrivains adoptent bon gré mal gré des comportements extravagants dans leurs productions romanesques. L’un des représentants de cette trempe d’auteurs est Éric Chevillard. Dans son roman Démolir Nisard, une phrase de 39 lignes attire l’attention. Elle a été scindée pour la commodité de l’exemple :
Certains, le chien qu’ils promènent en laisse participe incontestablement de leur être, valeur ajoutée en quelque sorte, on ne peut le considérer – quand ils s’assoient à une terrasse de café et le chien de même sur son train arrière à côté d’eux – en excluant le chien du champ qu’ils occupent, en les coupant de ce chien qui, plus qu’un accessoire, un postiche aux poils de poils frisés ou une prothèse quadrupède, modifie leur personne au point que celle-ci demeurera telle désormais, même en l’absence du chien, définitivement modifiée par le chien, chien qui n’est pas tant un prolongement de leur personne qu’un composant agissant à la manière d’un agent chimique et transformant ni plus ni moins sa structure moléculaire souvent dans le sens d’une amélioration, il faut le reconnaitre, la peau du maitre-chien possède un velouté nouveau, sa pose a gagné en aisance, en souplesse, en noblesse, c’est peut-être le plus stupéfiant, il s’avère que le chien ne tire pas son maitre vers l’animalité mais lui confère plutôt un surcroît de prestance humaine, raison pour laquelle il s’encombre de lui […] (Chevillard, 2006, 35).
En littérature, il n’y a pas de thèmes réducteurs, et l’écrivain tire son inspiration de tout et de rien à la fois. Dans le « tout » nous mettons les grands sujets du moment, et dans le « rien », les sujets strictement personnels qui n’ont aucune incidence sur le destin de l’humanité. En lisant Chevillard, l’on retient que l’avidité carnavalesque de l’engagement est le fait pour l’écrivain de ressentir le besoin de défendre une cause, une idée, un groupe. En l’occurrence dans le fragment ci-dessus, la valeur de l’animal de compagnie qu’est le chien pour les promeneurs solitaires. Au-delà de ce débat périphérique sur l’humanisme renforcé par l’animalité du chien, Chevillard se propose, dans son roman, d’évoquer la mort symbolique de l’écrivain. Il n’est plus vu comme un guide, un avocat, un porte-parole, un représentant ou un observateur averti. Selon Chevillard, il est un profiteur du système et il arrive difficilement à se mettre en marge des instances de légitimation telles que les cercles, les cénacles, les salons, les prix. Un examen attentif de l’œuvre de Chevillard met en lumière une dimension carnavalesque dans la mesure où son texte est plus analysé pour le renouvellement de l’écriture et non pas pour le renouvellement de l’intelligence qu’une œuvre de nature engagée se fixe comme objectif.
L’on remarque que les identifiants remarquables de l’écriture chevillardienne sont l’ironie, l’hyperbole, la polyphonie. Les unités textuelles développées par Mikhaïl Bakhtine sont les éléments de la grille de lecture de cet écrivain français dont le roman est une projection lumineuse sur les activités de l’Écrivain de l’extrême contemporain, lequel s’inscrit dans une forme de pensée automatique en écrivant sans véritable démonstration ni argumentation. Il se libère de ses réactions pulsionnelles à travers une écriture à la fois pour soi-même et pour les universitaires. Dans le premier cas, l’écrivain de l’extrême contemporain se love dans l’autofiction ; dans le second, il exacerbe l’écriture romanesque par la quête volontaire du mélange des théories littéraires en vogue. Pour finir, le roman ne fait plus peur à l’autorité politique, il n’inspire plus en lui la crainte de la révolte. Au contraire, c’est le roman qui se transforme en monstre avec autant de masques rebutant le regard et la volonté du lecteur lambda. Il fait le monstre au lieu de critiquer le ʺmonstreʺ. La traversée de la forme du texte est tellement périlleuse que le message social se perd en cours de lecture. René Audet insiste bien sur un constat pareil en signalant que « la monstruosité de la prose chevillardienne s’impose d’emblée à la lecture, même si elle demeure difficile à cerner » (Audet, 2009, 11). Le point essentiel de ce postulat amène à chercher le cœur de cible des romans X-C. S’agit-il des romanciers ? S’agit-il des universitaires ? S’agit-il du peuple ?
La confusion qui règne autour de ce pôle du destinataire est le motif de l’inertie du roman de l’extrême contemporain. C’est dire que sans la force extérieure de la potentielle censure en raison du manque de puissance des œuvres, le roman X-C démontre un impact versatile de l’engagement des écrivains. Ils sont plus dans la posture de « l’écriture à vendre » que dans « l’aventure d’une écriture » comme ce fut le cas avec le Nouveau Roman et « l’écriture d’une aventure » avec les romans classiques. Prenant appui sur la boutade de Jean Ricardou, nous estimons que les romanciers de l’extrême contemporain s’engagent à vendre une écriture en dénigrant les pionniers de l’histoire littéraire et en éludant les figures de proue de l’histoire sociale. Ils attaquent mieux l’écriture de leurs semblables que les actions des politiques. Autrement dit, l’engagement de l’écrivain de l’extrême contemporain est initié pour défendre au mieux les idées libérales que de nager à contre-courant de la pensée dominante. C'est en cela que réside la faiblesse du langage pseudo-violent des écrivains engagés à l’heure actuelle. Le constat de Carine Capone est sans appel sur un autre écrivain de l’extrême contemporain : « il nous semble que Laurent Mauvignier est un représentant significatif de tout un pan de cette littérature, soucieuse de parler du monde sans assener de vérité ni négliger la langue. En effet, chez lui la langue prend plaisir à explorer les incertitudes, elle se met au service d’une appréhension de ce sur quoi on n’a pas prise » (Capone, 2012, 53). Sans tomber dans la généralisation, vu que l’extrême contemporain n’est pas encore à son aboutissement, il est possible d’affirmer que l’engagement d’ordre politique des écrivains de l’extrême contemporain est entaché par le refus de faire polémique. Cependant, il va de soi que l’écrivain reste toujours une figure phare dans la production intellectuelle de chaque époque.
Bibliographie
AUDET, René, « Lieux et pragmatique de la monstruosité dans la prose narrative d’Éric Chevillard », Tangence, (91), 11, 2009, p.11-27. https://doi.org/10.7202/04807ar
BAKHTINE, Mikhaïl, La poétique de Dostoïevski, traduit du russe par Isabelle Kolitcheff, 1970, Paris, Seuil
BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, traduit du Russe par Daria Olivier, 1978, Paris, Gallimard
BELLEAU, André, « Carnavalisation et roman québécois : mise au point sur l’usage d’un concept de Bakhtine », Études françaises, 19(3), 1983, p.51–64. https://doi.org/10.7202/036802ar
BIKIALO, Stéphane, « Genres de discours et réalité dans la fiction narrative contemporaine », Fictions narratives du XXIe siècle, 2015, Narjoux Cécile et Stolz Claire (Dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p.85-99
CAPONE, Carine, « Laurent Mauvigner, pour une redéfinition de l’écrivain engagé ? », RELIEF, 6, 2, 2012, p.45-58
CHAILLOU, Michel, « L’extrême contemporain, journal d’une idée », 1987, Po&sie
CHEVILLARD, Éric, Démolir Nisard, 2006, Paris, Les Éditions de Minuit
DESPENTES, Virginie, Baise-moi, 1994, Paris, Florent Massot
DESPENTES, Virginie, Les Jolies Choses, 1998, Paris, Grasset
EBA, Axel Richard et TIÉ BI, Alain Irié, « Le Renversement carnavalesque dans J’irai cracher sur vos tombes de Boris Vian », Revue Djiboul, N°4, Vol.1, 2022, p. 230-241
HAVERCOFT, Barbara et al. (Dir.), Le roman français de l’extrême contemporain, 2010, Québec, Edition Nota Bene
KRISTEVA, Julia, Sémiotikê, Recherches pour une sémanalyse, 1969, Paris, Gallimard
LEGRAND, Stéphane, Les normes chez Foucault, 2007, Paris, PUF
LIPOVETSKY, Gilles et SERROY, Jean, L’esthétisation du monde, 2013, Paris, Gallimard
LYOTARD, Jean-François, La Condition Postmoderne, 1994, Paris, Cérès Edition Tunis
MARZOUKI, Abbes, « La Littérature de l’Extrême Contemporain : entre la mort et le Renouvellement », Recherches en Langue et Littérature Françaises, Vol. 13, N° 24, 2019, p.105-114
MASSERA, Jean-Charles, France guide de l’utilisateur, 1998, Paris, POL
MILLET, Catherine, La vie sexuelle de Catherine M., 2001, Paris, Seuil
MINDIÉ, Manhan Pascal, « La carnavalisation de la sexualité dans l’écriture romanesque de L-F. Céline », Perspectives Philosophiques n°005, 2013, p.157-178
NARJOUX, Cécile et STOLZ, Claire (Dir.), Fictions narratives du XXIe siècle, 2015, Rennes, Presses Universitaires de Rennes
OKTAPODA, Efstratia, Mythes et érotismes dans les littératures et les cultures francophones de l’extrême contemporain, 2013, Amsterdam-New York, Rodopi
PATERSON, Janet M., Moments postmodernes dans le roman québécois, 1993, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa
PONTOIZEAU, Pierre-Antoine, « La normalisation de la pensée par la suggestion métaphorique », Cahiers de Psychologie Politique, (45), 2024, p.1-21
ROUSSET, Jean, Narcisse romancier. Essai sur la première personne dans le roman, 1973, Paris, José Corti.
VOUILLOUX, Bernard, Sacrifice et carnaval dans la fiction gracquienne, 1991, Paris, Lettres Modernes
[1] La formule « Romans X-C » est utilisée pour signifier « Roman de l’extrême contemporain ».