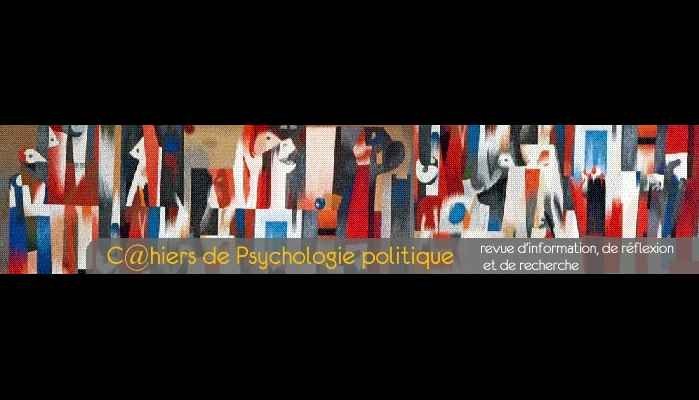John Rawls et la question de la fragilité démocratique
Hamado Ouedraogo, docteur en philosophie, est maître-assistant en philosophie morale et politique à l’UFR de sciences humaines du département de philosophie et psychologie de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou au Burkina Faso et membre du laboratoire de philosophie (LAPHI).
Peu importe la gravité de la situation politique, économique et sociale ; quelle que soit la chute abrupte dans des profondeurs insoupçonnées, les démocraties peuvent s’en sortir. Il y a toujours un moyen de s’en sortir. Il y a toujours de l’espoir et on ne doit jamais lâcher la démocratie. Susilo Bambang Yudhoyono, Président de la République de l’Indonésie.
Introduction
« La démocratie est le pire des régimes, à l’exception de tous les autres. » selon Winston Churchill[1], célèbre pour ses bons mots, cette formule compte parmi les plus fameuses maximes de l’expertise politique. Elle fait partie de ces biens dont on ne reconnaît réellement la valeur que lorsqu’on en est privé. La démocratie est un régime qui repose sur un principe et un mécanisme : le principe, c’est la souveraineté populaire ; le mécanisme, c’est la désignation des gouvernants par les gouvernés. Équilibre entre peuple et pouvoir, égalité et liberté, elle se présente sous différentes facettes. La démocratie vraie, c’est l’association intime, c’est la fusion de l’État et du citoyen et se décline sous de nombreux qualificatifs. Même si aujourd’hui, elle est plus rarement dite « populaire », elle apparaît souvent comme sociale ou participative. Des auteurs comme Francis Fukuyama ont annoncé la « fin de l’Histoire » au moment de la chute du mur de Berlin, estimant qu’avec la fin de l’empire soviétique le monde était voué à une démocratisation complète.
Cet optimisme a été de courte durée. Le modèle démocratique, que l’on disait triomphant dans les années 1990, est fragilisé. Certains évoquent même la mort des démocraties et s’interrogent sur l’avènement d’autres modèles qui seraient plus efficaces à défaut d’être moins aimables ou émancipateur[2]. Oui la légitimité des démocraties est en cause car elles sont malléables et faciles à manipuler. Selon Jan-Werner Müller, « la voie de la raison à peu de poids face aux déferlements des passions politiques, religieuses et idéologiques[3] » (Jan-Werner Müller, 2016, p.121). Le populisme et le panafricanisme (surtout dans les pays du sahel affectés par l’hydre terroriste) se sont beaucoup répandus comme moyen de lutte contre l’insécurité par des accusations contre l’occident de vouloir recoloniser l’Afrique par le biais du terrorisme. De telles notions ont l’immense avantage aux yeux des détracteurs des régimes démocratiques de poser au centre de leurs revendications, la question ou la place du peuple, de leur culture et et de leur autonomie dans la démocratie. En fait, si le populisme contrevient aux fondamentaux de la démocratie libérale, il se nourrit de ses faiblesses, par exemple, la montée de l’abstention lors des élections qui rend la démocratie non représentative, la dégradation de l’image de la politique, des hommes et des partis politiques. Au milieu de ce tourbillon, les citoyens réagissent de différentes manières, avec des réponses extrêmes de l’apathie mais aussi de la défiance. De ce fait, une telle démocratie sort « défigurée » de ces transformations, et peut-être affaiblie à jamais. C’est justement d’ailleurs ce qui fait susciter l’espoir pour Rawls, selon Catherine Audard, qu’un jour les démocraties, malgré les vicissitudes des temps et face aux autres formes de régimes, pourront toujours trouver la force de se relever et de s’adapter : L’expérience du mal de l’holocauste[4] et de la seconde guerre mondiale en particulier ont profondément marqué la pensée et l’œuvre de John Rawls. Elle l’a conduit à défendre « l’espoir raisonnable » que la culture politique des démocraties pourra leur permettre de résister au mal et à l’injustice que le totalitarisme et fascisme ont fait déferler sur elle. Si elles sont fragiles elles ont également en elles de quoi surmonter ces dangers (Catherine Audard, 2019, p.33).
Pour Rawls, l’utopie réaliste forme une possibilité réelle qui ne présente qu’une différence de degré avec sa possibilité. Grâce à un équilibre réflexif qui s’atteint par la discussion rationnelle, la possibilité empirique affecte la possibilité conceptuelle, et vice versa. En principe, quand l’utopie apparaît dans l’Histoire, sa caractéristique est toujours l’irréalisme. En provoquant un choc, elle suscite une prise de conscience qui est censée faire réformer les institutions politiques et sociales. L’histoire longue de la démocratie, de l’Antiquité à nos jours, doit nous inciter à mettre en perspective les menaces qui pèsent sur elle. Au regard de l’histoire, l’expérience démocratique est plurielle, non linéaire. Depuis son apparition, les crises ont constitué un moment de création politique mais aussi de recul des libertés et de creusement des inégalités. Chaque nation met la démocratie à l’épreuve et la façonne à son image. À propos de la France, Raymond Aron disait qu’elle est « immuable et changeante »[5]. Il en va de même pour la démocratie, tant celle-ci, depuis sa naissance, surprend par sa capacité à se transformer tout en restant fidèle à son projet d’instaurer le bien commun par l’émancipation des peuples comme des individus. La beauté, pour ainsi dire, de la démocratie est qu'elle est conçue pour s'autocorriger et il y a beaucoup de possibilités de renverser la tendance.
Les pathologies qui affectent les démocraties contemporaines retiennent de plus en plus l’attention des observateurs. L’opinion générale est que ces pathologies, loin d’être inhérentes à la démocratie elle-même, résultent d’une corruption de ses principes. Les observateurs les plus superficiels attribuent cette corruption à des facteurs ou des phénomènes extérieurs (on dénonce rituellement le fondamentalisme, le populisme, le communautarisme, la mondialisation, etc.), ce qui revient à mettre exclusivement en cause l’évolution des mœurs et les transformations de la société. C’est pourquoi, on peut comprendre l’inquiétude de Raffaele Simone en ces termes « cela faisait longtemps que j’avais l’esprit tracassé par le problème de l’instabilité tant du paradigme politique de la démocratie que des démocraties comprises comme systèmes de gouvernement de pays particuliers » (Raffaele Simone, 2016, p. 11). La démocratie, explique-t-il, repose sur une série de « fictions » la liberté
l'égalité, la souveraineté, la majorité qui vont contre la « politique naturelle » faite à base d'inégalité et de rapports de force. Mais avons-nous encore les moyens de domestiquer ces données ?
Notre objectif à travers cet article, est de faire une analyse approfondie sur les causes réelles ou supposées de la fragilité démocratique que le philosophe de Harvard avait déjà senties à son époque. Par exemple des causes comme la globalisation du monde, les technologies, les idéologies populistes et autoritaires feront objet d’analyses pour mieux comprendre cette situation périlleuse de nos démocraties contemporaines. Nous verrons également quelles peuvent être les perspectives pour l’avenir d’une telle démocratie. Comment un tel régime pourra-t-il s’harmoniser avec les préoccupations des différents peuples pour leur épanouissement ? Ceci parce que nous sommes convaincus que les régimes politiques ont des cycles de durée, mais le cycle démocratique ne serait pas, jusque-là, à son terme. C’est pourquoi les questions suivantes se posent, faut-il accepter sans réagir face à la multiplication des coups d’État en Afrique, la prolifération des démocraties « illibérales » en Europe, le triomphe des dictatures en Asie et en Amérique Latine ? Quel art politique faut-il pour les démocraties libérales de demain ?
1. Le péril démocratique dans la perspective rawlsienne
Rawls s’insurge contre l’expansion du capitalisme du laissez-faire qui ne garantit que la liberté formelle et rejette à la fois la valeur équitable des libertés politiques et l’équité des chances. Mais vise seulement l’efficacité économique et la croissance encadrée seulement par un minimum social assez bas (John Rawls, 1987, p.17). Autrement pour l’auteur, le capitalisme de l’État providence rejette également la valeur équitable des libertés politiques et il autorise des inégalités très importantes si bien que le contrôle de l’économie reste entre quelques mains (Catherine Audard, 2019, p.42). La démocratie[6] est un régime fragile, par essence qui ne peut tenir sans l’adhésion ou le consentement des gouvernés. Mais les phases historiques de la transformation sociale comme l’entrée de la Chine dans l’organisation Mondiale du Commerce (OMC), en accord avec la politique globalisation, a fourni aux puissances émergentes des ressources considérables. De plus en plus, nous devons faire face à des pays qui ne sont pas des démocraties, ce qui, en soi, n’est pas nouveau. Par contre, ces pays sont prospères, ce qui est inédit. Nous sommes donc dans une phase historique différente, où les démocraties doivent rivaliser avec des systèmes non-démocratiques qui sont aussi performants, voire plus, selon les registres de comparaison. C’est au regard de tout cela que John Rawls déclarait clairement que le capitalisme viole les deux principes de justice et menace les démocraties (Catherine Audard, 2019, p. 42). Ces pays non-démocratiques, enrichis par la globalisation, sont beaucoup plus puissants, et plus sûrs d’eux. Ils ont clairement une visée de redistribution du pouvoir à l’échelle du monde. L’action se mène par l’industrie et le commerce, mais aussi par l’influence sur les sociétés elles-mêmes.
Mais qu’est-ce que le capitalisme ? Il s’agit d’abord d’un système économique basé sur quatre éléments : la propriété privée des moyens de production qui amène une division de classe entre capitalistes et travailleurs ; l’exploitation du travail par le capital qui s’approprie un surplus de valeur ; la prédominance du marché comme mécanisme d’allocation des ressources et d’échange ce que Karl Marx a appelé’ ‘’le capital comme valeur qui se valorise dans le circuit de son existence’’; et enfin, une logique d’accumulation effrénée, où l’argent investi pour produire des marchandises sert principalement à générer un surplus de valeur dans une perspective d’accroissement infini. C’est pourquoi Nancy Fraser propose d’en élargir la définition comme un « ordre social institutionnalisé »[7]. La conséquence est que cette logique économique tend à générer de nombreuses crises par exemple, la surexploitation des ressources naturelles, l’augmentation des inégalités sociales, la sous-production de services publics, les crises financières, l’instabilité politique, l’impérialisme et les guerres, etc. C’est pourquoi pour lutter contre les injustices graves qui fragilisent les démocraties, l’éducation des citoyens et le rappel des principes constitutionnels sont les meilleures armes aux yeux de rawls. La justification de la démocratie constitutionnelle et la fondation des droits et des devoirs qu’elle doit respecter doivent faire partie de la culture politique publique et être débattues au sein de nombreuses associations de la société civile, en tant qu’élément de la formation et de l’éducation des citoyens avant leur entrée dans la vie politique. Or, il existe dans la culture politique, selon rawls, un non-dit concernant les principes constitutionnels, l’interprétation de la constitution, les droits et les devoirs qui en découlent, leurs fondements et leur justification (Catherine Audard, 2019, p.54) ; tout cela suscite des tensions et des crises. Autrement dit, pour le philosophe de Harvard, les démocraties sont fragiles comme dit précédemment, parce qu’elles ont besoin de l’allégeance et du consentement des citoyens et dépendent pour leur survie d’un consensus constitutionnel et politique durable et librement acquis, ce qui semble irréaliste en raison des graves conflits sociaux, économiques, idéologiques et politiques qui divisent les populations.
La démocratie est un régime fragile, par essence car elle ne tient pas sans l’adhésion ou le consentement des gouvernés. Ce constat d’une crise profonde de la démocratie est clair aux yeux d’Henri-Pierre Tavoillot qui estime qu’il existe aujourd’hui une triple déception à l’égard de son idéal. La démocratie libérale souffre d’une terrible crise de la représentation, d’une grave impuissance publique et d’un profond déficit de sens. Autrement dit, elle aurait perdu, en cours de route, à la fois le peuple qui la fonde, le gouvernement qui la maintient et l’horizon qui la guide (Henri-Pierre Tavoillot, 2011. P. 65).
Toute cette situation engendre justement la remise en cause de certains acquis démocratiques. Et l’on constate aujourd'hui que le « socle moral » de la démocratie vacille. Les régimes autoritaires comme les démocraties « illibérales » s'enracinent partout, « le racisme et la xénophobie, la misogynie comme l'antisémitisme, la désignation de l’autre comme "ennemis du peuple" etc. Il y a plus de vingt ans que le concept de démocratie illibérale a été forgé par le politologue américain Fareed Zakaria. Par ce concept, il faut entendre des gouvernements élus démocratiquement, mais qui ignorent les limites constitutionnelles à leur pouvoir et qui risquent de finir par déposséder les citoyens de leurs droits et libertés. En d’autres termes, ce sont des dirigeants élus qui ne respectent pas les limites de l’État de droit. L’émergence de la démocratie illibérale est de prime abord un phénomène difficile à saisir parce que démocratie et libéralisme ont longtemps été associés. Démocratie signifiait démocratie libérale, c’est-à-dire un régime dans lequel non seulement les élections sont libres et équitables, mais où règnent aussi l’État de droit, la séparation des pouvoirs et règles qui protègent les libertés fondamentales. Sans le cadre du libéralisme constitutionnel, la démocratie est fragile, c’est pourquoi Fareed Zakaria estime qu’il n’y a plus d’alternative crédible à la démocratie aujourd’hui et le XXI siècle sera le siècle des problèmes au sein de la démocratie ; le vote démocratique donnant une grande légitimité aux gouvernements illibéraux.
Dans ce cas, comment faire pour rétablir l’alliance entre démocratie et raison, étant entendu que cette alliance est la seule capable, pour Rawls comme pour Catherine Audard, de garantir la liberté et la justice ? Si la démocratie ne se porte pas très bien, c'est aussi parce que la raison elle-même est malade, infectée par l’opinion, l’émotion, les passions tristes, le ouï-dire, l’indifférence, à la vérité, ou l’irréfrénable pulsion à tout dire sur tout même quand on ne sait rien, qui rendent « indécidables » le dialogue rationnel et l'échange public dont, justement, se nourrit la démocratie aux yeux de ces deux auteurs (Catherine Audard, 2019). En fait, selon Rawls, le système institutionnel le plus juste serait ce qu'il appelle « la démocratie de propriétaires », qui postule une large répartition de la propriété de la richesse et du capital et qui ne permet pas qu'une petite partie de la population contrôle l'économie et, indirectement, la vie politique. L'intention n'est pas seulement d'aider ceux qui subissent des pertes lors d'accidents ou d'infortunes (même si cela doit être fait), mais plutôt de placer tous les citoyens en position de s'occuper de leurs propres affaires sur la base d'un degré approprié d'égalité économique et sociale. En fait, Rawls s’est assigné un objectif encore plus ambitieux, il s’agit en effet de trouver le fondement d’une société parfaitement consensuelle (le consensus d’unanimité) grâce à un accord quasi général sur des principes de justice distributive équitables et légitimes. Ceci parce que le combat pour les sociétés est, celui pour le respect de la dignité humaine et l’égalité des droits fondamentaux c’est ce qu’Axel Honneth avait parfaitement exprimé en parlant de lutte pour la reconnaissance (Axel Honneth, 2013). Pour Honneth, si c’est à travers les relations affectives que l’enfant acquiert la confiance en soi qui lui permet de se considérer comme un être de besoins, et à travers les relations juridiques que la personne acquiert le respect de soi qui lui permet de se considérer comme responsable de ses actes, c’est dans les relations de solidarité et au sein de la division sociale du travail que l’individu parvient à l’estime de soi qui lui permet de se concevoir comme un individu utile socialement.
2. L’effondrement de la démocratie face à la montée des régimes autoritaires
Nos démocraties semblent incapables de recréer de la croissance, de garantir le maintien des acquis sociaux, de protéger des dangers venus d’ailleurs (l’insécurité, le terrorisme), d’intégrer les innombrables laissés pour compte (les inégalités socioéconomiques), que sont les femmes, les nouveaux venus, et tant de jeunes issus de milieux ou de territoires délaissés. Elles semblent incapables de garantir aux citoyens les certitudes dont ils ont besoin, pour ne pas avoir le sentiment que les élites politiques bénéficient de privilèges, pour elles et leurs enfants, dont sont à jamais exclus les classes moyennes, qui se vivent en voie de prolétarisation. Dans de nombreux pays africains, le mot « démocratie » est devenu synonyme de « colonialisme » ou « d’impérialisme occidental » et bien des pays prétendent y être. Dans aucun pays du monde, la démocratie n’a réussi à réduire les inégalités éducatives, à mettre en place un système de santé efficace pour tous, et plus généralement à tenir compte de l’avis des gens pour l’essentiel de ce qui les concerne et à gérer d’une façon libre et lucide les biens collectifs qui sont supposés être sous la responsabilité de tous. Avec la montée des inégalités socio-économiques, la perte de confiance envers les institutions, l’émergence des populismes autoritaires, la circulation accélérée de la désinformation et la polarisation des débats en ligne, la démocratie est aujourd’hui confrontée à de multiples crises. Tel est le point de vue de Robichaud et Turmel qui soutiennent que la démocratie va mal. Un peu partout dans le monde, elle est attaquée dans ses principes et ses institutions. La société démocratique elle-même semble en proie à une méfiance généralisée : des citoyens aux idées différentes se perçoivent de plus en plus entre eux comme des ennemis à combattre plutôt que comme des partenaires à convaincre. Même le soutien populaire dont notre régime politique a longtemps joui paraît aujourd’hui s’amenuiser. (Robichaud et Turmel, 2020, p. 15)
La démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale, indépendamment des différences culturelles, politiques, sociales et économiques. Un tel idéal repose sur l'existence d'institutions judicieusement structurées et qui fonctionnent ainsi que d'un corps de normes et de règles, et sur la volonté de la société tout entière, pleinement consciente de ses droits et responsabilités. Ces institutions démocratiques ont pour rôle d'arbitrer les tensions et de maintenir l'équilibre entre ces aspirations concurrentes que sont la diversité et l'uniformité, l'individuel et le collectif, dans le but de renforcer la cohésion et la solidarité sociales. Mais l’érosion de la démocratie n’est pas nouvelle en Afrique comme dans d’autres sociétés occidentales, on constate depuis plusieurs années un déclin de la confiance envers les institutions et les élites, ainsi qu’un effritement de la satisfaction à l'égard de la démocratie. L'Afrique de l’Ouest par exemple a été frappée par une série de coups d'État qui menacent de la ramener aux années 1980 et à l'ère des régimes militaires. Le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, le Soudan et le Mali ont tous vu leur gouvernement renversé et remplacé par une junte militaire. La principale cause de cette instabilité est la recherche de solutions idoines face à la lutte contre le terrorisme qui sème la désolation dans ces zones. Un tel phénomène est destructeur des droits et des libertés humaines, mais également l’une des figures majeures de la menace contemporaine avant d’être hissé, au rang de menace stratégique pour la paix et la sécurité collective en Afrique. C’est l’un des grands fléaux de notre temps en ce qu’il est une dénégation de l’humanité. L’objectif des actes terroristes est double, la simple destruction de vies humaines, objectif immédiat mais non suffisant, ce qui aboutit à un « dérèglement politique et social, à une corrosion du support étatique, à une perte de légitimité des gouvernants telle ce qui remet en cause les structures mêmes de l’État et de la société et, par-là, la destruction de l’idéal démocratique (Arnaud Blin, 2006)[8].
L'indice de la démocratie est basé sur 60 indicateurs, regroupés en cinq catégories : processus électoral et pluralisme, libertés civiles, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture politique. La note, sur une échelle de zéro à dix, correspond à la moyenne de ces cinq scores. Les pays sont ensuite classés en quatre types de régimes, en fonction de leur score moyen : les démocraties pleines, les démocraties défaillantes, les régimes hybrides et les régimes autoritaires.[9] En 2021, le niveau de démocratie dont bénéficie l’individu moyen dans le monde est comparable à celui de 1989. Cela signifie que les acquis démocratiques des 30 dernières années ont été fortement réduits. L’année dernière, près d’un tiers de la population mondiale vivait sous un régime autoritaire. Et le nombre de pays qui tendent vers l’autoritarisme est trois fois supérieur à celui des pays qui tendent vers la démocratie[10]. Patrice Rolland estime dans cette même perspective que :
Si la démocratie est cette société qui veut l'égale liberté de tous ses membres, elle a des ennemis comme toute société humaine. Ils sont, en première approche, de deux sortes. L'ennemi (externe) s'attaque à elle en tant qu'elle constitue une entité historique particulière, c'est-à-dire une société qui se définit par des différences physiques visibles : territoire, richesses, langues, mœurs, religion, etc. L'ennemi est donc ici essentiellement quelqu'un de différent, autrement dit celui qu'on peut aisément qualifier d'étranger (ou de rallié à l'étranger). Quant à l'ennemi interne, il s'attaque aux principes de la démocratie. (Patrice Rolland, 1993, pp.121-135).
C’est pourquoi l’auteur soutient que « la prudence, ou pour tout dire, la modération avec laquelle la démocratie doit se comporter face à ses ennemis, vient de ce qu'elle sait qu'elle peut avoir affaire à ses propres enfants » (Patrice Rolland, 1993, pp.132-134). Dans les mêmes perspectives, Pierre-Henri Tavaillot soutient que : La démocratie détruit toutes les médiations susceptibles d’empêcher le règne de la force brute : celle de la vérité, celle des honneurs et, même, celle (pourtant bien peu noble) de l’argent. En égalisant toutes les conditions et en aplatissant tout ce qui a de la valeur, elle fait donc le lit de la tyrannie. C’est là le comble de la décadence : le tyran naît du terreau démocratique, condamné à la fois à flatter le peuple et à s’en faire craindre (Pierre-Henri Travoillot, 2011. p.33).
Dans le paysage de la réflexion politique, l'article de Patrice Rolland fait exception encore aujourd'hui, quand on observe l'évolution générale de nos sociétés modernes depuis un bon quart de siècle, on constate une mutation profonde quant à la façon de penser et de vivre la liberté. En dépit de ses idées simples, le populisme a trouvé son heure, car le contexte est celui d’une crise profonde de la démocratie représentative. En effet, certains observateurs notent que sous les coups de boutoir de la défiance politique qui ne cesse de monter, la démocratie n’apparaît plus toujours comme un avenir désirable, et même certains appellent de leurs vœux le retour de « l’homme fort ». Le rejet de la politique, le sentiment de dépossession politique ou encore le rejet des partis peuvent être autant d’étapes pour un retour des régimes autoritaires. Dans cette perspective, David Robichaud et Patrick Turmel estiment que : La démocratie va mal. Menacée par l'accroissement des inégalités socioéconomiques, la manipulation de l'opinion publique et la montée d'un certain populisme aux relents autoritaires, elle parait d'autant plus fragile que l'on participe souvent soi-même à son érosion, sans s'en rendre compte. Mais comme toute chose complexe dont il est difficile de comprendre le fonctionnement, il ne sera pas aisé de la réparer, une fois qu'elle aura été brisée pour de bon. La démocratie vise pourtant un idéal qui mérite d'être vigoureusement défendu : l'égale liberté politique des citoyens. (David Robichaud et Patrick Turmel, 2012)
Il y a, dans la notion de démocratie, à la fois l’idée des droits et des libertés, qui impliquent la dignité éminente du citoyen (version politique de la personne), et l’idée de la délibération, du débat, de la recherche commune des meilleures lois, et donc de l'intelligence collective dans ce qu’elle a de plus élevé : la visée d’une règle juste, impartiale, universelle. En somme la démocratie contient à la fois l’idée de la liberté et celle de l'intelligence collective. Or le cyberespace offre, lui aussi, une liberté d'expression et de navigation dans la sphère informationnelle infiniment plus grande que tous les autres médias antérieurs, en même temps qu'un outil sans précédent d'intelligence collective. On pourrait dire que les destins de la démocratie et du cyberespace sont intimement liés parce qu'ils impliquent tous deux ce qu'il y a de plus essentiel à l'humanité : l'aspiration à la liberté et la puissance créative de l'intelligence collective (Pierre Lévy, 2002, p. 33). Toutefois une des menaces bien plus dangereuse et largement sous-estimées plane sur la démocratie moderne, c’est le contrôle absolu des plateformes sociales sur le lien entre les citoyens et leurs élus. C’est l’un des grands impacts de l’ère numérique, la démocratie elle-même est de plus en plus médiatisée par la « propriété privée » des réseaux sociaux. Les élus écoutent de plus en plus leurs électeurs et interagissent directement avec eux par le biais des réseaux sociaux. Comme ces plateformes servent de plus en plus de médiateur pour la compréhension du public des enjeux nationaux et des événements mondiaux, des entreprises comme Twitter et Facebook définissent non seulement la réalité elles-mêmes, mais déterminent qui est autorisé à parler à son gouvernement et ce qu’il est autorisé à dire.
3. Le futur de la démocratie en question : quelles perspectives face aux régimes rivaux ?
Ce n’est pas facile de penser le futur de nos démocraties dans un monde traversé par des crises qui s’entremêlent (écologique, climatique, technologique, sécuritaires etc.). Comme l’a signifié Jean-Jacques Rousseau, s’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Ainsi s’exprime Rousseau, de manière lapidaire, dans Du contrat social. La « perfection » à laquelle il fait allusion découle du fait que l’hypothèse démocratique exige certaines vertus portées à leur degré le plus haut. Il en dresse également une liste : « une grande simplicité de mœurs », « beaucoup d’égalité dans les rangs et les fortunes », « peu ou point de luxe ». La mise en garde de Rousseau est instructive, car entre les mains d’êtres dominés par des passions égoïstes, la démocratie est fragile, tant il est vrai qu’elle a subi de nombreuses fois des bouleversements catastrophiques et qu’elle a été la cause de sa propre ruine. Mais un espoir reste toujours possible, aux yeux de Pierre Lévy pour qui, le perfectionnement de l'intelligence collective qui suppose la liberté est le produit et le sens de l'évolution culturelle. Et c'est exactement pour cette raison que les régimes de liberté intellectuelle et politique finiront par l'emporter sur les régimes de dictature et d’étouffement des pensées. Il est d’ailleurs facile d'observer aujourd’hui que les performances des dictatures sont mauvaises dans la plupart des domaines[11]. (Pierre Lévy, 2002, p.16).
Issue de la philosophie des Lumières, la démocratie libérale est, en son sens propre, une idéologie du respect de la personne humaine, d’abord dans ses droits et ses choix fondamentaux, puis récemment dans sa dignité. Rationaliste et humaniste, elle lui fait confiance, jusque dans ses erreurs ; si bien que la grossièreté des essais démocratiques loin d’inciter à la fermeture du jeu démocratique, devrait plutôt le laisser ouvert. C’est pourquoi, dans un titre à grand succès, Fukuyama a cependant choisi de présenter la démocratie libérale sous un autre angle, fermé, celui de l’aboutissement de l’« évolution idéologique de l’humanité » (F. Fukuyama, 1992). Toutefois, les démocraties sont actuellement à un tournant, soumises à des pressions croissantes internes et externes. Les plus grands défis de gouvernance publique auxquels les pays sont confrontés aujourd’hui pour préserver et renforcer leurs démocraties, sont de lutter contre la mésinformation et la désinformation, améliorer l’ouverture des administrations, la participation et la délibération des citoyens, assumer des responsabilités mondiales et renforcer la résilience face à l’influence étrangère.
Pierre Henri Tavoillot, explique que la démocratie n’est pas à la portée du premier venu, puisqu’elle est un régime compliqué et exigeant. Et pour ceux qui ne veulent pas faire des efforts, la dictature est toute conseillée, après tout se soumettre est très simple agir comme on a toujours fait est une évidence ; obéir à un chef dont la personne apparaît irradiée par la transcendance ne pose pas de problème (Pierre Henri Tavoillot, 2019, p. 58). Autrement pour l’auteur, le peuple de la démocratie doit constamment se façonner comme peuple pour la démocratie, parce que l’art politique n’a jamais été aussi difficile qu’en démocratie qui est une manière de gouverner et une façon de faire le peuple. Selon le pont de vue de Rawls, la démocratie est donc constituée, non seulement par un ensemble d’institutions, mais aussi et surtout par une culture politique sans laquelle ces institutions restent insuffisantes et la volonté politique ne peut se développer, car « l’existence de la volonté politique dépend de la culture politique d’une société » (Catherine Audard, 2019, p. 53). Oui, la démocratie n’est pas simplement l’élection cyclique de représentants. C’est une chose extrêmement complexe qui a comme fondements l’égalité citoyenne et l’égalité politique. C’est au regard de toutes ces raisons qu’il convient de former ou d’éduquer la masse populaire sur le sens profond de l’idéologie de la démocratie, qui n’est pas une dimension du colonialisme, mais une forme très ancienne de gouvernement fondée sur l’arbre à palabre, le débat, et la recherche du consensus, sans peur ni contrainte, qui trouve sa source dans les traditions indiennes et africaines autant que dans les pratiques grecques. Pratiquement, c’est un régime fondé réellement sur la liberté beaucoup plus efficace, même pour protéger les gens des dangers immédiats, ou d’un envahissement imaginaire par des migrants, qu’un régime fondé sur la crainte.
Pour y parvenir, il faudrait que, dans chaque collectivité humaine, les dirigeants[12] soient choisis sur leurs capacités à comprendre les mouvements du monde et à en avoir une vision futuriste pour incarner la grandeur commune, à dire la vérité, à ne pas flatter les plus bas reflexes, à écouter, à respecter, à apprendre, à changer d’avis, à faire confiance, à aider, à encourager, à s’émerveiller, à admirer, avec humilité et empathie. Les pays qui réussiront à choisir durablement ce genre de dirigeants retrouveront le chemin de la croissance et de la sérénité. [13] C’est pourquoi on peut se demander si le peuple est toujours à la hauteur pour opérer un tel choix judicieux de bons dirigeant au regard de la pertinence de leurs programmes vis-à-vis de ses aspirations et projets de vie futurs. Par exemple selon Tavoillot, lors de l’élection américaine de 1992 (Georges Bush contre B Clinton), seuls 15% des électeurs savaient que les deux candidats étaient favorables à la peine de mort, mais 86% connaissaient le nom du chien de G. Bush (Pierre-Henri Tavoillot, 2011, p. 125). C’est pourquoi il semble nécessaire pour la survie de la démocratie de donner des voix supplémentaires aux diplômés du supérieur et à ceux qui exercent un métier exigeant des facultés intellectuelles particulières au regard de l’ignorance manifeste de certains citoyens sur les points essentiels des programmes électoraux. Selon la perspective du même auteur, il convient d’instaurer une démocratie plus électorale, plus délibérative, plus participative qui permettrait un contrôle (morale, juridique, économique et politique) accru des gouvernants par les citoyens. Bref, une démocratie plus démocratique participative, voire « radicale » : là serait le salut (Pierre-Henri Tavoillot, 2011. p.66).
Conclusion
La démocratie va-t-elle bien ? À une telle question, on ne saurait répondre par oui ou par non. D’un côté, on peut dire que la démocratie se porte bien. Depuis les années 1980, un grand vent de démocratie a soufflé sur la planète. Les régimes autoritaires de l’Amérique latine ont quasi disparu. Le camp communiste s’est effondré et tous ces pays se réclament aujourd’hui d’une démocratie minimale. Plus timidement, l’Afrique et l’Asie se sont ouvertes à certains pans de la démocratie. C’est ce que Francis Fukuyama a appelé « la fin de l’histoire »1. C’est-à-dire la victoire, du moins idéologique, de la démocratie libérale ; elle aurait vaincu ses ennemis (le fascisme, l’autoritarisme, le communisme). Par ailleurs, il ne faut pourtant pas être un observateur trop fin de la vie politique pour comprendre que la démocratie va mal. Parfois même en raison de ses succès. On notera dans un premier temps le déclin de confiance dans les institutions de la démocratie représentative, ce que plusieurs spécialistes ont nommé la « crise de la représentation ». Méfiance, scepticisme, envers les partis politiques dont le nombre des adhésions ne cesse de décliner dans les dernières décennies, comme d’ailleurs en général la faible participation électorale (le vote), notamment chez les jeunes. La vieille démocratie représentative est accusée de tous les maux : corruption, copinage, inefficacité, insipidité. C’est pourquoi Catherine Audard soutient que les démocraties libérales et constitutionnelles sont fragilisées et en retrait dans le monde, et l’équilibre entre justice et liberté sur lequel elles reposent est menacé (Catherine Audard, 2019, p. 18).
La vague de populismes qui traverse nos démocraties est le symptôme aigu de cette crise de la représentation : rejet des élites politiques, exaltation du peuple, méfiance envers les institutions. Pierre Rosanvallon a nommé « contre-démocratie » cette démocratie de la méfiance et de la défiance. Mais la démocratie de la défiance, précise-t-il, souffre d’un « déficit politique », elle est même « antipolitique » dans le sens qu’elle vise moins à gouverner les humains qu’à prendre une distance par rapport au gouvernement des humains. Puisque considérer la défiance comme une forme de la souveraineté risque en effet constamment de dissoudre la légitimité populaire dans un nihilisme du mécontentement, ou une « démocratie faible » et négative (Pierre Rosanvallon, 2006, p. 257). Cette perte de confiance envers les institutions qui sont à la base de la démocratie, s’accompagne aussi d’un affaiblissement réel de la puissance d’agir des gouvernements nationaux face à l’accélération de la mondialisation, à la montée des inégalités entre nations et entre peuple d’une même nation. Nous avons également la force du marché mondial et des traités qu’il suscite qui dictent aux États la marche à suivre au détriment des instances démocratiques elles-mêmes. Toutefois, la même démocratie est quelque chose de paradoxal, de contradictoire, certains signes de vitalité sont parfois ses faiblesses, au contraire, certains signes de faiblesses sont parfois ses forces. De tout ce qui précède, nous pouvons, sans risques de nous tromper, soutenir que la démocratie va mal. Chaque nation met la démocratie à l’épreuve et la façonne à son image, ainsi depuis sa naissance, elle surprend par sa capacité à se transformer tout en restant fidèle à son projet d’instaurer le bien commun par l’émancipation des peuples comme des individus.
Bibliographie
Aron Raymond, 1959, Immuable et changeante. De la IVe à la Ve République, Paris, Calmann-Lévy.
Audard Catherine, 2019, La démocratie et la raison, actualité de John Rawls, Paris, Grasset.
David Robichaud et Patrick Turmel, 2020, Prendre part considérations sur la démocratie et ses fins, Quebec, Atelier 10.
Fukuyama Francis, 1992, Le Dernier Homme et la fin de l’histoire, Paris, Flammarion.
Gauchet Marcel, 2002, La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard.
Honneth, Axel 2013, Un monde de déchirements, Théorie critique, psychanalyse, sociologie, trad. Pierre Rusch & Olivier, Paris, La Découverte.
Lévy Pierre, 2002, Cyberdémocratie. Essai de philosophie politique, Paris, Odile Jacob.
Levitsky Steven et Ziblatt Daniel, 2019, La mort des démocraties, Paris, Calmann-Lévy.
Müller Jan-Werner, 2016, Qu’est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, Trad. par F. Joly, Paris, Éd. Premier parallèle.
Nancy Fraser, 2018, Derrière « l’antre secret » de Marx. Pour une conception élargie du capitalisme, trad. Édouard Delruelle, Valérie Bada,Paris, Les Temps Modernes.
Rawls John, 1987, Théorie de la justice, trad. C. Audard, Seuil, Paris.
Rolland Patrice, 1993, La démocratie et ses ennemis. La pensée politique, Gallimard Le Seuil.
Rousseau Jean-Jacques, 2001, Du contrat social, Paris, GF-Flammarion.
Rosanvallon Pierre, 2006, La contre-démocratie, la politique à l’âge de la défiance. Paris, Seuil.
Tavoillot Pierre-Henri, 2011, Qui doit gouverner une brève histoire de l’autorité, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle.
Tavoillot Pierre-Henri, 2021, Comment gouverner un peuple roi ? Traité nouveau d’art politique, Paris, Odile Jacob.
[1] Quand Winston Churchill prononce cette phrase, il n'est pas, comme on pourrait le croire, le dirigeant tout-puissant d'une démocratie britannique qui a gagné la seconde guerre mondiale face aux dictatures, mais un leader déchu : il la lance en effet le 11 novembre 1947 a la chambre des communes alors qu'il n'est plus « que » leader de l'opposition, après avoir été, a la surprise générale, largement battu lors des législatives de juillet 1945 par le travailliste Clément Attlee. Il reproche alors a un gouvernement qui s'enfonce dans l'impopularité de chercher a diminuer les droits du parlement en amenuisant le pouvoir de veto de la chambre des lords, la deuxième chambre du parlement.
[2] Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, La mort des democraties, paris, calmann-levy, 2019.
[3] Le populisme représente un ensemble de postures politiques critiquant la démocratie, au moins ses élites non représentatives, souvent corrompues, aux yeux de ceux qui défendent ces visions des choses et qui ne reconnaissent la citoyenneté de leur pays qu'à une partie déterminée de sa population. L’aspect le plus important pour définir un populiste est son attachement à se considérer comme le représentant du « vrai peuple », c’est-a-dire comme le représentant légitime de la majorité silencieuse. Mais qu’est-ce que le « vrai peuple » ?
[4] D’un certain point de vue, l’Holocauste consiste à mettre l’accent sur le devoir de mémoire, au détriment du devoir d’oubli. Il revient donc à se priver du meilleur moyen de mettre fin aux guerres.
[5] Raymond Aron, Immuable et changeante. De la IVe à la Ve République, Paris, Calmann-Lévy, 1959.
[6] La démocratie est la procédure, dans sa version représentative, par laquelle les gouvernés gouvernent, désignent et sanctionnent les gouvernants. Cependant, elle est aussi un régime politique particulier marqué par l’instauration d’un espace de médiation entre la société civile et l’État qui favorise par le débat contradictoire, l’émergence d’une opinion publique. Elle place l’origine du pouvoir politique dans la volonté collective des citoyens et repose sur le respect de la liberté et de l’égalité de ceux-ci.
[7] Fraser, Nancy (2018), Derrière « l’antre secret » de Marx. Pour une conception élargie du capitalisme, trad. Édouard Delruelle, Valérie Bada,Paris, les temps modernes, p. 55-72.
[8]Arnaud Blin, 2006, 11 septembre 2001, la terreur démasquée entre discours et réalité, Paris, Chez le Cavalier Bleu.
[10] La désinformation est utilisée comme un outil par les gouvernements autocratiques pour façonner l’opinion nationale et internationale. Elle alimente les discours de haine à l’encontre des personnes marginalisées et exclues, et porte atteinte à notre humanité commune.
[11] Les défaites historiques des monarchies de droit divin, du nazisme, du totalitarisme stalinien et d’autres dictatures devant les démocraties ne sont pas le fruit d’un simple hasard historique. La puissance ultime se trouve du côté de la liberté, non du côté de l'oppression.
[12] L’élection est un travail de cueillette et tri. Eligere qui signifie d’abord « cueillir » et cueillir, c’est savoir choisir, soit le plus beau (fleur), soit le plus comestible (fruit ou légume). Comment donc savoir cueillir (choisir) le meilleur dirigeant en démocratie ?