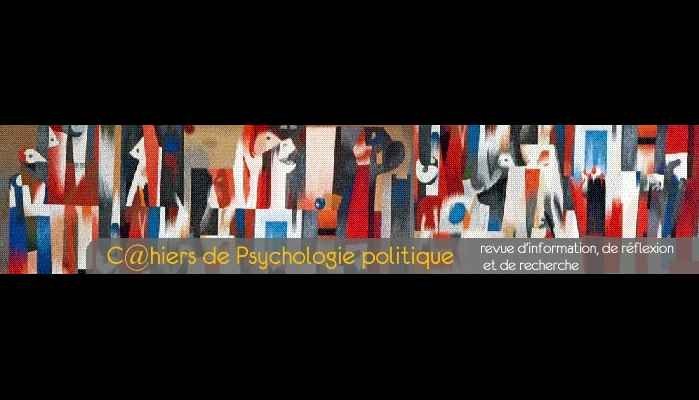Côte d’Ivoire, crise de l’interprétation et tradition républicaine
Paul-Hervé Agoubli est enseignant chercheur à l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Il est analyste politique et secrétaire général du mouvement Objectif République dont la devise est : Être humain et citoyen.
Introduction
En 2020, la légitimité de la troisième candidature d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle ivoirienne divisait l’opinion publique et la classe politique, les séparant en deux blocs antagonistes irréconciliables. D’une part, les contempteurs d’un projet inconstitutionnel à rebrousse-poil de l’histoire politique africaine des vingt dernières années[1] ; et d’autre part, les apologistes d’une candidature circonstancielle[2] et/ou juridiquement motivée par le principe de la non-rétroactivité de la loi, entre autres[3]. Pour ces derniers, la nouvelle constitution votée en 2016 donnait le droit au président de la République sortant, du fait d’une tabula rasa subséquente, de briguer des mandats nouveaux. L’analyse des postures laisse de fait apparaître une double crise discursive : premièrement, celle de l’interprétation du droit ; et deuxièmement, celle de la valeur de la parole politique. La crise de l’interprétation postulée met ainsi en scène des traditions intellectuelles et militantes qui tiennent un point d’attache épistémologique avec l’herméneutique. Or du point de vue de l’herméneutique juridique, l’interprétation est un horizon ouvert jusqu’à échéance de l’autorité de la chose jugée, seuil indépassable[4]. Dans le cas de la présidentielle ivoirienne, la charge de cet épilogue, manifestement le dernier mot du dissensus est revenu au président du Conseil Constitutionnel certes, de droit ; mais en réalité au chef de l’Etat lui-même, de fait. On retient chez l’un, sa remarque sur la disqualification du citoyen pour prendre part au débat constitutionnel ; et chez l’autre, sa revendication d’une compétence universelle, donnant à sa lecture du droit une primauté sur toutes les parties prenantes au débat. Donc, ici comme là s’est affirmé en filigrane un ordre politique, qui, au-delà de la lettre de la constitution, a toujours gouverné la pratique institutionnelle ivoirienne en réalité. Cet ordre des choses interroge le principe même de souveraineté : qui, en Côte d’Ivoire, est titulaire de la souveraineté ? Comment s’exprime dans les faits le principe républicain assis sur la délégation de mandat, sur la vectorisation du pouvoir du peuple vers l’Etat ? Comment le système énonciatif permet-il de lire la praxis politique ivoirienne ?
La séquence électorale d’octobre 2020 repose en réalité une problématique d’ordre génétique. Ce qui est en cause, en effet, c’est l’ADN même de l’Etat ivoirien généré par l’entreprise coloniale et dont le mimétisme postcolonial a entretenu la logique de régimes en régimes. D’un point de vue énonciatif d’abord puis en analysant la tradition politique, la logique herméneutique qui en découle, nous verrons ce que le personnel politique ivoirien entend de la souveraineté contenue dans le principe républicain pour interroger in fine la qualité du projet républicain lui-même.
I/ Idée de la république en Côte d’Ivoire, partir de l’énonciation
L’expression verbale de la pensée est un attribut majeur de la condition humaine. Son analyse revêt un intérêt pratique indéniable du triple point de vue scientifique, social et politique. Cette analyse, en permettant de comprendre le fait de langue (la phrase ou l’énoncé, la parole, le texte) résulté de la capacité du langage du sujet parlant, remet au centre du jeu le contexte de la production verbale. Sans la prise en compte du contexte, l’appréhension claire du produit énonciatif n’est pas possible. C’est à cet égard que l’énonciation se révèle décisive. Son objet est de remplir le rôle d’éclaireur de l’exploit phrastique, discursif et/ou textuel dans le système de la communication verbale. L’un de ses postulats théoriques, comme le rappelle Marion Colas-Blaise, « … fait… état d’un triple « conditionnement », logique, psychologique et linguistique, de l’énonciation de la pensée.[5] » Pour en voir la manifestation, il faut tenir compte de la situation de communication qui rassemble le locuteur et son allocutaire agissant l’un sur l’autre dans le cadre d’une activité énonciative elle-même douée de signification. Par conséquent, pour Pierre Larthomas, « Enoncer, c’est, pour un être humain, transmettre par la voix ou par écriture, une ou des informations à l’adresse d’un autre ou d’autres êtres humains, dans un idiome particulier, en fonction de circonstances données et dans un but déterminé.[6] »
Le rappel des facteurs circonstanciels, voire co ou con-textuels alerte sur le sens de l’objet généré par l’acte d’énonciation : c’est l’énoncé. Nécessairement motivé, l’énoncé est un avatar, c’est une interface. De là provient la distinction majeure entre la phrase et l’énoncé au sens où l’« … énoncé doit avoir été dit ou écrit pour communiquer, alors que la phrase peut n’être qu’un exemple de grammaire, parfaitement abstrait et hors de situation. [7]» A l’abstraction de la phrase répond la motivation de l’énoncé lequel en s’inscrivant parfaitement dans la dynamique (énonciation) dont il est le produit traduit une réalité linguistique, psychologique, voire culturelle ainsi mis en évidence. Phrases et énoncés vectorisent un ordre intra ou extra grammatical qui déterminent ou le sens immédiat ou la/les signification(s) appelée(s) par le produit verbal généré. De cela, l’étude dirigée par Martin Riegel donne une lecture détaillée permettant de comprendre les subtilités séparant la phrase et l’énoncé et surtout les attentes que peut formuler l’analyste selon qu’il se trouve en face de l’une ou de l’autre. Pour les spécialistes donc,
Une phrase produite et interprétée dans des conditions ordinaires acquiert une signification énonciative (ou contextuelle) qui intègre tous les aspects significatifs liés à la situation de com- munication. Or, nous employons indifféremment les termes sens, signification et signifier pour analyser et caractériser ces deux niveaux de signification.
En effet, la question Que signifie la phrase P ? s’entend en deux sens différents bien qu’étroitement interdépendants :
• Dans une première acception, elle se paraphrase par : Que veut dire la phrase P ? La question porte ici sur le sens intrinsèque de la phrase, déterminé́ à l’intérieur de la langue et abstraction faite de tout emploi particulier. C’est son sens phrastique…, qui peut être rendu par une paraphrase en termes d’équivalences exclusivement lexicales et syntaxiques. Pour le décrire, il suffit d’associer à la phrase une glose qui ne comprend aucun élément d’information contextuelle ou situationnelle. Par exemple, l’énoncé (2) Ta chambre n’est pas rangée, aura le sens phrastique : Il règne un certain désordre dans la pièce où couche le destinataire.
• Dans la deuxième acception du verbe signifier, la question Que signifie la phase P ? se paraphrase par Que veut dire celui qui énonce la phrase P ? La question concerne alors les énoncés correspondant à la phrase P, dont la signification varie avec les situations où ils sont proférés. Ainsi, selon les circonstances, (2) sera interprétée comme l’expression d’une constatation, d’un reproche, d’un conseil (Tu devrais ranger ta chambre) ou encore d’un ordre (Range ta chambre).[8]
Suivant cette logique, on analysera deux importantes prises de parole de la séquence électorale d’octobre 2020 qui ont eu pour effet, d’une part de décider du sort du débat démocratique, et d’autre part, de clore le chapitre électoral. En effet, la joute verbale à laquelle a donné lieu l’interprétation de la constitution de 2016 dans le cadre de la présidentielle d’octobre 2020, a été ponctuée par deux déclarations qui méritent qu’on y accorde un intérêt particulier eu égard à l’autorité politique, institutionnelle et scientifique revêtues ou revendiquées par leurs auteurs : les énonciateurs. La perspective énonciative d’après laquelle ces déclarations sont considérées traduit l’état d’esprit d’une partie considérable du personnel politique ivoirien et fait sens du côté de la pratique républicaine elle-même. D’une part, le propos d’Alassane Ouattara le 17 août 2020 alors qu’il recevait une délégation constituée de "cadres" et de chefs de villages des régions du sud et de l’est de la Côte d’Ivoire ; et d’autre part, l’allocution du président du conseil constitutionnel lors de la prestation de serment du chef de l’Etat.
Enoncé 1 :
Je ne voudrais pas rentrer dans ces faux débats de constitution. La constitution est votée par le peuple, et qui a proposé la constitution ? C’est bien Alassane Ouattara, pour la 3e république. Donc, qui peut… se targuer de connaître cette constitution mieux que moi ? Qui a signé le décret pour envoyer la constitution, pour la soumettre au vote des Ivoiriens ? C’est moi ; alors les gens, ils peuvent bavarder…[9]
Enoncé 2 :
Excellence Monsieur le Président de la République Côte d’Ivoire (Sic) !
Nous voici au terme d’un processus électoral qui a fait couler beaucoup d’encre, de salive, de larmes et même, hélas ! Beaucoup de sang.
Il en a été ainsi parce que, un débat fondamentalement juridique et d’une technicité suffisamment pointue pour diviser, même les spécialistes de cette matière, a quitté son domaine naturel, le droit, notamment le droit constitutionnel, pour investir un autre champ et devenir, de ce fait un débat politique. Chacun y est donc allé de son interprétation, depuis les Professeurs titulaires de la chaire de droit constitutionnel, jusqu’à ceux qui ne possèdent comme seul diplôme, que leur acte de naissance.[10]
Le premier énoncé est une démonstration syllogistique reposant sur un argument d’autorité. Alors que dans le principe de l’énonciation constitutionnelle – « Nous, peuple de Côte d’Ivoire » –, la constitution a un énonciateur unique : le peuple, « l’introuvable [11]», le propos tenu par le chef de l’Etat ivoirien le détermine (l’énonciateur) dans une autre figure. Il s’opère dès lors un basculement qui substitue le locuteur, un ou des locuteurs potentiels, à l’énonciateur principal. C’est ainsi que le chef de l’Etat, le locuteur, le gardien selon la formule, devient, en se prévalant au passage de la qualité de constituant, l’énonciateur à la place du « Nous » collectif où s’origine la parole constitutionnelle. Le « Nous » de la constitution est ainsi relégué à un rôle passif : il vote. Cette passivité est soulignée par le second énoncé où la logique capacitaire pour ne pas dire aristocratique est rappelée brutalement au citoyen. Celui-ci aurait voté, approuvé un objet, ici des dispositions constitutionnelles, auxquelles il n’aurait rien compris. Comment cela est-il possible ? Comment l’acte positif, le vote, peut-il ainsi violemment déboucher sur une conséquence négative, l’ignorance du sens et des implications de la Constitution ? L’ironie du président du Conseil Constitutionnel ivoirien interroge le seul délocuté, en réalité le destinataire de son propos, c’est-à-dire le peuple sur sa place dans le projet républicain. Mais ce scepticisme a-t-il un sens en soi ? La logique républicaine peut-elle y survivre ?
II/ De l’énonciation à la souveraineté : l’attribut du peuple
Selon le Lexique des termes juridiques, la république est un « régime politique où le pouvoir est chose publique (res publica), ce qui implique que ses détenteurs l’exercent non en vertu d’un droit propre (droit divin, hérédité), mais en vertu d’un mandat conféré par le corps social.[12]»
La forme de gouvernement, la nature et la source du pouvoir déterminent ainsi le régime républicain logé dans un espace immatériel et/ou civique dans lesquels l’individu porte deux attributs intangibles, à savoir la liberté et l’autodétermination. De là, la collectivité générée est dite souveraine, elle dont les individus pris isolément sont libres et s’autodéterminent : ce sont ainsi des citoyens. Il s’instaure entre ceux-ci un rapport de mutualité qui abolit la verticalité propre au régime monarchique établissant pour sa part un rapport d’autorité, voire de domination entre le monarque et ses sujets. Or, comme l’enseigne le modèle latin qui lui sert de point de repère, la république est structurée autour des « Cives (qu’il faut correctement traduire par concitoyens) ayant la condition statutaire de mutualité, puis la collectivité de ceux qui possèdent cette condition [et qui] forment la civitas.[13] » Là encore est rappelé le principe d’égalité, à savoir que dans la république, la liberté des uns vaut celle des autres, celle-ci ne pouvant en aucune manière être supérieure à celle-là.
De ce point de vue, la règle isonomique de la démocratie solonienne, c’est-à-dire l’égalité de tous (iso) devant la loi (nomoi)[14], se sera transmise à l’antique cité romaine avant de se répandre dans les républiques modernes par le jeu des grandes chartes qui les fondent et les lient entre elles. La liberté et l’égalité sont les critères de la république qui se réalise dans la figure du citoyen. Ainsi considéré, le citoyen exprime « l’idée selon laquelle la liberté, lorsqu’elle est destinée à un seul individu d’un quelconque Etat, se trouve automatiquement universalisée à l’ensemble des individus de l’Etat.[15] »
Liberté, égalité et souveraineté populaire configurent l’espace républicain et fondent un ordre politique dans lequel le pouvoir est au peuple, c’est-à-dire aux citoyens. Le système énonciatif de la constitution ivoirienne, les hypostases politiques que rappelle son préambule et que reprennent ses articles correspondent, comme il apparaît, à un ordre de pensée ancien qui s’est diffusé à travers les siècles. Tout ceci forme un horizon d’attente dont la loi fixe le projet. Cette tradition politique s’exprime manifestement à l’article 50 de la Constitution ivoirienne qui stipule que : « La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.[16] » Or qu’est-ce que la souveraineté sinon que « le pouvoir absolu, illimité et inconditionné[17] » dont on dit désormais qu’il est l’attribut du peuple ? La souveraineté populaire est plus exactement « La souveraineté dont le titulaire est le peuple considéré comme la totalité concrète des citoyens, qui en détiennent chacun une fraction…[18] » Cet ordre politique a pour « conséquences… le suffrage-droit (nécessairement universel) et la démocratie directe (l’élection de députés n’étant qu’un pis-aller qui doit être corrigé par l’admission d’un mandat impératif et le recours aux procédés de la démocratie semi-directe.)[19] »
S’il se place désormais au centre du jeu c’est parce que le peuple a atteint une dignité qu’il n’avait pas. De ce fait, la lettre de la loi, en l’occurrence la constitution, est, sinon est censée être, la traduction d’une transformation sociétale et incidemment mentale au bénéfice de la majesté du peuple. L’intelligibilité de la loi dans ce contexte précis n’est obtenue que dans la perspective de l’herméneutique historique seule capable de fournir les clés pour comprendre le basculement dont le texte n’est que le témoignage. Autrement, la lettre n’est pas assurée d’atteindre son objet, elle ne coïncide pas parfaitement avec l’esprit de la loi. C’est cette inadéquation dans la pensée commune et dans la pratique politique à la fois du corps militant et civil, qui oblige au rappel de certaines évidences comme celle de savoir par exemple « Qui est le souverain ? [20]» dans une république ainsi que se le demande Geoffroy-Julien Kouao. La réponse, tout aussi évidente, informe le lecteur sur la réalité même du fait républicain ivoirien. Geoffroy-Julien Kouao répond donc que « Dans une République, c’est le peuple [le souverain]. [21] » Il ajoute que « Contrairement à une opinion commune, le Président de la République n’est pas le souverain. Le souverain dans une République, c’est bien le peuple. [22]»
La nécessité de la mise au point est un indice important du caractère hétérénonique de la pensée politique ivoirienne. Dans la doxa ivoirienne en effet, le pouvoir n’est pas dans le peuple, en majesté, mais hors de lui, entre les mains de la caste politique. Il faut donc rappeler la coïncidence juridique et honorifique provoquée par le basculement républicain de l’Etat pour entendre ce qu’énonce la loi sur la souveraineté du peuple.
En effet, déjà dans la Rome antique, c’est la majesté du peuple romain qui est consacrée comme en témoigne la formule du : maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorem quibus populus potestatem dedit aliquid derogare, « porter atteinte à la majesté du peuple romain, c’est enlever quelque chose à la dignité, à la grandeur ou au pouvoir soit du peuple, soit de ceux à qui il a délégué ce pouvoir[23] ».
La reconnaissance de la majesté du peuple romain est telle qu’elle s’affirme dans la loi, notamment celle du crimen maietatis qui réprime « tout acte ou comportement contraire aux intérêts ou à la sécurité du peuple romain.[24] » La loi, comme on le voit dans la tradition républicaine, n’est pas désamarrée de l’histoire et des représentations sociales qui l’ont générée : elle n’en est que la traduction littérale. Jurgen Habermas le souligne selon qu’il entend que « Dans la positivité du droit se reflètent aussi les contingences de (son) contexte d’apparition[25] » si bien que proclamer la loi sans doute aussi l’interpréter en vue de son application sans tenir compte de son enracinement historique et éthique c’est potentiellement la trahir et manquer à la justice. Pour Victor Hugo, c’est « une caricature légaliste[26] » dans laquelle on fait prévaloir les « sources formelles [de la loi] (La lettre) [sur] ses sources réelles (L’Esprit) [27]».
La routine juridique, les considérations strictement structuralistes de la loi et les vices politiques conduisent in fine au ravalement de la tradition où la loi a puisé sa substance. Il s’ensuit un effacement progressif de la charpente axiologique, celle des grands principes dont les règles légales ne sont en réalité que des hypostases. C’est pourquoi le lien herméneutique ne peut pas être tenu pour accessoire car l’interprétation lacunaire ou l’application insuffisante du principe peut être source de graves dysfonctionnements, notamment si on considère la constitution. L’herméneutique historique alerte alors sur les défis auxquels l’analyste ou l’interprète est confronté en énonçant que : Quiconque comprend l’histoire des concepts comme une histoire des problèmes se trouve constamment aux prises avec la question fondamentale de l’herméneutique historique, à savoir : pourquoi une question donnée s’est-elle posée, pourquoi a-t-elle suscité une réponse, précisément à tel moment et de telle façon ?[28]
Si la République de Côte d’Ivoire peut être considérée comme la réponse d’un problème politique issu de la colonisation du pays, la question qui se pose dès lors est de savoir : pourquoi la question républicaine est-elle apparue entre 1946 et 1960, pourquoi a-t-elle suscité une réponse franco-ivoirienne, quelle est la nature de cette réponse, et quelles en sont les survivances aujourd’hui qui expliquent la qualité actuelle du projet républicain ?
III/ République de Côte d’Ivoire et principe de souveraineté : une lecture herméneutique
Le réservoir énonciatif composé des déclarations de chefs d’institutions, voire du personnel politique dans son ensemble et la logique hétérononique d’après laquelle la société ivoirienne appréhende le pouvoir politique sont en réalité un legs de l’histoire. Le quasi-atavisme généré de ce fait est la conséquence de la ruse coloniale et du vice des pouvoirs postcoloniaux dont aucun régime n’a ni su ni voulu se départir. Si en 1960, la colonie a fait place à la République, le citoyen a-t-il pour autant été consacré en lieu et place de l’ancien indigène ? Cela paraît en effet peu probable. Un bref rappel historique permettra de mettre en lumière la réalité de cette distorsion pour comprendre le prisme sous lequel s’organise la politique en Côte d’Ivoire.
C’est en effet, sous l’activité d’Arthur Verdier, d’Amédée Brétignère et de Marcel Treich-Laplène, tous trois représentants de la couronne de France que naît la colonie de Côte d’Ivoire en 1893[29]. A la recherche d’un meilleur équilibre politique pour administrer plus sereinement le pays, ils s’ingénient à unifier, du moins administrativement, les peuples divers qui composent le territoire en conquête. Le but de l’entreprise n’est évidemment pas philanthropique, le lieutenant-gouverneur Bayol et Marcel Treich-Laplène étant convaincus des immenses potentialités de la région appelée à devenir « la clé d’un empire africain[30]. »
La seconde raison de cette activité consiste dans la concurrence que se livrent les États européens sur le sol africain. La conférence de Berlin fournira à cet égard les instruments diplomatiques et juridiques nécessaires pour assurer une entreprise coloniale apaisée. Les règles du jeu désormais établies – « Article 34 de l’acte de Berlin [31]» – les officiers français s’activent pour contrer les projets expansionnistes de la concurrence, notamment anglaise. Avec les potentats locaux, ils s’assurent l’exclusivité de l’exploitation des nouveaux territoires. Ils procèdent pour ce faire à la signature de traités avec les chefs et les rois, représentant l’autorité locale. Le traité signé le 4 juillet 1843 entre Nanan N’Doffou, roi du Sanwi, et les représentants de la couronne de France édifie sur la nature des accords signés. Les articles 2 et 6 ci-dessous permettent de se faire une idée sur leurs motivations réelles :
Article 2 : Le roi et les chefs du Pays continueront à jouir, vis-à-vis des indigènes, de leurs droits de souveraineté, mais en vertu du présent traité, ils ne pourront nouer de relations avec les puissances étrangères, ce droit restant dévolu à Sa Majesté le Roi des Français ou aux agents qu’il lui plaira de nommer. Conséquemment, aucune nation n’aura le droit de faire dans le pays d’Assinie aucun établissement d’aucune espèce. [32]
Article 6 : Le roi et les chefs d’Assinie cèdent toute la langue de terre qui existe entre la mer et la rivière, depuis la barre jusqu’au lieu où la rivière prend sa direction vers le nord. Ils cèdent en outre, un mille carré sur la rive droite. [33]
Dès le début des années 1840, les principaux monarques qui règnent sur les peuples indigènes signent donc avec la France des traités[34] dont le principal enjeu réside dans l’exercice de la souveraineté. En réalité, le bénéficiaire et le destinataire de ces accords sont respectivement le colon et les puissances concurrentes. Il reste que, si le texte concède de laisser au cosignataire de l’entente l’exercice d’une souveraineté intérieure supposée, la réalité est tout autre dans les relations extérieures avec les puissances étrangères. Selon Jean-Baptiste Mockey, de tels accords ont été passés près de soixante-dix (70) fois.
En 1959 toutefois, les populations du Sanwi vont gravement remettre en cause cette logique qui, à partir de l’héritage colonial, entend les attacher à la nouvelle République ivoirienne en gestation. Le fondement juridique de leur protestation réside dans la caducité du traité ancien qui, les liant à l’ancienne couronne de France ne saurait, par le truchement de la république française, les placer sous l’autorité du futur Etat indépendant ivoirien. Les Sanwi espèrent donc recouvrer leur autonomie internationale sur le modèle de Principauté de Monaco.
Evacuée trop rapidement, la question de la souveraineté s’est rappelée avec acuité en menaçant même l’émergence de la future République de Côte d’Ivoire. Différée avec la proclamation de l’indépendance, elle reste pourtant entière. En effet, si la constitution politique, administrative et juridique d’un territoire peut l’élever au rang d’Etat, la nature républicaine de celui-ci n’est acquise qu’en regard de la forme de gouvernement et du statut des individus devenus des citoyens. Dans le cas de l’Etat de Côte d’Ivoire cette mutation ne s’est opérée. En passant de la colonie à la république, les indigènes, pris individuellement et collectivement, n’ont, en toute vraisemblance, pas reçu tous les attributs de ce changement de statut. Ils sont restés l’otage du lien colonial de la servitude monarchique ce qui est l’antithèse de la demande républicaine dans laquelle la souveraineté n’est plus la propriété d’un seul, mais, fractionnée, elle est partagée entre tous les citoyens. L’Etat républicain est en fait la conséquence d’un double mouvement : d’abord, le souverain unique est dessaisi, voire dépouillé de la souveraineté au bénéfice de la collectivité citoyenne ; ensuite, l’Etat exerce sa souveraineté à l’extérieur de ses frontières. Libre, par la liberté de ses citoyens, il n’est plus attaché ou sous le couvert de quiconque à qui il concèderait une partie de sa souveraineté.
Or si l’on observe la trame historique de l’édification de l’Etat-unitaire (la colonie) puis de l’Etat-Républicain ivoirien, l’on se rend compte qu’à aucun moment le projet n’a consisté à élever l’individu au rang de citoyen. En réalité, le mal postcolonial trouve sa racine dans la nature du projet même de la colonisation. Le cas ivoirien n’est pas isolé à cet égard. En général,
Après la conférence de Berlin, les traités devinrent les instruments essentiels du partage de l’Afrique sur le papier. Ces traités étaient de deux types : les traités conclus entre Africains et Européens ; les traités bilatéraux conclus entre Européens. Les traités afro-européens se répartissent en deux catégories. Il y avait d’abord les traités sur la traite des esclaves et le commerce… Puis venaient les traités politiques, par lesquels les chefs africains apparaissaient comme renonçant à leur souveraineté en échange d’une protection…[35]
Voici donc que l’article 2 du traité de 1843 s’éclaire d’un jour nouveau. Son propos sur la question de la souveraineté :
Le roi et les chefs du Pays continueront à jouir, vis-à-vis des indigènes, de leurs droits de souveraineté, mais en vertu du présent traité, ils ne pourront nouer de relations avec les puissances étrangères, ce droit restant dévolu à Sa Majesté le Roi des Français ou aux agents qu’il lui plaira de nommer.
Pour les indigènes, la souveraineté est exercée intérieurement par le Roi ou les chefs locaux, et internationalement par le Roi de France. Lorsque survient l’indépendance, donc la séparation entre la colonie et la république française, ancienne couronne de France, le principe interfacial (un individu est souverain pour le peuple) n’a pas changé. C’est pourquoi le Général De Gaulle rétorquera aux émissaires du Sanwi partis solliciter son aide dans l’affaire les opposant au futur chef de l’Etat ivoirien, que la « Côte d’Ivoire est le domaine réservé de M. Houphouët-Boigny[36] »
Au total, dans la pensée politique ivoirienne, la souveraineté échappe au citoyen malgré les proclamations constitutionnelles qui aménagent contradictoirement tout un territoire de privilèges pour le président de la République.
D’un autre côté, les anciens potentats dépositaires de l’autorité coutumière n’ont pas renoncé au nom de la souveraineté populaire, d’une part, et du vivre-ensemble républicain, d’autre part, à leurs prétentions sources de conflictualité constante. Contre toute logique, les régions sont devenues concurrentes pour accéder, par le pouvoir d’Etat, à la suprématie nationale. Là encore, il s’agit d’une distorsion historique dont le témoignage s’est manifesté dans l’inscription dans la constitution de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels.
Conclusion
Il se déduit de ce que déclare la politeia ivoirienne une somme d’inquiétudes, au sens de l’épistémologie, sur la véritable nature du pouvoir dans le pays. Contre la lettre de la Constitution, l’expression énonciative des rapports au pouvoir traduit un ordre politique qui s’épanouit hors du cours de la loi, du moins si on considère les sources herméneutiques auxquelles elle se nourrit. La loi dans ces conditions ne semble servir que de vitrine tant le décalage est net entre la Constitution – sa lettre, et son esprit surtout – et la réalité de la pratique politique. Alors qu’on imaginait une adhérence parfaite entre le texte et les principes universels auxquels le rattache son préambule, c’est une autre logique herméneutique qui semble nourrir l’action politique. Les scories de la colonie se rappellent au corps civil et imposent leur logique dans l’exercice du pouvoir. La modernité proclamée n’aura pas émancipé l’ancien indigène promis pourtant, si on suit le principe, à la majesté républicaine. Laissé de côté, le peuple n’est qu’un faire-valoir : à l’égard de l’énoncé constitutionnel, il n’est qu’un locuteur quelconque, extérieur à elle, il n’a fait que la voter, il n’a pas participé à son élaboration. Il s’ensuit que le peuple ne peut pas prétendre connaître la constitution, du moins pas mieux, sinon pas au même titre, que les gouvernants. Il y a là, manifestée, une logique capacitaire dont l’expression tangible dans les actes et dans les paroles est loin des attentes démocratiques et républicaines. En conséquence, deux ordres politiques ante et post indépendance se superposent dans la gouvernance de la cité. République et post-colonie se neutralisent derrière le bouclier constitutionnel et son indécision à choisir entre l’une et l’autre. Les crises politiques ivoiriennes seraient-elles de ce fait la conséquence sinon d’une ruse perpétuelle en tout cas d’un malentendu fondamental ? La réponse n’est pas évidente. Il reste que le quiproquo républicain s’impose à l’analyse. Dans l’esprit de tous, y compris du corps social lui-même, la souveraineté est hors du peuple. Dès lors, le président de la République élu dans les conditions suspectes de toujours et par un collège électoral rabougri exerce son autorité de façon absolue. Par conséquent, c’est peut-être moins dans la loi que dans les actes et surtout les paroles qui les accompagnent en en témoignant que les premiers signes de la révolution républicaine ivoirienne doivent être attendus.
Bibliographie
Ouvrages
ADALBERTO, Giovannini, Les institutions de la République romaine, des origines à la mort d’Auguste, Genève, Schwabe Verlag, 2015.
BOAHEN, Albert Adu (Dir.), Histoire générale de l’Afrique VII. L’Afrique sous domination coloniale 1880-1935, PARIS, Présence Africaine, Edicef, Unesco, 1989.
DIANDUE, Bi Kacou Parfait et Renouprez, Martine (Dir.), Le hasard dans les lettres et les arts et les lettres, Cádiz, Muñoz Moya Editores, 2019.
JAUSS, Hans Robert, Pour une herméneutique littéraire, Paris, Gallimard, 1982.
KOUAO, Geoffroy-Julien, Violences électorales et apologie de l’impolitique, faut-il désespérer de la Côte d’Ivoire ? Le régime parlementaire et le nouvel ordre politique, Abidjan, Les éditions Kamit, 2022.
KOULIBALY, Mamadou, Le libéralisme nouveau départ pour l’Afrique noire, Paris, L’Harmattan, 1992.
LARTHOMAS, Pierre, Notions de stylistique générale, Paris, PUF, 1998.
METAN, Louis, Les grands procès de la République sous l’ère Houphouët-Boigny, La justice ivoirienne entre grandeur et sujétion, Abidjan, Vallesse éditions, 2018.
MOSSE, Claude, Regards sur la démocratie athénienne, Paris, Perrin, 2013.
PERRET, Pierre, L’énonciation en grammaire du texte, Paris, Nathan, 1994, p.9.
PIERRON, Jean-Philippe, « Une herméneutique en contexte : le droit » in Methodos, Savoirs et textes, https://doi.org/10.4000/methodos.3040
WODIE, Francis, Côte d’Ivoire, le Conseil Constitutionnel : 2010-2015, regard(s) croisés, Abidjan, CERAP, 2018.
Dictionnaire
Guinchard, Serge (Dir.), Lexique des termes juridiques, 2017-2018, Paris, Dalloz, 2017.
Liens internet
http://www.conseil-constitutionnel.ci/actualite/prestation-de-serment-du-president-de-la-republique
Lois
Loi no 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire in Journal officiel spécial numéro 16 du 9 novembre 2016.
LOI Constitutionnelle no 2020-348 du 19 mars 2020 modifiant la loi no 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire in Journal officiel numéro 23 du 19 mars 2020.
[1] Voir les interventions de Martin Bléou, constitutionnaliste ivoirien, https://apr-news.fr/actualites/martin-bleou-prof-de-droit-la-nouvelle-constititution-ne-permet-pas-a-ouattara-de-faire-un https://news.abidjan.net/articles/678180/candidature-de-ouattara-a-la-presidentielle-de-2020-le-professeur-martin-bleou-revient-a-la-charge-declaration
[2] Alassane Ouattara et les cadres de son parti tout comme les officiels français ont invoqué le décès de Amadou Gon Coulibaly, candidat potentiel du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), pour justifier la volte-face du chef de l’Etat. Celui-ci avait en effet annoncé face au Congrès, le 5 mars 2020, son intention de quitter la présidence de la République après son second mandat. Depuis, Amadou Gon Coulibaly est décédé, notamment le 8 juillet 2020, obligeant, selon l’argument finalement admis, Alassane Dramane Ouattara à revenir sur sa parole faute de candidats dans son parti pour pallier l’absence du premier ministre défunt.
[3] Voir les interventions Pierre Aly Soumarey, https://news.abidjan.net/articles/677001/presidentielle-2020-un-professeur-de-droit-repond-a-martin-bleou-pourquoi-alassane-ouattara-peut-etre-candidat-contribution
[4] Jean-Philippe Pierron, « Une herméneutique en contexte : le droit » in Methodos, Savoirs et textes, https://journals.openedition.org/methodos/3040
[5] Marion Colas-Blaise, « L’énonciation à la croisée des approches. Comment faire dialoguer la linguistique et la sémiotique. »
[8] Martin Riegel et alii, Grammaire méthodique du français, Paris, QUADRIGE / PUF, 2009 [1ere édition 1994], p. 931-932.
[9] Alassane Ouattara, lors d’une rencontre les chefs et les "cadres" du Sud et de l’Est du pays, le 17 août 2020. Voir journal télévisé de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne : https://youtu.be/WXMFvjgiYsc
[10] http://www.conseil-constitutionnel.ci/actualite/prestation-de-serment-du-president-de-la-republique
[11] Francis Wodié, Côte d’Ivoire, le Conseil Constitutionnel : 2010-2015, regard(s) croisés, Abidjan, CERAP, 2018, p. 23.
[13] Sylla Abdoulaye, « Le hasard contre la volonté : L’État à l’épreuve du défi offshore », in Le hasard dans les lettres et les arts et les lettres, Cádiz, Muñoz Moya Editores, 2019, p. 12.
[14] Claude Mossé, Regards sur la démocratie athénienne, Paris, Perrin, 2013, p. 17.
[15] Mamadou Koulibaly, Le libéralisme nouveau départ pour l’Afrique noire, Paris, L’Harmattan, 1992, p. 13.
[16] Loi no 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire in Journal officiel spécial numéro 16 du 9 novembre 2016.
LOI Constitutionnelle no 2020-348 du 19 mars 2020 modifiant la loi no 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire in Journal officiel numéro 23 du 19 mars 2020.
[17] Geoffroy-Julien Kouao, Violences électorales et apologie de l’impolitique, faut-il désespérer de la Côte d’Ivoire ? Le régime parlementaire et le nouvel ordre politique, Abidjan, Les éditions Kamit, 2022, p. 40.
[18] Serge Guinchard (Dir.), Lexique des termes juridiques, Op. Cit., p. 1764.
[19] Ibid.
[20] Geoffroy-Julien Kouao, Violences électorales et apologie de l’impolitique, faut-il désespérer de la Côte d’Ivoire ? Le régime parlementaire et le nouvel ordre politique, Op. Cit. p. 170.
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Giovannini Adalberto, Les institutions de la République romaine, des origines à la mort d’Auguste, Genève, Schwabe Verlag, 2015, p.17.
[24] Ibid.
[25] Cité par Jean-Philippe Pierron « Une herméneutique en contexte : le droit » in Methodos, Savoirs et textes, https://doi.org/10.4000/methodos.3040
[26] Ibid.
[27] Ibid.
[29] Voir Sylla Abdoulaye, « Réconciliables ? Sortir du mensonge » in Penser la réconciliation pour panser la
Côte d’Ivoire, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 95.
[30] Louis Metan, Les grands procès de la République sous l’ère Houphouët-Boigny, La justice ivoirienne entre grandeur et sujétion, Abidjan, Vallesse éditions, 2018, p. 119.
[31] Albert Adu Boahen (Dir.), Histoire générale de l’Afrique VII. L’Afrique sous domination coloniale 1880-1935, PARIS, Présence Africaine, Edicef, Unesco, 1989, p. 48.
[32] Louis Metan, Les grands procès de la République sous l’ère Houphouët-Boigny, La justice ivoirienne entre grandeur et sujétion, Op. Cit., p. 85.
[33] Ibid., p. 86.
[34] Nanan N’Doffou, pour le royaume du Sanwi, Karamoko Oulé Ouattara, pour le royaume de Kong, Agyimini, pour le royaume de Bondoukou. Odienné ne sera ajouté à cet "Etat unitaire" qu’en 1898, après la défaite de Samory Touré.
[35] Albert Adu Boahen (Dir.), Histoire générale de l’Afrique VII. L’Afrique sous domination coloniale 1880-1935, Op. Cit., p. 49
[36] Louis Metan citant le journal Abidjan Matin du 26 avril 1960, in Les grands procès de la République sous l’ère Houphouët-Boigny, Op. Cit., p. 85.