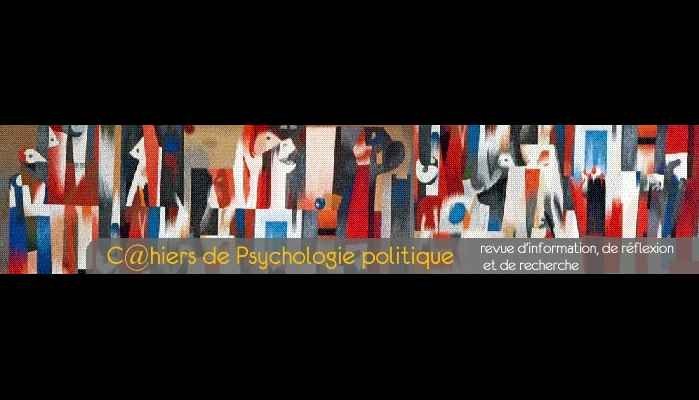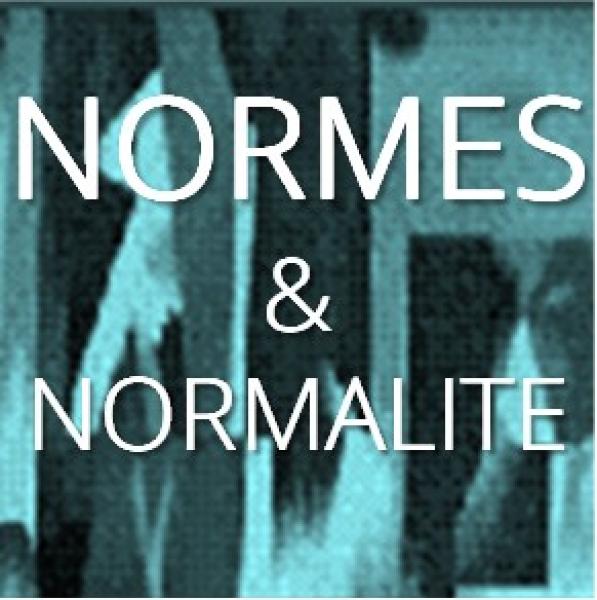Introduction
L’esprit normatif a de bonnes raisons d’exister pour instituer et organiser sa pensée, structurer les rapports humains, se diriger, commander et juger. Mais nous avons le sentiment diffus de vivre sous la tyrannie des normes dans de nombreux domaines qui enrégimente alors toute la société. Le fait est que le nombre de textes et d’institutions ont foisonné depuis quelques décennies pour normer les productions, les comportements, les éducations, les relations et même les mœurs, etc. Quelques prestigieux auteurs ont légitimé cet esprit normatif en approfondissant la logique des normes dont, en particulier, Georges Kalinowski et Georg Henrik Von Wright. Le premier est un théoricien du droit, philosophe, mais surtout logicien et héritier de la très fameuse école de logique polonaise qui a été l’une des plus importantes en Occident dans la première moitié du 20e siècle. Il fut spécialiste de la logique juridique et publia en 1953 sa Théorie des propositions normatives et en 1972 La logique des normes où il ajoute un panorama historique à ses travaux, remontant à la logique d’Aristote [1]. Le second est un philosophe finlandais qui succéda à Ludwig Wittgenstein à la chaire de philosophie de Cambridge, dont l’œuvre porte sur la logique juridique et déontique dans Essai de logique modale en 1951 et en 1957 dans Logique, philosophie et langage, de nombreux articles consacrés à cette logique déontique de 1951 à 1981 complètent ces ouvrages. Chez les modernes, cet esprit des normes a pour origine le besoin du droit positif de se construire sa légitimité rationnelle et son autorité institutionnelle. En effet, en l’absence d’une ombrelle théologique inspirant les lois, le droit positif devait s’autolégitimer par la souveraineté du législateur et par la rationalité autonome de ses inférences. Ce sera le sens des œuvres du juriste d’inspiration kantienne, Hans Kelsen, normativiste, théoricien du droit et de la science du droit dans ce qui la fonde, avec deux ouvrages importants : Théorie pure du droit et Théorie générale des normes, publiés en 1934 et 1996 en langue française.
Cette rationalité tire sa légitimité de la primauté accordée à la pensée logico-mathématique et des théories du langage auxquelles se réfère Hans Kelsen. Notre article souhaite mettre en perspective, a minima, une autre expérience de la raison que celle d’une quête logique de la rationalité objective produisant des inférences à la manière de vérités contraignantes. Nous voulons ici ouvrir les horizons, souvent méconnus, des rationalités au-delà de cette conception normative et exclusive de toute alternative, issue d’une tradition déterministe, rationaliste et positiviste en termes de traditions philosophiques. Par ce détour sur les raisons, nous essaierons de faire un premier pas sur la meilleure compréhension de ce choix restrictif, pour ne pas dire cette amputation, avant d’en rechercher les ressorts psychopathologiques, car cette préférence pour la rationalité normative a sans doute ses raisons.
En revanche, prenons garde à ne pas médicaliser à l’excès, car l'étude scientifique et clinique des troubles psychiques par la psychologie est certes éclairante, mais elle fait courir le risque d’une psychiatrisation de la vie humaine, avec quelques autres dérives normatives, émanant, celles-là, des normes et pathologies psychiques. C’est la raison pour laquelle, nous essaierons de préserver une attitude propre à la psychologie sociale et politique ; cherchant à comprendre les raisons de la présence de ces différentes raisons et de la domination de l’une d’entre elles. S’il existe différentes raisons comme nous l’enseignent de nombreux philosophes dont Jacques Maritain, Jean Ladrière, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Maurice Merleau-Ponty, mais aussi Theodor Adorno et Max Horkheimer ou Karl Jaspers, il conviendra d’expliquer que ces raisons peuvent dériver vers des pathologies, l’une schizophrénique, l’autre narcissique, comme nous tenterons de le montrer.
Nous nous permettons quelques notes longues, car ces sujets emportent des disciplines : logique, psychologie, linguistique, herméneutique, philosophie, théorie du droit, et il nous paraît utile de donner au lecteur les matériaux théoriques sous-jacents, parfois complexes qui sont à l’œuvre dans cette étude psychopathologique de l’esprit normatif.
1. Aux origines de la logique des normes
Avant d’en comprendre les ressorts psychologiques, il est utile d’exposer les raisonnements des auteurs de cette logique des normes. Le droit requiert une réflexion sur sa rationalité, soit sa cohérence interne par une science de la discipline juridique. Pour se réaliser elle s’appuie sur les travaux des logiciens qui formalisent ces règles normant les procédures de pensée pour contraindre le législateur et sécuriser le juge et le justiciable. Aller aux origines, c’est rappeler ici le travail effectué par les juristes et les logiciens. Nous commencerons par un logicien en particulier, Georges Kalinowski puis poursuivrons par Hans Kelsen, deux auteurs essentiels en la matière.
Georges Kalinowski s’intéresse à la logique du droit. Les lois du langage propositionnel sont comme des allants de soi, par nécessité logique, les objets étant posés devant soi, imposant une raison normative, le logicien étant le savant neutre observant les lois de la juste pensée dont les inférences sont valides d’elles-mêmes. Cette relation, nous la qualifierons de réification de soi et de désir inconscient d’automation des normes de pensée. Nous nous intéresserons à l’alternative d’une raison dont les existentialistes et les phénoménologues connaissent mieux les ressorts, ceux d’une relation de soi à soi, où l’expression rationnelle implique celui qui l’expose, l’obligeant dans son expression et lui accordant la liberté de créer, au-delà des seules inférences normatives, en s’autorisant de méditer sur les finalités et les valeurs, souvent implicites aux propos.
Dans ses deux ouvrages, Hans Kelsen développe une conception normativiste du droit avec la volonté de le rendre pleinement autonome des interférences spirituelles passées. Il distingue la religion et le droit mais il en fait deux ordres normatifs semblables, l’un devant s’émanciper de l’autre. La norme juridique procède nécessairement d’un langage formalisé. Hans Kelsen intègre aussi les analyses sur les énoncés, provenant des théories du langage. Surtout, il évolue d’une posture initiale d’un strict logicisme, dont nous allons retrouver les principes chez Georges Kalinowski, vers une posture plus kantienne où la raison se fait volonté souveraine. Nous verrons comment le droit positif développe cet esprit des normes par l’affirmation de la souveraineté de la volonté rationnelle de l’auteur de la norme, attestant de la dimension performative du langage juridique.
1.1. La logique formelle et la normalisation de la rationalité
Dans son approche propositionnelle, Georges Kalinowski développe une rationalité formelle, cette raison qui impose ses figures logiques en vertu de principes admis faisant naturellement autorité dans des opérations, dîtes de calcul propositionnel. Pour mener à bien cet exposé synthétique, nous nous appuierons sur sa conférence de 1983 La genèse d’un système de logique des normes et sur l’article brillant de Denis Vernant La logique des normes juridiques de Georges Kalinowski publié en 2014.
Son calcul propositionnel consiste à modéliser les inférences déductives. Il s’agit de rendre compte du raisonnement juridique, pour le distinguer de l’arbitraire et de la fantaisie du prince. Le logicien se réfère à Aristote concernant les lois des syllogismes et leur traduction dans la logique polonaise où, si une proposition P implique une seconde Q, le constat de P permet d’inférer Q : si P alors Q. Georges Kalinowski propose d’articuler deux systèmes dénommés K1 et K2. L’apport du logicien tient essentiellement à ces deux structures de raisonnement.
La première concerne les énoncés normatifs qui s’écrivent sous la forme : xRa, où x est un sujet, R, une relation normative et a une variable d’action. Mettre en relation un sujet et une action est en effet une des bases du travail juridique, surtout en droit pénal, qui inclut une axiologie de l’action ; c’est-à-dire la détermination de la valeur positive ou négative de l’action : a. Si a est tuer, elle a une valeur négative, alors que si a est payer son créancier, elle a une valeur positive. Chaque action se voit attribuer une valeur 1 (positive), 0 (négative) et ½ (indifférente), inspirée de la logique trivalente de son maître, le logicien Jan Lukasiewicz. A l’inverse, ne pas tuer est positif et ne pas payer son créancier est négatif.
La seconde structure concerne les relations normatives. Il s’inspire d’Aristote pour présenter le quaterne des oppositions constitué des rubriques logiques suivantes pour le R de la formule initiale :
- Obligation : soit le devoir faire, par une affirmation universelle
- Interdiction : soit le devoir ne pas faire, par une négation universelle
- Permission : soit le droit de faire, par une affirmation particulière
- Dispense : soit le droit de ne pas faire, par une négation particulière
Fort de ces structures formelles, le logicien rend compte du travail déductif et d’une bonne part des constructions juridiques. Pour bien saisir la logique du quaterne, il suffit de prendre quelques exemples. Le citoyen déclare et paie l’impôt. Cette affirmation universelle est une obligation. Le citoyen ne tue pas son prochain est une négation universelle. C’est un interdit. Au sens juridique, la permission s’appuie sur des obligations particulières car la règle serait l’interdit. Exemple : le citoyen n’a pas le droit de chasser. Pour chasser, il doit répondre à des obligations particulières par l’obtention du permis de chasse. De même pour un permis de conduire ou de construire. Concernant les dispenses, elles s’appuient sur des négations particulières soit des interdits qui rendent impossible l’obligation initiale. Le citoyen inapte physiquement est dispensé de sport à l’école ou du service militaire ou l’entreprise en perte est dispensée de l’obligation de l’impôt.
Hans Kelsen a été fidèle à cette recherche de rationalité et de cohérence interne, tout en prenant la mesure d’un non-dit de Georges Kalinowski : la manière d’affecter les valeurs (0, 0,5 et 1) à des actions et des relations (Obligation : 1, permission positive ou négative dites aussi dispense : 0,5 et interdit : 0). Mais pourquoi une action serait positive quand tuer est interdit mais obligatoire au combat selon le droit de la guerre par exemple ou toléré dans le code pénal en cas de légitime défense ? Pourquoi un interdit d’une époque : le divorce dans le code Napoléon par exemple, devient-il une permission dont l’appréciation des conditions particulières évoluent ensuite dans le temps ? L’acte du législateur, mais aussi du juge semble relever d’une souveraineté, sous l’influence d’orientations sociales et politiques inconstantes au fil du temps, soit, d’une volonté qui précède le texte juridique lui-même selon les désirs sociaux du temps. Se joue alors l’affectation d’une valeur à chaque action, résultat d’une axiologie, moins normative que négociée, et donc conjoncturelle. Alors, l’obligation s’accompagne de dispenses croissantes, l’interdit de permissions. Un interdit devient même une obligation. La logique ne répond pas à cette question de la fluctuation normative. Le juriste perçoit bien que la norme est un choix délibéré en situation historique.
1.2. Le droit positif et l’esprit des normes
Les juristes ont interrogé la rationalité des lois et des jugements car le droit positif voulait se distinguer des pratiques discrétionnaires des princes, jugées arbitraires, exerçant selon la tradition, voire leur intérêt, au détriment du justiciable, avec un risque d’iniquité et d’injustice dans le temps et dans l’espace selon leurs caprices.
Synthétisons ici quelques éléments fondamentaux de logique du droit. Nous tiendrons compte en particulier du remarquable travail effectué par Charlotte Girard [2] dans sa thèse de doctorat Des droits fondamentaux au fondement du droit. Réflexions sur les discours théoriques relatifs au fondement du droit publiée en 2010. D’abord, les syllogismes d’Aristote et la cohérence des inférences déductives font du droit une discipline logique, cherchant à échapper aux contradictions flagrantes et à toutes sortes d’incohérences qui seraient assimilables à des arbitraires. Dans une deuxième partie de son œuvre, Hans Kelsen prend la mesure d’un dilemme très présent dans les exposés logiques de Georges Kalinowski, résumable en une question : au nom de quoi et qui décide de la valeur positive et négative des actions et d’une valeur des relations dans le quaterne des oppositions ?
C’est pourquoi, il faut bien distinguer le travail de description et de compréhension chez Georges Kalinowski, du droit positif comme résultat d’un processus législatif mettant en œuvre une volonté politique désireuse d’instituer une règle ou d’infléchir une existante. La théorie générale des normes oublie l’intention et la place du locuteur-auteur, la signification de la norme, comme expression d’une volonté agissant dans sa création, pour infléchir le réel de manière performative. Charlotte Girard a raison de dire : « on remarque la filiation directe entre la théorie pure du droit et la logique mathématique. Celle-ci apparaît plus comme un essai de logique nourri des théories des systèmes et des ensembles, appliquées par Kelsen au langage, et particulièrement au langage du droit. » (2010, Partie 1, Titre II, Ch.1 [293]) [3].
Hans Kelsen est ici l’héritier des théories du langage dont les travaux de John Langshaw Austin, où les énoncés sont bien intentionnels et conventionnels. La norme est plus que le texte qui l’exprime. Elle résulte d’une volonté de prescrire et d’une attente de l’effet de cette prescription sur autrui, soit sa portée performative, de dire pour faire et faire faire. Et la rationalité ne disparaît pas dans cette affaire. Comme le rappelle à très juste titre Olivier Cayla [4] dans sa brillante thèse de doctorat La notion de signification en droit : « La parole soucieuse de la plus grande neutralité, qui se contente d’adopter un mode platement assertif, n’en est pas moins la manifestation d’une prétention : celle précisément de tenir un discours scientifique, de s’ériger en témoin neutre et fiable de la réalité du monde de détenir la vérité. » (1992, 27)
Comme Hans Kelsen l’expose dans l’exemple de la mère expliquant le danger de la plaque chauffante à son enfant par une formulation : « Si tu touches la plaque chauffante, tu vas te brûler et cela va te faire très mal. », celle-ci n’interdit pas. Son propos est éducatif mais pas juridique. Elle n’édicte pas une norme interdisant sans explication. Elle vise un enseignement par l’explication et elle fait le pari de la confiance réciproque entre elle et l’enfant. L’expérience antérieure de la brûlure sera déterminante dans la retenue ou l’inverse de la curiosité possible, du fait de l’ignorance de cette expérience de la brulure. Entre la confiance et l’expérience, l’enfant aura un choix. Il y a donc une dimension très psychologique dans la relation de langage entre la mère et l’enfant qui privilégie sa compréhension à une soumission à l’interdit. Sa parole n’exerce donc pas une autorité autoritaire. Elle laisse l’enfant libre d’assumer son expérience d’apprentissage, prenant ou non le risque de rapprocher sa main prudemment, voire en la posant un instant effrontément. Par cet exemple, Hans Kelsen montre bien que la norme appartient à un univers d’intentions et de prescriptions par un commandement qui a sa finalité propre d’un respect de l’ordre normatif. Le juriste est donc très clair à ce sujet : « Pas d’impératif sans imperator, pas de normes sans autorité qui pose la norme, c’est-à-dire pas de norme sans un acte de volonté, dont elle est la signification. » (1996, 315). La norme exerce un imperium.
Le droit rencontre ici la psychologie, parce que Hans Kelsen doit résoudre un problème de fondation du système des normes pour le légitimer de l’intérieur, la raison trouvant en elle-même les ressources de son ultime cohérence pour rendre compte de l’obligation, de l’interdit, de la permission ou de la dispense. C’est dans théorie pure du droit qu’il entreprend ce travail. Comme le dit Charlotte Girard : « L’option positiviste impose une condition supplémentaire spécifique rejaillissant nécessairement sur le traitement du fondement. Ce dernier doit être normatif et donc interne au système juridique. Le fondement est donc produit par le système juridique, ce qui le rend d’autant plus incontournable, d’un point de vue théorique. » (2010, Partie 1, Titre II, Ch.2 [314]). Hans Kelsen bute alors sur la question de la raison première qui est principe de raison de toutes les raisons. Or, il faut admettre l’évidence première de la rationalité en quête d’ordre, de cohérence et de non-contradiction, posant ses lois comme des normes universelles de la pensée rationnelle. L’opération est périlleuse.
La norme première ou fondamentale qui est au sommet de toutes les normes est paradoxale tel un principe qui ne se démontre pas. Sans refaire ici tout le raisonnement de Hans Kelsen, ce dernier présente cette norme fondamentale comme le résultat d’un pur acte de pensée. Charlotte Girard résume très bien : « si la validité d’une norme ne peut plus être fondée par le moyen d’un syllogisme, alors cette norme doit être placée comme majeure en tête du syllogisme : on doit supposer que cette norme est fondamentale. La tautologie à laquelle on aboutit revient à situer la réflexion sur le fondement du droit dans un champ de la croyance et surtout impose de prendre parti sur le statut de la norme. » (2010, 1, II, 2, [335][5]). Comme chez son maître à penser, Emmanuel Kant, Hans Kelsen constate qu’il y a une raison à l’œuvre dans l’homme pour autant que ce dernier exprime sa volonté d’agir en être rationnel. Il y a tout à coup une extériorité de la pensée qui pénètre l’existence de celui qui pense en se confrontant à son engagement personnel d’être l’auteur de cette décision de penser en être rationnel et de vouloir agir sur le monde en vertu de cette rationalité : geste d’une conscience réfléchie. Là encore, la thèse très pénétrante de Charlotte Girard vise juste lorsqu’elle évoque que la recherche du fondement introduit l’intuition première, un acte de pensée, mais surtout une volonté souveraine où le locuteur devient le souverain auteur de la première norme qui n’a pas d’autre réalité que de rendre possible toute la hiérarchie des normes. Dès lors, les dimensions existentielle et psychologique y deviennent prépondérantes : « la dynamique cognitive qui serait produite par la rencontre des notions, liées respectivement à la conviction et au fondement, amène à confondre l’activité humaine consistant à penser le fondement, et l’objet de cette pensée, le fondement. » (2010, 1, II, 2, [340][6]). Voilà pourquoi, la question de la norme et de la raison de la norme requiert de la psychologie, parce que, in fine, en vertu de la dogmatique positiviste, les normes et les lois émanent bien toujours d’êtres humains pensant et agissant. Il y a là débat entre la norme comme pensée pure ou comme fruit d’un être pensant conscient de sa réflexion, question de relation à la raison et de conscience de la raison. Même Hans Kelsen en est réduit à assumer cette quasi-contradiction d’asserter que les normes de pensée préexistent tout en admettant qu’elles émanent d’une intentionnalité.
2. La relation à la rationalité
Voyons maintenant ce que signifie cette quête de la rationalité normative. De ce fait, une conception du droit fonde un projet de réification et d’automation et une autre un projet alternatif de relation à soi et à autrui où la rationalité peut s’enrichir, au moins, d’une question axiologique sur les valeurs, voire d’une sur les fins.
2.1. La réification de soi et le désir d’automation des normes de pensée
Dans cette premier conception, l’attitude du logicien consiste à s’effacer, pour ne pas dire, disparaître derrière l’exposé des raisonnements. La norme de pensée s’impose et elle réfute toute dépendance à des relations avec autrui ou le monde [7]. La discursivité et les lois internes du langage suffisent à établir la validité des inférence juridiques. C’est en ce sens que Georges Kalinowski confirme l’organisation normative de la pensée juridique qui se prête alors à des automations et prédictions dont l’informatisation devient ensuite possible : « Ce que la logique des normes apporte à la logique juridique et à l’informatique juridique est celle-ci : les thèses de la logique des normes qui vient d’être évoquée [JC1] constituent une partie importante des fondements logiques des inférences juridiques, autrement dit de la pensée juridique discursive. La logique contenant ces thèses a été recherchée et élaborée en vue de l’établissement de ces fondements et elle les apporte dans la mesure où les inférences juridiques sont des inférences déductives normatives. » (1983, 263)
Il y a dans cette logicisation de la pensée juridique une intention de procéder à une automation de la production juridique, en particulier concernant l’activité du jugement, dont l’application des normes procède d’une opération réglée. Mais pour parvenir à une telle réification de soi, peut-être même à un oubli ou renoncement de soi, il faut déléguer au langage symbolique le pouvoir de légiférer de lui-même en vertu de ses normes de pensée. Georges Kalinowski rappelle bien que la logique des normes s’appuie sur cette exigence de rationalité : « Or un énoncé propositionnel, qu’il soit ou non normatif, ne peut être justifié que de l’une des trois manières : par convention, par évidence ou par inférence. … Par conséquent, seule la justification rationnelle des normes par inférence concerne la logique. » (1983, 253) L’évidence ne contente pas le logicien, la convention est toujours arbitraire, fusse-t-elle produite par consensus, car ce dernier peut varier. L’inférence est a priori universelle car la logique l’est aussi.
C’est dans ce rapport à la pensée s’exprimant en un langage rationnel que s’installe une rationalité instrumentale, l’exécution d’opérations répondant à des principes dont la non-contradiction. En oubliant qu’il existe un jugement sur leur validité, les inférences déductives créent l’illusion d’une rationalité se déployant mécaniquement, de propositions en propositions, les premières étant des assertions réputées valides dont les développements logiques seront mécaniquement valides. Cette rationalité positive est alors contraignante et universelle. Sa souveraineté légitime l’exercice de la contrainte pour forcer, forger, former l’esprit rétif à une discipline formelle où la pensée se soumet à ces règles de pensée.
En procédant de la sorte, le logicien justifie l’exigence d’une posture en retrait, faisant l’apologie d’une sorte d’inexistence du sujet par cette réification de soi où il s’agit de se soumettre à la norme de pensée. L’auteur n’est plus que le médiateur transparent de la rationalité. Il est habité, pour ne pas dire illuminé par les évidences rationnelles qui s’imposent à lui. Il y a là une forme de dépossession de soi, d’abandon et un ultime renoncement à penser par soi ; pour se dessaisir de toute entreprise critique qui viendrait perturber la reconnaissance des évidences logiques. Celles-ci autorisent un repos, en ce sens que les règles vont imposer leurs codes et leurs déroulements. L’inférence s’apparente à une machinisation des opérations de pensée [8]. Nous approfondirons la compréhension de cette pratique par son étude plus psychopathologique dans la troisième partie.
2.2. La relation de soi à soi et à autrui dans l’expérience raisonnable
Le discours sans locuteur ni commentateur est sans doute une fiction mais elle a été revendiquée par des logiciens et des mathématiciens comme nous l’avons vu. Dans sa thèse, Charlotte Girard montre bien que penser la norme fondamentale pose quelques difficultés méthodologiques à Hans Kelsen. Elle souligne et suggère que penser cette première norme qui conditionne toutes les autres, c’est en fait la vouloir et donc introduire son auteur volontaire, alors créateur de la logique normative : fondateur souverain et décideur : « C’est pourquoi, après avoir essayé de montrer que l’acte de pure pensée n’était pas autosuffisant pour, à la fois, fonder l’ordre juridique et respecter ses propriétés logiques, en tant qu’ordre normatif, nous proposerons de concevoir la norme fondamentale comme une norme également voulue et, en conséquence, dotée d’un auteur. » (2010, 1, II, 2, [332]) A cet égard, elle rejoint le logicien polonais Stanislaw Lesniewski dans sa critique de l’assertion [9] qui est une figure de rhétorique et de logique dont les logiciens prétendent qu’elle s’impose d’elle-même, alors qu’elle suppose bien un auteur, certes caché, qui joue de son retrait pour prétendre à l’autorité neutre d’une rationalité objective et impartiale. Pourtant, l’assertion comme la norme fondamentale ne peuvent émerger sans un auteur qui les proclame. En ce sens, Denis Vernant confirme la situation : « Dans cette perspective pragmatique, l’assertion prend bien valeur d’acte de discours supposant l’engagement d’un locuteur déterminé en un contexte d’énonciation spécifié, engagement mettant en jeu sa croyance. » (1997, 37). A cet égard, les limites de l’approche logiciste démontrée par la linguistique de John Langshaw Austin et de John Rogers Searle se retrouve aussi dans la relation au langage chez des auteurs tels Emmanuel Levinas pour qui la langue est socialité et expérience, présence à soi et aux autres, de même chez Paul Ricoeur [10] où l’énonciation révèle l’intentionnalité.
L’expérience raisonnable engage une personne dans toute son existence effective, dont sa présence corporelle et son expérience sensible et affective qui en fait un être humain entretenant un rapport aux autres et au monde. Celui-ci- ne se soumet pas à une discursivité, ni ne se confond à un ordre symbolique normatif. Sa raison existentielle suppose donc une autre relation à la raison par la conscience de raisonner ou de juger. C’est la présence primordiale du locuteur, lui qui décide d’affecter une valeur positive ou négative à une action ou de faire de certaines actions des obligations, des interdits ou des permissions et dispenses, par ses actes intentionnels qui véhiculent une axiologie latente. Commentant l’œuvre du logicien, Denis Vernant souligne que la norme est toujours située dans un contexte qui en crée l’opportunité, d’où l’impossibilité, selon lui, d’extraire la rationalité normative d’un environnement social et historique qui en cause l’expression par une personne ou un collectif de personnes : « Les jeux de langage doivent se référer aux formes de vie qui leur donnent sens. L’enquête pragmatique s’ouvre ainsi sur l’exigence d’une anthropologie générale. L’interrogation sur le logos requiert une réflexion sur la polis comme condition sociale de toute interaction. » (1997, 20)
Il existe donc une conception située de la raison, dans un hic et nunc avec un autre type de langage portant sur l’axiologie et l’eschatologie, soit les valeurs et les fins, où l’humain s’engage dans ce qu’il dit, bien au-delà des conventions normatives des seules inférences logiques. Cette raison existentielle a fait l’objet d’un travail remarquable du philosophe Georges Gusdorf dans un petit chef d’œuvre, trop peu connu La parole. Ce dernier critique ce rationalisme universaliste qui se détache en même temps du sujet existant ou du Dieu inspirant : « Le pouvoir que les théologiens reconnaissaient à Dieu de dénommer la réalité en la créant, ce pourvoir appartient désormais aux philosophes, qui en dressant un inventaire rigoureux des pensées, sans préjugé théologique, devient le véritable auteur du monde de la raison. La Révolution au niveau du langage commence donc par une nuit du 4 août, où sont abolis les privilèges traditionnels ; elle aboutit à une nouvelle constitution, qui maintient sous l’autorité de la raison souveraine le libre jeu des mots, citoyens de l’univers du discours, dont les significations ont été, au préalable, soigneusement vérifiées. » (1988, 33). Georges Gusdorf explicite ces fonctions du langage, entre l’expression de soi à la première personne, la rencontre de l’autre dans une conversation avec l’alter ego [11] et une intention à la troisième personne de tendre vers une objectivité. Le langage vise autrui dit-il, il vise soi-même comme un autre, selon la formule de Paul Ricoeur [12]. Si la raison dans le langage est avant tout un exercice de dialogue ou de conversation, il est alors une expérience sociale. Mais cette sociabilité introduit des conventions, pour ne pas dire des normes sans lesquelles il n’y a pas de conversation possible, et Georges Gusdorf de rappeler : « L’usage commun de la parole présuppose cet autre pacte social d’une logique, ensemble de normes pour la correction du raisonnement. » (1988, 93). Dans cet exercice social [13], plane bien la menace d’une autre normativité contraignante dans laquelle disparaît l’expression de soi, soit cette raison existentielle où l’on parle de soi à l’autre, de ses croyances et de ses buts. Là encore, Georges Gusdorf est d’une grande sagacité : « Quant aux savants, aux techniciens, ils ont eux aussi, mais d’une autre façon, renoncé à l’affirmation personnelle pour se convertir à l’unité d’un système objectif … . Parler, c’est donc s’écarter de soi pour se confondre avec tous. » (1988, 79) Et pour composer avec cette normativité que les sociologues dénommeront aisément : conformisme social, l’alternative à cette emprise tiendra à l’avènement de sa manière personnelle de créer sa langue propre dans un effort stylistique, la langue devenant l’objet du sujet, et non le sujet l’objet de la langue. En cela, le romancier ou le poète se donnent plus de libertés d’exprimer leur existence à leur façon, tout en s’adressant à autrui en mettant à leur disposition leur expérience du monde, la culture littéraire offrant une pluralité des mondes vécus à méditer en conscience.
Ces rationalités traduisent bien une préférence psychologique, un rapport à soi et à l’existence dont la psychopathologie ou la phénoménologie peuvent expliquer une partie des ressorts. L’une nie la présence de l’humain au profit d’une raison toute puissante dont les secrets sont à découvrir, l’autre affirme la présence de cet humain à l’origine de la raison cherchant à percer en soi le secret de l’existence même. A ce sujet, Georges Gusdorf avertit : « Le monologue est le commencement de la folie, l’affrontement d’autrui est le commencement de la sagesse. » (1988, 99). Il est bien question d’une maladie de l’âme dans l’exercice de ces raisons, par monopole de la règle ou de soi, quand la raison existentielle se fait par trop narcissique.
3. La psychopathologie d’une question philosophique majeure
Il y a donc a minima deux rationalités limites, l’une occultant l’existence pour s’ordonner à la représentation symbolique et à une norme déductive soumise aux règles de la raison : cohérence interne et non-contradiction [14] ; l’autre pour laquelle la raison ne se dissocie pas de l’expérience humaine et d’une existence, avec ses valeurs, ses désirs, ses buts et ses inconstances. La question de la psychopathologie liée à l’adoption de ces raisons mérite d’être abordée, car ces postures traduisent un rapport à soi et aux autres qui n’est pas sans rappeler la très brillante analyse de la réification de Joseph Gabel [15] dont nous allons nous inspirer ici pour mieux comprendre ce fantasme de la rationalité totalisante dans ses œuvres. Quant à l’alternative d’une raison existentielle, nous nous inspirerons de Jean Ladrière, mathématicien et philosophe et de son brillant commentateur Louis Perron [16] dont une bonne partie de l’œuvre s’attache à comprendre ce qu’est la raison pour l’homme dans l’accomplissement de son devenir, car, en la raison émerge quelque chose qui l’excède. Nous reviendrons sur quelques enseignements de la phénoménologie par les travaux de Pierre Vermersch [17]. Cette implication de soi dans le langage dénote évidemment une autre psychopathologie où l’être et le dire entretiennent un rapport contraire au premier, l’humain investissant le langage là où le langage prend possession de l’humain dans la rationalité positive.
3.1. Le fantasme de la rationalité totalisante et réflexive
La raison normant la pensée du fait de son pouvoir de prescription induit bien de disparaître au profit de cette seule raison. A tel point que Hans Kelsen met en avant la norme fondamentale comme étant le fruit d’une pensée pure, dénuée d’une volonté particulière, exprimant, comme chez Emmanuel Kant la seule souveraineté d’une raison pure [18], incorruptible, et donc purgée des bassesses humaines, liées à la condition d’existence, aux désirs et intérêts de chacun. Cette rationalité conduit bien à une réification en ce sens qu’elle évacue l’existence humaine d’une raison qui doit trouver les raisons de sa présence dans ses formes pures pour commander les normes de pensée auxquelles il s’agira de se soumettre. Dans son magnifique traité sur La réification Joseph Gabel l’exprime fort bien : « L’univers réifié sera nécessairement le siège d’une dégradation des contenus axiologiques de l’existence. Sa morale sera assez typiquement ce que l’on appelle actuellement la morale objective ; la catégorie de l’efficience s’y substitue à celle de l’intention morale. » (2009, 15). L’axiologie n’a donc pas sa place dans cette rationalité pure à laquelle Hans Kelsen prête la qualité d’être cette norme sans autre raison que d’être celle qui précède et rend possible l’expression des normes et de leur enchainement logique et hiérarchique.
Pour le psychologue, ce renoncement à l’existence humaine dans la quête de la pure rationalité confine à une forme de maladie, où se développe cette même négation de soi, ce qui lui fait dire que cette rationalité est maladive et même morbide, ressemblant bien à cette schizophrénie où le savant et le malade ont un point commun : ce déni de l’existence réelle au profit d’une fascination pour les formes et des imaginaires construits dans leur cohérence : « Le « rationaliste morbide » est un malade chez qui la raison géométrique a pris le dessus par rapport à l’expérience de la réalité vivante. Il ne vit pas dans la durée concrète mais dans un temps géométrique et spatialisé. » (2009, 20). Et Joseph Gabel de préciser : « On est en présence d’une attitude « subréalisante » qui géométrise par suite de son incapacité de se mettre en synchronisme avec la réalité concrète et dialectique. Dans la démarche scientifique proprement dite, il y a également un élément « subréalisant » … . Dans le cas du savant, cette attitude est inévitable par suite de la complexité des faits qu’il aborde. Chez le schizophrène, elle est conditionnée par une déficience de l’élan vital, qui l’empêche de se hausser au « niveau vital » du fait quotidien. » (2009, 39)
Or, la subréalisation[19] a un effet dans ce moment crucial de la pensée des normes où Hans Kelsen fantasme lui aussi cette pure pensée d’une norme dont Charlotte Girard souligne le glissement de la raison formelle à la volonté qui préside à l’exigence de la norme, avant tout contenu normatif. En ce sens, la volonté qui impose une normativité à soi-même comme à autrui n’est rien d’autre, comme le détournera magistralement le Marquis de Sade, que l’expression d’une puissance, d’une volonté personnelle, car il suffit de vouloir en souverain, alors que la souveraineté ne se partage pas ; d’où quelques questions quant aux caractères dominateurs, au sens sadien du mot, de toutes normes exprimant la volonté du dit souverain : « La souveraineté n’est pas en tant que telle un fondement parce qu’elle ne se contente pas d’être ; elle est puissance ; elle est force… . En effet, si elle est omniprésente pour justifier l’obéissance et la mise en œuvre de la volonté politique, elle est également et a fortiori présente à l’origine. » (2010, 1, II, 2, [345]).
Il y a donc dans la quête d’une rationalité pure, totalisante et réflexive, la croyance que tout est dans le discours, que cette objectivation dans le langage vaut réalité et que le langage doit se suffire à lui-même pour constituer un tout cohérent en soi instantanément. L’auteur disparait dans cette logicisation totalisante, mais il resurgit comme instrument d’une volonté normative ; soit l’exigence de la soumission à la norme : l’obéissance si bien soulignée par Charlotte Girard. Rappelons ici que l’obéissance y devient absolue puisque le discours étend son règne sans limitation jusqu’à détruire toute sorte de liberté ou d’initiative. La norme devient la règle d’un commandement intrusif jusqu’à déposséder d’une liberté de penser, d’aller et venir, d’agir et de se comporter [20]. Tout s’apparente alors au délire qui est cohérent, circulaire et en dehors d’un réel. C’est la schizophrénie décrite par Joseph Gabel : « L’hypothèse d’une logique schizophrénique collective (réifiée, anti-dialectique et egocentrique) nous fait mieux comprendre la signification d’un certain malaise logique existant indiscutablement dans la civilisation contemporaine. » (2009, 50). Et en réifiant à l’extrême, émerge une conscience maladive à côté de l’expérience vécue du monde, sous l’emprise du discours comme cause et source d’une réalité propre. Et l’expression de Joseph Gabel sied bien, selon nous, à ce moment de la fondation souveraine de la raison qui confine au solipsisme : « L’ensemble de ces faits réificationnels constitue le phénomène de la Fausse Conscience. » (2009, 19). Et cet isolement par un repli sur soi en soliloque signe l’indifférence au monde extérieur qui conduit très paradoxalement à une confusion entre la totale objectivité et la totale subjectivité. La quête de la raison pure s’apparente ainsi à un syndrome psychotique, cette « fausse conscience », fausse en ceci qu’elle éloigne l’humain de son expérience du monde vécu. Et dans cette attitude de surinvestissement du langage, pour lui laisser à lui seul le pouvoir de normer la pensée et les actes qui s’ensuivent, ce rationalisme totalisant entretient un rapport de soumission à l’ordre de la langue, à la manière d’un langage tutélaire en surplomb, jusqu’au moment d’un retournement dialectique où la soumission se fait injonction de soumission de l’autre à son propre langage ; dès lors que l’assertivité des assertions est comprise comme le moyen d’imposer sa souveraineté sur autrui. En cela la normalisation introduit une intention de soumission d’autrui à l’expression et la signification de la norme dont la performance fait injonction. La norme fait universellement autorité [21].
3.2. La raison existentielle et le risque du narcissisme
La raison existentielle ouvre un autre horizon. Elle fuit cet oubli de l’homme, ne voulant pas disparaître dans une raison instrumentale où l’axiologie n’est pas vécue et pensée et où les finalités sont oubliées. Ici, le langage est historique. Il se déploie dans le temps et il raconte, récite, projette, désire en étant une simple partie d’un système d’où le caractère méréologique d’une pensée qui se sait partie d’une vie et pas la vie. Qu’en est-il de cette raison ? La raison est alors langage de soi à soi, de soi à autrui et conversation sociale ou description des choses. Mais elle est habitée des raisons de s’exprimer et d’échanger pour exister avec autrui dans des récits et échanges. Pour mieux en comprendre les ressorts, il y a une dimension créatrice des relations et de la langue elle-même qui se fait dans la conversation où s’invente des usages de la langue.
Sur ce premier point, comment ne pas renvoyer le lecteur à l’œuvre magistrale du créateur de la logique naturelle, Jean-Blaise Grize, témoignant de la créativité inhérente au langage et à ses usages perpétuellement inventifs de nouveaux ordonnancements : syntaxe, et de nouveaux sens : sémantique ? Sa référence aux sciences naturelles et sa distance avec la seule calculabilité de la pensée et de la langue est très nette : « Si dans le titre de son ouvrage fondateur de 1854, George Boole disait traiter des « laws of thought », la logique formelle s’est imposée comme une discipline normative, non celle évidemment de la pensée dont on ne saurait limiter la liberté, mais comme celle de la seule démonstration. La logique dont je vais esquisser les contours, et que j’appelle un peu maladroitement peut-être logique naturelle, n’a rien de normatif. Elle relève davantage des sciences naturelles que des sciences mathématiques. » (1998, 116). Son souci de l’interlocution, la présence de chacun dans son rapport à sa propre existence et à la compréhension en forme de reconstruction du propos de l’autre montre que le langage résiste à sa propre mise en norme. La langue, sous l’influence de milles usages est évolutive, détournant des sens, transgressant des règles, inventant des termes pour décrire de nouveaux objets ou des sentiments. Là où le dictionnaire fait œuvre de normalisation du langage, l’homme de la rue ou le poète et romancier inventent pour se dire ou dire, jusqu’à contraindre le dictionnaire de faire état de ces novations [22].
La phénoménologie insiste sur cette raison bien peu normative, parce que l’usage du langage correspond à ce qu’en dit justement Pierre Vermersch : « Le point de vue en première personne se confond de manière générique avec le point de vue subjectif, c’est-à-dire ce qui apparaît au sujet de son expérience et, par extension, ce qu’il peut en dire à partir de son propre point de vue. » (2000, 270). Le langage raisonnable est l’expression de quelqu’un qui verbalise en conscience. L’expression succède à un silence, à une anté-prédication et ce qui est d’abord muet advient dans le mouvement de cette expressivité. Et l’expérience humaine se fait aussi sans verbalisation, mais en conscience. A une époque saturée par la communication langagière, l’idée que l’homme échange ou apprend sans langage formalisé : le logos, apparaît comme une incongruité. Or, l’homme peut ne pas s’exprimer, mais simplement pratiquer, s’inspirer en vertu d’un apprentissage vicariant par exemple. Il faut relire Albert Bandura [23] à ce sujet avec le reproduire, l’approprier, le modeler et le créer des gestes et des attitudes sans verbalisation. A cet égard, Pierre Vermersch à raison de rappeler que la vie sociale n’est pas nécessairement verbalisation, et encore moins normalisation : « Les études en formation professionnelle, en ergonomie cognitive, rencontrent sans cesse le cas de professionnels sachant très bien faire ce qu’ils font et incapables de décrire ce qu’ils font en détail. Le décalage entre la réussite en acte et l’incapacité de sa verbalisation est une donnée constante de terrain. » (2000, 277-278)
Cette raison existentielle fait que la personne habite son langage et qu’elle mène un travail sur elle-même, une prise de conscience, une introspection où les mots excèdent leur sens initial, où l’attention à l’autre outrepasse les termes langagiers de l’échange qui n’absorbe pas l’existence de l’autre, face à soi. En ce sens, Emmanuel Levinas invite à fuir l’autre tentation égocentrique d’un langage existentiel obsédé par l’exposé, voire l’exhibition de soi-même, comme le précédent est obsédé par la puissance du dire et de ses lois. L’expression raisonnable est avant tout la tentative de dire sa valeur intime, cette axiologie première, cette éthique qui est-là et qu’il convient de révéler en soi tout en la découvrant par la rencontre de l’autre, comme il l’exprime si bien [24]. De même Paul Ricoeur dans la controverse qui l’oppose à une théorie du langage faisant de ce dernier un objet d’étude délié de ses auteurs, où il rappelle l’existence humaine comme raison des énonciations et interlocutions [25]. Le langage a alors un caractère archéologique pour se trouver soi-même dans une histoire et ses valeurs qui fondent et qu’il faut pouvoir exprimer. Et cette intention primordiale est plus une disposition qu’une expression théorique [26]. En cela, Emmanuel Levinas n’est pas du côté de l’explicitation normative, mais bien du côté de l’intériorité et de la conscience.
Par ailleurs, dans ses commentaires de l’œuvre de Jean Ladrière, Louis Perron, tient compte aussi de cette archéologie mais il témoigne de cette expérience de la raison où il s’agit d’agir dans le monde pour faire advenir un dessein, parce que l’activité de penser au milieu de l’existence humaine vise une relation à l’autre et une relation au monde. C’est l’Eschaton [27] dont il développe une compréhension très fine. La raison ne se déploie pas dans l’histoire, ce qui serait un peu trop hégélien pour Louis Perron [28]. Il montre que la raison ne se suffit pas à elle-même, qu’elle manifeste un désir de complément au-delà du langage, qui est dans l’expérience humaine, la révélation de son expérience du monde et l’espérance en un avenir qui reste à écrire et dans lequel la liberté de parler et d’action existe par cette inspiration de faire. Et si la raison se fait espérance, elle « suppose les attitudes suivantes : l’attente active, l’abandon confiant, l’anticipation dans l’effectivité de ce qui ne se laisse pressentir que comme à venir. » (2005, 223), soit des attitudes bien éloignées du positivisme.
Dans une culture aujourd’hui encore très positiviste, nous avons voulu insister ici sur une meilleure compréhension de la raison existentielle et de son rapport au langage. Mais sur un plan psychopathologique, cet investissement de soi dans la parole et le langage fait que la personne humaine peut dériver dans des considérations narcissiques où la narration conte l’histoire de soi jusqu’à oublier l’autre dans une autre sorte de monologue à la manière d’une exhibition de soi ; sans aucune considération pour l’autre. Cet intérêt pour soi peut devenir narcissique : se dire et se créer soi-même dans un narratif qui peut confiner à la mythomanie. Cette invention de soi par cette quête obsessionnelle de se dire peut faire oublier l’autre. C’est le risque de la philosophie existentialiste et d’une pratique narcissique de la phénoménologie. Ce sont ces limites que nous devons maintenant approfondir.
4. Les deux limites psychopathologiques
Chacune de ces figures a évidemment ses limites et elles dénotent des pathologies dès lors qu’elles sont exclusives l’une de l’autre, occultant l’autre raison de la raison. Il ne s’agit pas ici d’émettre un jugement philosophique quant à la validité de chacune de ces raisons, mais de s’interroger sur les phénomènes de dérives aux limites. En résumé, la première révèle une tendance psychotique de type schizophrénique, la seconde une tendance névrotique de type narcissique.
4.1. La tendance schizophrénique
Le chemin vers la schizophrénie suppose de s’éloigner progressivement du réel. Cette perception perturbée de la réalité s’accompagne de productions imaginaires qui vont jusqu’aux idées délirantes et hallucinations. En reprenant la raison comme logos, ce rapport à la raison et au langage rationnelle qui s’ensuit peut dériver jusqu’à échapper au réel. La démarche expérimentale si bien décrite par le docteur Claude Bernard reste liée au réel. Elle tire son crédit des résultats obtenus par la formulation des hypothèses, des expériences respectant des protocoles et des résultats documentés et reproductibles. Il y a là une relation d’adéquation au réel et le langage rationnel reste dépendant de ce qu’il observe. Le médecin ou l’ingénieur sont de ces praticiens de cette raison expérimentale. Cette raison peut dériver vers plus de théorisation et de concepts pour construire des modèles dont la cohérence interne primera les expériences. Ce processus d’idéalisation est utile pour créer des cadres théoriques, mais elle éloigne du réel au profit d’une perception perturbée par l’attirance pour le formalisme. Enfin, la logicisation opère pour rompre avec le réel et basculer dans des logiques de l’imaginaires – j’emprunte l’expression à Leibniz – où le langage symbolique devient l’objet scientifique lui-même et d’une certaine manière sa propre fin, cas des mathématiques et des langages symboliques évidemment. Cette déréalisation au profit d’un monde imaginaire de substitution est manifeste dans l’enseignement pythagoricien et platonicien jusqu’à faire préférer les idéalités, contre le vil monde quotidien.
L’esprit normatif positiviste procède du même cheminement, partant d’un besoin d’organiser le réel jusqu’à constituer un corpus de textes qui devient progressivement la seule réalité d’une population d’experts pour qui le corps des normes devient l’objet réel à travailler pour en assurer la cohérence et le développement pour lui-même. Ce glissement rappelle ce qu’on dit de la dérive de l’administration byzantine délirante, et il révèle l’emprise du langage formalisé sur son objet jusqu’à l’écarter, au profit de la réalité du langage devenant ce nouveau monde idéal, voire ce monde déliré, fantasmé [29]. Cela explique que de très nombreuses normes sont jugées inappropriées, inapplicables, mais le propos de l’homme de terrain pris dans sa relation expérimentale au monde ne résiste pas à la pression pathologique de la société en cours d’idéalisation schizophrénique.
4.2. La tendance narcissique
Elle procède d’une dérive semblable, partant de la réalité de l’existence plus que de l’expérience du monde dans le cas précédent. C’est la prédisposition au narcissisme. Celui-ci s’observe par une préférence grandissante pour soi, ce soi devenant le seul objet d’attention jusqu’à, là aussi, oublier la réalité des autres existences, qui se traduit ordinairement par une perte d’empathie et une inattention pour les désirs et vécu d’autrui. L’intérêt pour soi allant jusqu’à imaginer que l’autre ne peut s’intéresser qu’à moi. Ce chemin vers le narcissisme suppose lui aussi de s’éloigner du réel. La raison, existentielle pour laquelle la raison est récit et interprétations marque sa préférence pour une démarche d’introspection puis d’expression de soi, de ses états de conscience, de ses expériences de pensée, de sentiment et de vie. La dérive opère quand l’objet de ce langage devient soi-même, sa seule personne, jusqu’à monopoliser l’attention dans un excès de narcissisme. Je parle de moi et le récit confine au monologue, au soliloque qui a besoin d’un auditeur jusqu’à l’oublier dans un autre type de délire où l’on se parle de soi à soi dans une conscience totalement égocentrée, dérivant vers la mythomanie dans un récit qui a sa vérité propre.
4.3. L’époque de la normativité des schizophrènes et des narcissiques
Or, l’époque contemporaine semble faire triompher simultanément ces deux tendances pathologiques apparemment contraires. La complexification des sciences et la complexité croissante des institutions politiques induisent bien cette pathologie schizophrénique, par un éloignement du réel qui entre d’ailleurs en opposition avec les « réalistes », leur contestant leur réalité, critiquant leur incompréhension, voire leur inintelligence parce que la norme est juridico-scientifique, indispensable pour enrégimenter un monde indocile. La fascination pour le devoir être ordonné du monde passe par sa logicisation qui peut valoir substitution. Dans le même temps, la fascination pour l’individu et le règne de ses droits induisent bien l’autre pathologie narcissique, avec un autre éloignement du réel qui conteste aux autres le droit de désirer autre chose, jusqu’à créer une autre surdité au monde des altérités, par l’injonction des minorités dont les droits sont à sanctuariser dans des normes imposant leur règle à autrui dans un triomphe narcissique où le mot d’ordre est : tu dois dire de moi ce que je dis que je suis, soit la dictature narcissique de son récit sur soi que les autres doivent subir comme une norme [30].
Le lecteur aura noté qu’il y a une grande similitude dans les deux mouvements vers la schizophrénie et vers le narcissisme. Ils ont en commun plusieurs facteurs. Le premier, celui d’une déréalisation au bénéfice d’une autorité accordée aux propriétés du langage, même si une réalité sert encore de prétexte : soi ou l’objet de science. Le second, celui d’une emprise des lois internes de ce langage pris comme objet au lieu et place de ce dont il était antérieurement une représentation. Le discours narcissique devient récit jusqu’à la mythomanie de se créer soi-même dans un récit délirant. Le discours schizophrénique devient logique pure jusqu’à la fantasmatique de créer le monde dans une logique imaginaire tout aussi délirante. Si le mythomane invente son récit sur lui-même, perdant tout contact avec sa réalité personnelle, le fantasmatique est aussi dans un imaginaire extra-lucide d’une vision de l’ordre du monde.
Avant de conclure, comment ne pas observer ici l’œuvre de dérives individuelles et sociales à la fois dans les deux dérives, apparemment contraires, de la schizophrénie et du narcissisme. Des termes empruntés à la psychiatrie prennent ici leur sens : délire et hallucination, mais aussi rêve du monde ou de soi, soit la norme comme création d’un monde onirique par une connaissance en forme de fiction.
Les délires et hallucinations emportent, selon nous, ceux des logiques de l’imaginaire comme ceux des récits mythomaniaques. Il y a dans les deux cas une propension aux délires dans un récits sur le monde ou sur soi.
Les rêves et connaissances fictives emportent, selon nous, ceux d’une identification à une fiction symbolique ou narrative qui peuvent se rejoindre.
Conclusions
L’esprit normatif que nous avons étudié ici procède d’une déréalisation du monde au profit d’une construction délirante alternative, dès lors que la démarche expérimentale ou la raison existentielle dérivent dans leurs délires pathologiques. Rappelant les enseignements de Sigmund Freud, Vassilis Kapsambelis montre bien que la déréalisation opère tant dans les névroses narcissiques que dans les psychoses schizophréniques : « La névrose renonce à la recherche de l’objet dans le monde extérieur, tout en conservant sa représentation interne, alors que la psychose « perd la réalité » aussi bien dans le monde externe que dans le monde interne, et c’est précisément à cette perte de réalité que vient répondre la construction délirante. » (2013, 751).
L’esprit normatif fabrique ainsi un monde onirique par un récit mythomaniaque imposant sa vérité normative narcissique, dont les droits des minorités sont une preuve contemporaine ou par une logique pure imposant son autre vérité normative schizophrénique, dont les normes bureaucratiques sont une autre preuve. Les connaissances de soi et du monde disparaissent dans une connaissance fictionnelle construisant à l’infini des règles, pour les imposer au monde et à autrui, moyens de domination ou d’asservissement de l’autre et du monde sans autre but ni morale.
Or, les raisons expérimentales et existentielles sont un éveil à l’axiologie, soit une forme d’extériorité où préexistent une morale portée par une intériorité éclairée par des textes « sacralisés » et des réalités préexistantes à leur étude. Elles sont un second éveil à l’eschatologie, soit une seconde forme d’extériorité où s’annonce des finalités portées par des croyances spirituelles ou politiques collectives et des projets de science.
La psychopathologie de l’esprit normatif aura, espérons-le, dans ce travail, montré l’occultation de toute sorte d’extériorités radicales. Et les deux dérives pathologiques observables dans l’époque contemporaine ont en commun l’Absolu du soi ou l’Absolu du logos ; et les deux éloignent de l’épreuve de l’altérité et des extériorités. Le temps des normes est ainsi celui d’un repli dans un monde rassurant, celui d’une fiction scripturaire : la norme et son récit. Les schizophrènes imposent la récitation des normes et les narcissiques la norme de leur récit, les deux sacrifiant l’expérience des choses et l’existence des autres, soit à travers cette négation des extériorités, le refus des valeurs et des fins, enfermés dans un caprice onirique : le monde rêvé au lieu du monde vécu.
Bibliographie
ABENSOUR, Liliane. 2008. La tentation psychotique. Paris : PUF
AMSELEK, Paul. 1986. Théorie des actes de langage, éthique et droit. Paris : PUF
AMSELEK, Paul. 1992. Ontologie du droit et logique déontique. Paris : Rapport de la journée d’Etudes sur le raisonnement juridique. Association Internationale de Philosophie du Droit et de Philosophie Sociale
AMSELEK, Paul. 2022. Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en générales. Paris : Panthéon-Assas
ARENDT, Hannah. 2024. Gouverner. Loi, pouvoir et domination. Paris : Payot
BABEL, Joseph. 2010. La reification. Paris : Allia
BAILHACHE, Patrice. 1991. Essai de logique déontique. Paris : Vrin
BANDURA, Albert. 1977. Social learning theory. New Jersey : Prentice-Hall
BANDURA, Albert. 2007. Auto-efficacité : le sentiment d’efficacité personnelle. Paris : De Boeck
BERTRAND, Michèle. 2015. Imposteur, faussaire, menteur pathologique. Mensonge pathologique et clivage du moi : une question d’identité. in Revue Française de psychanalyse. Vol. 79. p. 108-119
BILHERAN, Ariane. 2023. Psychopathologie du totalitarisme. Paris : Trédaniel
CAYLA, Olivier. 1992. La notion de signification en droit : contribution à une théorie du droit naturel de la communication. Paris : université Paris 2
DAMASIO, Antonio. 2021. L’erreur de Descartes : la raison des émotions. Paris :
ENGEL, Pascal. 1997. Normes logiques et évolutions. Paris : Revue Internationale de Philosophie. vol.51. n°200. p. 201-219
ENGEL, Pascal. 1989. La norme du vrai, philosophie de la logique. Paris : Gallimard
GABEL, Joseph. 2009. La réification. Essai d’une psychopathologie de la pensée dialectique. Paris : Allia
GARDIES, Jean-Louis. 1972. Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique. Paris : L.G.D.J.
GARDIES, Jean-Louis. 1979. Essais sur la logique des modalités. Paris : PUF
GIL, Fernando. 2000. La conviction. Paris : Flammarion
GIRARD, Charlotte. 2010. Des droits fondamentaux au fondement du droit
Réflexions sur les discours théoriques relatifs au fondement du droit. Paris : La Sorbonne – édition électronique
GRIZE, Jean-Blaise. 1998. Logique naturelle, activité de schématisation et concept de représentation. in Cahier de praxématique. 31. p.115-125.
GUSDORF, Georges. 1988. La parole. Paris : PUF
HONNETH, Axel. 2007. La réification : Petit traité de Théorie pratique. Paris : Gallimard
KALINOWSKI, Georges. 1953. Théorie des propositions normatives.
KALINOWSKI, Georges. 1972. La logique des normes. Paris : PUF
KALINOWSKI, Georges. 1996. La logique déductive : essai de présentation aux juristes. Paris : PUF
KALINOWSKI, Georges. 1980. Loi juridique et loi logique. Contribution à la sémantique de la loi juridique. Paris : Archives de Philosophie du droit. 25. p. 123-136
KALINOWSKI, Georges. 1981. Obligations, permissions et normes. Réflexion sur le fondement métaphysique du droit. Paris : Archives de Philosophie du droit. 26. p. 331-343
KALINOWSKI, Georges. 1983. La genèse d’un système de logique des normes, Informatica e diritto. 9. p. 251-267
KAPSAMBELIS, Vassilis. 2013. Interpréter le délire : sens et contre-sens. in Revue Française de psychanalyse. Vol. 77, p. 748-761
KELSEN, Hans. 1962. Théorie pure du droit. Paris : Dalloz
KELSEN, Hans. 1996. Théorie générale des normes. Paris : PUF
LADRIERE, Jean. 1957. Les limitations internes des formalismes. Etude sur la signification du théorème de Gödel. Paris : Gauthier Villars
LALANDE, André. 1948. La raison et les normes. Paris : PUF
LESNIEWSKI, Stanislaw. 1989. Sur les fondements de la mathématique. Paris: Hermès
LEVINAS, Emmanuel. 1982. Ethique et infini. Paris : Fayard
MARITAIN, Jacques. 1947. Raison et raisons. Paris : Egloff et LUF
MIEVILLE, Denis. HOUDE, Olivier. 1993. Pensée logico-mathématique. Paris : PUF
PERRON, Louis. 2005. L’eschatologie de la raison selon Jean Ladrière. Pour une interprétation du devenir de la raison. Sainte-Foy (Québec) : Presses Universitaires de Laval
RICOEUR, Paul. 1990. Soi-même comme un autre, Paris : Seuil
SEGUIN, Charlotte. DES PORTES, Vincent. BUSSY, Gérald. 2015. Évaluation neuropsychologique du trouble de l’inhibition dans le TDAH : de la théorie à la clinique. in Revue de neuropsychologie neurosciences cognitives et cliniques. n° 7(4). p. 291-298
VERMERSCH, Pierre. 2000. Conscience directe et conscience réfléchie. in Intellecta. 31. p. 269-311
VERMERSCH, Pierre. 2012. Explicitation et phénoménologie. Paris : PUF
VERNANT, Denis. 2014. La logique des normes juridiques de Georges Kalinowski. Paris : L’Harmattan. Al-Mukhatbat. 12. p. 157-174
VERNANT, Denis. 1997. Du discours à l’action. Paris : PUF
VOLKEN, Henri. 1996. Loi, norme, logique. Paris : Droz. Revue européenne des sciences sociales. T34. n° 104. p. 171-179
VON WRIGHT, Georg Henrik. 1951. Deontic Logic. Mind. Vol. 60. n° 237. p. 1-15
VON WRIGHT, Georg Henrik. 1953. Norm and action. London : Routledge & Kegan Paul Ltd
[1] Henri Volken, mathématicien, devenu professeur de sciences sociales et politique à l’université de Lausanne résume très bien cette aspiration à la rationalité dans son introduction à son article de 1996 : Loi, norme, logique : « Qu’est-ce qui fait la force et l’unité de la pensée rationnelle sinon la foi en l’existence de lois universelles qui la régissent ? C’est également cette foi qui explique son incroyable succès dans le domaine des sciences. Car même si des moyens rhétoriques d’une autre nature interviennent dans (presque) tout discours argumentatif, il semble que ce soient quelques principes généraux d’ordre logique, qui structurent ce discours et lui donnent un aspect rigoureux et un effet de persuasion réel. … Aristote, le premier, a tenté d’en donner une représentation. Sa description, même fragmentaire, d’une telle loi, est à l’origine de la logique formelle. Le syllogisme catégorique qu’Aristote définit dans ses Premiers analytiques, a été longtemps considéré comme l’outil principal de la pensée déductive. » (1996, 171).
[2] Charlotte Girard est aujourd’hui maître de conférences à l’université de Nanterre, habilitée à diriger des recherches
[3] Le philosophe du droit Paul Amselek, professeur émérite à l’université Panthéon-Assas, fut aussi directeur du Centre de philosophie du droit, confirme bien ce logicisme d’inspiration positiviste de Hans Kelsen, lui reprochant de faire l’impasse sur la généalogie du droit et le processus de sa création dans la société, montrant que la position est à la fois atemporelle, normative et totalitaire, par négation de sa possible création progressive et des auteurs de ces normes : « Le logicisme consiste à méconnaître complètement la « chosité » même des normes juridiques en vigueur dans nos société, leur nature d’outils historiquement constitués par des démarches humaines créatrices, pour ne pas voir en elle que du logos, de simples séquences de pensée discursive, de simples propositions que l’on peut traiter, d’une manière pour ainsi dire totalement désincarnée, comme des éléments non pas d’un processus socio-historique de commandement public, mais d’un simple processus logique de pensée du raisonnement. » (1992, 2)
[4] Olivier Cayla est directeur de recherche à l’EHESS où il enseigne la théorie des normes, en croisant les grands textes de la philosophie politique moderne et les décisions les plus récentes de la jurisprudence constitutionnelle et administrative.
[5] Dans son article Normes logiques et évolutions, Pascal Engel, philosophe du langage et de la logique explore les raisons de la raison, c’est-à-dire ce qui explique l’activité rationnelle et qui pourrait être cette norme fondamentale : « Peirce comparait la normativité des règles logiques à la normativité des règles morales, et celle de ces dernières à la normativité de certaines conduites. Il envisageait que les normes logiques, comme celles de la conduite, soient le produit de certaines habitudes mentales ou dispositions, elles-mêmes produites par l'évolution. En ce sens, nos croyances logiques, c'est-à-dire nos croyances du second-ordre au sujet de nos croyances à nos "leading principles" peuvent bien être le produit de l'évolution, et provenir des sentiments d'approbation que nous éprouvons à la suite d'une longue histoire interactive avec nos semblables (qui les ont approuvées). Mais si cette capacité générale à avoir des systèmes référentiels et à les approuver (à les considérer comme des normes) a évolué, il ne s'ensuit pas que le contenu des règles inférentielles elles-mêmes soit dérivable d'une histoire évolutionniste. A partir du moment où ces règles énoncent certains idéaux de pensée et d'action, leur origine devient opaque, et c'est cette opacité même qui est le signe de leur normativité et leur rationalité. » (1997) La raison se déploie dans une évolution et une histoire sans livrer son secret ici et maintenant.
[6] Charlotte Girard développe une analyse intéressante entre logique et linguistique où se joue l’introduction du locuteur. Elle motive brillamment cette fondation par la volonté et la souveraineté du législateur, comme lors d’une constituante où la décision souveraine fait autorité pour fonder. Le lecteur notera ici le lien avec l’intuition cartésienne du Cogito dont la présence même manifeste l’être dans une intuition immédiate du type Cogito sum ; sans inférence malgré la mésinterprétation popularisée sur le raisonnement cartésien : « Le fondement se dissout dans l’activité cognitive qui mérite d’être appelée « fondatrice » car elle établit la connaissance dans le mouvement qui s’élabore. Cette distinction permet de glisser vers la notion de souveraineté : la souveraineté de la norme fondamentale elle-même, mais également la souveraineté ce l’auteur de cette norme. Les notions de fondement et de souveraineté s’imbriquent littéralement pour suggérer celle d’un auteur. » (2010, 1, II, 2, [341]). Elle montre que la première norme n’a pas d’autre contenu que d’énoncer l’injonction normative comme une exigence volontaire dont le mot est le réceptacle : « Penser la norme fondamentale ne peut suffire pour qu’elle produise des effets dans l’ordre normatif. C’est l’acte de volonté dont elle est la signification qui peut lui donner la force nécessaire à son effectivité, autrement dit à sa normativité. » (2010, 1, II, 2, [334])
[7] Pascal Engel résume bien ce rapport à l’évidence rationnelle dans son article Normes logiques et évolutions : « La logique est une discipline normative. Quand nous disons qu'un raisonnement est correct, ou valide, nous voulons dire qu'il s'accorde avec certaines règles ou normes du raisonnement correct que nous acceptons. Ces règles ou normes se caractérisent par le fait qu'elles nous paraissent intuitivement évidentes. En ce sens, les règles ou les normes logiques sont comparables, comme le dit Peirce, aux règles de la conduite, aux normes morales. Ce sont des impératifs ou des prescriptions que nous suivons. Mais que sont ces normes ? D'où viennent-elles ? Dans la mesure où une norme ou une règle contient un élément impératif ou prescriptif, elle n'est ni vraie ni fausse. On la suit ou on ne la suit, pas, on s'y conforme ou non. Mais elle ne correspond à aucune réalité. D'un autre côté, les normes et principes logiques semblent aussi être vrais ou faux, correspondre à des faits. Pas des faits empiriques, mais des faits nécessaires. Quand on ouvre un manuel de logique, on ne voit qu'une série de propositions. On nous dit que certaines sont toujours vraies, et que d'autres s'ensuivent en vertu de celles-là. Mais ce faisant on en reste à un niveau purement descriptif, et en ce sens la logique est seulement une description de certaines vérités. D'où la réponse suivante : ce que les normes logiques ont de normatif, elles le doivent à l'existence de faits d'un type spécial, des lois ou les vérités logiques, qui décrivent une réalité particulière, celle des "lois de l'être-vrai". » (1997)
[8] Le lecteur peut lire à ce sujet notre précédent article La dystopie de la pensée calculante et le projet d’une pensée automatique sans conscience in Cahiers de psychologie politique, n°36 – 2020 où nous revenons sur la conception positiviste de l’esprit et des activités cognitives qui étendent leur postulat jusqu’à confondre calculer et penser.
[9] Stanislaw Lesniewski dévoile toute l’hypocrisie des logiciens cherchant à masquer l’auteur dans le symbolisme des assertions qui ne sont pas des affirmations, mais des propositions vraies d’elles-mêmes indépendamment de celui qui la professe. Or, l’assertion est aussi une figure de rhétorique dont le logicien explique fort bien qu’elle est une « confession déductive ». L’assertion a bien un auteur et l’acte d’assertion consiste à émettre un jugement ou obtenir l’assentiment du lecteur quant à sa reconnaissance de ce statut particulier selon lequel cette proposition est valide car assertée à raison, soit privée d’un auteur pour feindre de son universalité. Le logicien, non sans ironie écrit : « Les axiomes et les théorèmes en question constatent seulement que les créateurs de la théorie donnée assertent ceci et cela et, partant, que ce sont des propositions parlant spécifiquement des auteurs de la théorie ; le système composé de telles propositions n’est assurément pas un système logique ; on pourrait le considérer plutôt comme une sui generis confession déductive des auteurs de la théorie en question. » (1989, 39). A ce sujet, les propositions sont pour les logiciens un fait alors que pour le linguiste, le plus souvent, les propositions sont des énoncés, soit des actes. Le polonais est novateur car il fait exception pour intégrer le locuteur dans la proposition. Les propositions sont donc des événements objectifs, les énoncés sont des pratiques subjectives. Paul Ricoeur distingue lui aussi magistralement cet écart d’analyse qui divise entre une étude objective de la langue et une herméneutique : « Je rappelle la formule de Récanati : « dans le sens d’un énoncé se réfléchit le fait de son énonciation. » (La Transparence et l’Enonciation, p.7). Une telle déclaration devrait nous étonner dans la mesure où elle attache la réflexivité à l’énonciation traité comme un fait, c’est-à-dire comme un événement qui se produit dans le monde. Ce qu’on appelait tout à l’heure acte est devenu un fait, un événement qui a lieu dans l’espace commun … un fait survenant dans le même monde que les faits et les états de choses visée référentiellement par les énoncés déclaratifs ou assertifs. » (1990, 63). Il est de nouveau bien question d’assertion, et la pratique ou la science du langage dénote une posture pathologique au dire, expression de soi ou objectivation par exemple.
[10] Dans Soi-même comme un autre, Paul Ricoeur fait état des recherches qui conduisent à une théorie de l’énonciation comme jeu des intentions, très loin d’un rapport positiviste au langage : « toute énonciation consiste en une intention de signifier qui implique dans sa visée l’attente que l’interlocuteur ait de son côté l’intention de reconnaître l’intention première pour ce qu’elle veut être. L’interlocution ainsi interprétée se révèle être un échange d’intentionnalités se visant réciproquement. » (1990, 59-60).
[11] Georges Gusdorf développe une dualité centripète et centrifuge du langage : « D’une part la fonction expressive du langage :Je parle pour me faire entendre, pour déboucher dans le réel, pour m’ajouter à la nature. D’autre part la fonction communicative : je parle pour aller aux autres et je me joindrai à eux d’autant plus complètement que je laisserai davantage de côté ce qui est à moi seul. La double polarité de l’expression et de la communication correspond à l’opposition entre la première personne et la troisième, entre la subjectivité individuelle et l’objectivité du sens commun. » (1988, 52)
[12] Paul Ricoeur développe dans Soi-même comme un autre, une herméneutique de soi en procédant par plusieurs études. Il commence par la personne et la référence identifiante puis un travail sur l'énonciation et le sujet parlant où le « Je » est irréductible au monde que la langue peut décrire, le sujet s’engageant dans le futur par une sémantique de l'action sans agent où se joue la dualité mentionnée par Georges Gusdorf. Les dernières études permettent de révéler le pouvoir du récit de soi dans l’identité personnelle et l'identité narrative, le langage ayant une fonction de préservation de cette identité de soi dans la continuité d’une narration : conscience réfléchie dans la durée par la continuité de son récit sur elle-même/soi-même. La dimension psychologique est d’ailleurs essentielle dès sa préface : « l’identité-ipse met en jeu une dialectique complémentaire de celle de l’ipséité et de la mêmeté, à savoir la dialectique du soi et de l’autre que soi. Tant que l’on reste dans le cercle de l’identité-mêmeté, l’altérité de l’autre que soi ne présente rien d’original : « autre » figure, comme on a pu le remarquer en passant, dans la liste des antonymes de « même », à côté de « contraire », « distinct », « divers », etc. » (1990, 13)
[13] Emmanuel Levinas décrit ce rapport à la langue, la raison et autrui où la raison n’est pas connaissance mais rencontre de l’autre : « La connaissance : elle est par essence une relation avec ce qu’on égale et englobe, avec ce dont on suspend l’altérité, avec ce qui devient immanent, parce que c’est à ma mesure et à mon échelle. … La connaissance est toujours une adéquation entre la pensée et ce qu’elle pense. Il y a dans la connaissance, en fin de compte, une impossibilité de sortir de soi ; dès lors, la socialité ne peut avoir la même structure que la connaissance. » (1982, 52)
[14] Paul Amselek résume bien cette foi positiviste en la vertu cardinale des lois de la pensée rationnelle comme fondement ultime des normes juridiques : « C’est à cette fantastique ou hallucinante alchimie que s’adonnent, la logique déontique, tous ceux qui prétendent appliquer aux normes, et notamment aux normes juridiques, les principes logiques de non-contradiction, d’une part, et d’inférence d’autre part. » (1992, 19) Et son vocabulaire : « fantastique ou hallucinante alchimie » dénote bien cette folie de la raison raisonnante jusqu’au solipsisme hors de l’expérience et du réel avec son caractère fantasque et hallucinatoire qu’exercent alors les figures logiques prenant possession de l’esprit des logicistes.
[15] Joseph Gabel, psychiatre et sociologue et philosophe d’inspiration marxiste ; il analyse la sur-rationalisation comme un phénomène utilitariste, privé de temporalité et de dialectique pour produire un univers mental et politique concentrationnaire, considérant que cette conscience réifiée, qu’il emprunte aux travaux de Georges Lukas, résulte d’une schizophrénie croissante conduisant à une dépersonnalisation, une déréalisation et une dégradation de l’expérience dialectique. Sa discipline de psychiatre et sociologue nous inspire dans la démarche de cet article.
[16] Louis Perron est l’auteur d’un des meilleurs commentaires de l’œuvre de Jean Ladrière dans L’eschatologie de la raison selon Jean Ladrière. Pour une interprétation du devenir de la raison s’intéressant à la portée de la raison comme révélation progressive d’une eschatologie par l’articulation du sens. Rappelons ici que Jean Ladrière est cet immense mathématicien et philosophe qui a su récapituler les enseignements logiques et mathématiques dans Les limitations internes des formalismes. Étude sur la signification du théorème de Gödel publié en 1957.
[17] Pierre Vermersch, psychologue, psychothérapeute a été le créateur des entretiens d’explicitation. Il développe une approche psychologique inspirée de la micro-phénoménologie s’intéressant aux pratiques et représentations selon qu’elles soient en première personne, deuxième personne, etc. où les phénomènes de symbolisation et de distanciation sont très intelligemment mis en évidence dans leurs enjeux cognitifs et psychologiques.
[18] Charlotte Girard décrit très bien comment Hans Kelsen rejoint la pensée kantienne dans son rationalisme épuré où la norme fondamentale ne peut-être qu’une pensée pure indémontrée : « Kelsen reconnait lui-même la difficulté de ne pas pouvoir prouver que la norme fondamentale serait supérieure à toute autre. IL déduit du caractère inévitable de cette impasse que « la norme fondement ne peut qu’être supposée ». Au caractère fictif de la volonté qui serait à l’origine de la norme fondamentale, correspond le caractère supposé de la norme qui fonde l’ordre juridique. » (2010, 1, II, 2, [325]). Nous abordons cette question dans l’article La perversion du principe d’apathie publié dans les Cahiers de psychologie politique, n° 35 – 2019. Il s’agit de ce point de bascule où la volonté et la raison peuvent se confondre et l’application de la raison se « dévoyer » dans la raison des savants libertins de Sade.
[19] Dans son article de 1992 Ontologie du droit et logique déontique le philosophe du droit Paul Amselek décrit bien cette dérive logiciste qui conduit à évincer le réel pour ne chercher que la perfection de la forme logique des propositions : « Le terrain d’élection du logicisme, dans la théorie du droit comme dans celle de l’éthique en général, c’est assurément celui de la logique des normes ou logique déontique : en se donnant pour tâche de travaille sur le matériau de logos des normes, la logique déontique en vient le plus souvent – par une espèce de pente fatale – à raisonner comme si la réalité même des règles, et notamment des règles juridiques, se bornait à ces seuls segments de logos. » (1992, 4)
[20] Hannah Arendt décrit cette situation où les lois règnent sur tout, au nom d’une prédominance du logos : « dans l’hypothèse où une loi dirige toutes les choses morales et politiques, le domaine privé et le domaine public de la vie ne sont plus clairement distingués, mais sont l’un et l’autre inscrits dans et dirigés par l’ordre éternel de l’univers. » Le positivisme pratique la substitution totale du monde par le langage imposant son ordre formel au monde. (2024, 23)
[21] Hannah Arendt explique la paternité kantienne de cette primauté de la loi comme forme ultime d’exercice du gouvernement, portant en elle-même ce risque de règlement totale de la vie dans la légalité : « Tout au bout de cette tradition, nous trouvons la philosophie politique de Kant, où le concept de loi a absorbé tous les autres. Ici, la loi est devenue le critère de la totalité du champ politique … . La légalité est le seul contenu légitime de la vie commune des humains, et toute activité politique est finalement conçue comme une législation ou l’application de prescriptions juridiques. » (2024, 28)
[22] J’en veux pour preuve les articles de mes amis sémiologues et linguistes dans les Cahiers de psychologie politique, en particulier le n°42 de 2023 consacré à Langues et politique en Afrique à propos de l’invention du Nouchi en Côte d’Ivoire dont notre éditorial exprimait l’esprit : « Là où beaucoup voient dans les langues des objets figés, François-Joseph Azoh et Kouakou Daniel Yao, respectivement psychosociologue à l’université Felix Houphouët-Boigny d’Abidjan et criminologue enseignant à l’université Jean Lorougnon de Daloa nous rappellent que les langues sont en vie, qu’elles véhiculent des croyances et sont la marque d’un héritage comme d’une volonté politique, au travers des représentations sociales qu’elle produisent où dont elles sont le signe. Sy Daniel Traoré et Youssouf Ouédraogo de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou au Burkina Faso s’intéressent à l’influence migratoire et à ses influences sur la pratique d’une langue initialement commune : le français, entre Burkina Faso et Côte d’Ivoire. Dorgelès Houessou de l’université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d’Ivoire étudie ces appropriations littéraires et populaires d’une langue et les émergences de pratique inédites, jusqu’à produire des parlers-parlés nouveaux qui feront demain de nouvelles langues, comme autant de manière de vivre un commun. Son collègue de Bouaké, Kouassi Kpangui étudie ces phénomènes de métissage par des emprunts multiples à des langues locales et étrangères qui renouvellent et fabriquent des nouvelles représentations. Mais ces évolutions linguistiques sont aussi les manifestations d’évolutions politiques, sociales et démographiques. Moulo Elysée Kouassi s’attarde plus aux enjeux philosophiques et sociologiques de ce Nouchi. Cette créativité populaire interpelle les normalisateurs des langues qui aspirent à une fixité, prélude d’une langue morte. Lui montre que l’évolution de la langue contribue à la construction d’un être-collectif. Jean-Claude Dodo montre bien comment ce parlé, né dans des milieux marginaux est devenu la langue de tous, présente maintenant dans la publicité et le langage ordinaire, soutenu par une jeunesse qui y voit une expression de sa culture et de son identité. »
[23] Albert Bandura a développé une théorie de l’apprentissage vicariant essentielle pour démontrer que l’observation, l’imitation partielle, la reproduction, l’inspiration de l’autre agissant se font en très grande partie en dehors de l’objectivation du langage. A cet égard, les remarques de Pierre Vermersch sur l’impossibilité d’exprimer son savoir-faire ; même pour des experts, attestent d’une pratique dont la conscience réfléchie en un langage en vue de sa transmission est absente, voire une médiatisation entropique, car son apprentissage requiert plus les conditions de la vicariance exposées par Albert Bandura. La volonté d’objectivation est en soi une norme positiviste très critiquable qui dépossède le praticien de son savoir pour le reconstruire dans une norme d’action élaboré par l’expert.
[24] Dans Ethique et infini il insiste sur la place de la littérature et des textes sacrés dont la Bible pour interroger la rationalité positive et systématique de la philosophie occidentale : « A aucun moment la tradition philosophique occidentale ne perdait à mes yeux son droit au dernier mot ; tout doit, en effet, être exprimé dans sa langue ; mais peut-être n’est-elle pas le lieu du premier sens des êtres, le lieu où le sensé commence. » (1982, 15)
[25] Dans sa critique d’une étude de la langue sans son sujet, il rappelle les acquis de la théorie de l’énonciation qui véhiculent une philosophie existentialiste du langage : « N’a-t-on pas perdu là de vue deux des conquêtes les plus précieuses de la théorie de l’énonciation, à savoir : 1) que ce ne sont pas les énoncés, ni même les énonciations qui réfèrent, mais les sujets parlants usant des ressources du sens et de la référence de l’énoncé pour échanger leurs expériences dans une situation d’interlocution. 2) que la situation d’interlocution n’a de valeur d’événement que dans la mesure où les auteurs de l’énonciation sont mis en scène par le discours en acte et, avec les énonciateurs en chair et en os, leur expérience du monde, leur perspective sur le monde à quoi aucun autre ne peut se substituer ? » (1990, 64)
[26] En réponse à une question de Philippe Nemo, dans ses entretiens déjà cités, qui porte sur la différence entre sa position et la pensée de Edmond Husserl, il souligne : « Vous oubliez l’importance chez Husserl de l’intentionnalité axiologique dont je viens de parler ; le caractère de valeur ne s’attache pas à des êtres à la suite de la modification d’un savoir, mais vient d’une attitude spécifique de la conscience, d’une intentionnalité non théorétique, d’emblée irréductible à la connaissance. » (1982, 22) Son propos, mille fois décliné dans ses entretiens consiste à exprimer cette raison à l’œuvre comme exercice de la conscience, introspection et recherche en soi, qui ne fait pas l’objet d’une objectivation et d’une extériorisation en une norme de conduite à tenir.
[27] Louis Perron précise concernant l’Eschaton : « La présence de l’eschaton à l’actualité de la raison est de l’ordre de l’espérance …. L’eschaton échappe, par principe, à un rapport de vision et de réalisation ultime effective. Il s’ensuit qu’il esquive, à l’instar de l’horizon, toute totalisation et toute représentation. » (2005, 222)
[28] Il précise à ce sujet : « Le futur encore à venir n’apparaît que comme une simple conséquence de ce qui est déjà acquis. Le rabattement de l’avenir sur le futur élimine toute réelle nouveauté, toute possibilité d’avenir. L’histoire annihile l’eschatologie. » (2005, 241)
[29] Vassilis Kapsambelis est psychiatre, dont l’article Interpréter le délire : sens et contre-sens décrit bien en des termes qui correspondent à la dérive que nous examinons : « La suppression de l’objet et de sa réalité dans le monde interne correspond à une forme de déni qui ne touche pas tant les fonctions de reconnaissance ou de méconnaissance de l’objet, mais bien plutôt la fonction spécifique de connaissance de l’objet, c’est-à-dire cette fonction qui seule permet de concevoir l’objet, et par conséquent le monde extérieur, comme une entité séparée du sujet et indépendante de sa propre pensée et pulsionnalité. Car cette fonction de connaissance de l’objet, ainsi définie, est la fonction par excellence qui permet de passer de la monade à la dyade, et donc d’établir les lignes de démarcation entre moi et non-moi, monde interne et monde externe, excitation proprioceptive et excitation extéroceptive, etc. » (2013, 751)
[30] Michèle Bertand, professeur de psychopathologie clinique décrit fort bien cette mythomanie, faisant comme nous le lien avec la raison existentielle et ses dérives, dans son article : Imposteur, faussaire, menteur pathologique Mensonge pathologique et clivage du moi : une question d’identité : « L’aspiration à se faire soi-même, en vertu d’une liberté fondamentale, ne concerne pas la seule mythomanie. Elle a un caractère universel. Comme le rappelle F. Azouvi, évoquant Jaspers, qu’est-ce que la « vérité existentielle », sinon celle qui a pour critère, non la contrainte intellectuelle, mais le pouvoir de se faire par la liberté (Dufrenne, Ricœur, 1947, p. 195) ? Le mythomane « incarnerait, dans son acception pathologique, le vertige du pouvoir infini de choisir la vérité en choisissant son être (op. cit., p. 105). La liberté existentielle de se construire une identité peut être admise et reconnue. Mais ce qui n’existe pas, c’est le pouvoir infini de se faire par la liberté. La liberté existentielle est contrecarrée par les forces extérieures (celles de la nature, celles de la société), et aussi ce que Freud appelle l’anankê, le destin intérieur. Chacun de nous apprend à composer, par la force des choses, entre ce qu’il désire être, et ce qu’il peut devenir. Mais le mythomane est incapable de prendre en compte ce qui relève de telles limites. Toute sa quête est orientée par la nécessité d’acquérir une vérité qui serait un moi purement choisi. » (2015, 118)