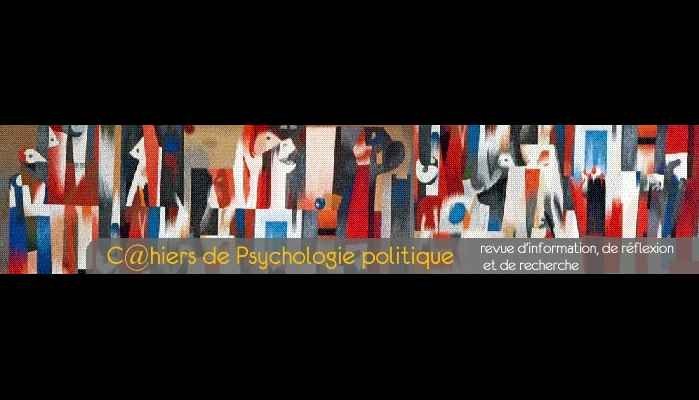Jure Georges Vujic, géopoliticien franco-croate, diplomate et directeur de l’Institut de géopolitique et de recherches stratégiques de Zagreb et chef du département de politologie de l’Association Matica Hrvatska. Diplomé de droit de l’Université de Paris II, diplômé de la Haute école de guerre des forces armées croates, chercheur associé de l’Académie de géopolitique de Paris et membre du conseil scientifique de la revue « Géostratégiques ». Il est l’auteur de plusieurs livres dans le domaine de la géopolitique et de la science politique parmi lesquels :
Fragments de la pensée géopolitique, ITG, Zagreb
La guerre des mondes-Eurasisme contre Atlantisme, Editions Minerve-Zagreb
La Croatie et la Méditerranée, aspects géopolitiques, Editions de l’Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères et des affaires européennes, Zagreb
La modernité face á l’image – Essai sur l’obsession visuelle de l’Occident, Ed. L’Harmattan Géopolitique du monde multipolaire- comprendre le monde au XXI siècle, Editions IGSI, Zagreb, La pensée radicale –Introduction á la phénoménologie de la radicalité politique, Editions Alpha
Les Convergences liberticides-essai sur les totalitarismes bienveillants, Ed. L’Harmattan
Le Géoconstructivisme – L'art de faire et de défaire les états, Editions Académie de géopolitique de Paris
Le moment post-communiste en Croatie-la grande parenthèse, Editions l’Harmattan
Vous venez de publier à l’Harmattan un ouvrage consacré aux convergences liberticides en y adjoignant un sous-titre évocateur : Essai sur les totalitarismes bienveillants. Vous participez de ce mouvement où de nombreux auteurs : politistes, sociologues, psychologues observent des tendances totalitaires au cœur même de nos sociétés démocratiques. Nous aimerions dans cet entretien approfondir plusieurs aspects que vous présentez dans cet ouvrage : la disparition de la vie intérieure, la soumission et l’obéissance, la psychiatrisation des opposants, l’instrumentalisation par le renoncement aux fins, l’addi(c)tocratie et la raison comme principe de mort.
Q.1. Le premier qui retient l’attention est celui de la disparition de la vie intérieure dont vous dîtes : « Ce qui détermine le mieux le totalitarisme, ce n’est pas seulement la manipulation mentale pour extorquer l’adhésion de l’individu ou des masses, mais un système qui cherche à priver l’homme de la vie intérieure et de la liberté conscience individuelle. » (p.28). Pouvez-vous préciser et illustrer cette première idée ?
Ce qui caractérisait dans le passé les totalitarismes de la modernité (communisme et nazisme), c’était la volonté, comme l’a si bien démontré Hannah Arendt, d’organiser et de domestiquer les masses, d’encadrer la vie publique et politique avec la domination d’un parti unique, mais aussi de régenter par l’endoctrinement idéologique la sphère privée de l’individu. C’est á ce titre que le concept de désolation dans sa signification Arendtienne (que les philosophes existentialistes allemands appellent stimmung) illustre très bien le sentiment des individus d’une radicale perte d’appartenance au monde, et cette impossibilité de projeter dans l’avenir.
Mais à la différence des systèmes totalitaires du passé qui s'appuyaient sur la terreur et la peur, les nouvelles formes de totalitarismes, dans les sociétés postmodernes contemporaines, s'ingèrent dans la sphère privée des individus, dans l'intimité de leur intérieur, grâce à l'omniprésence des médias, des réseaux sociaux et de l'impératif de l'information, d'une manière quasi-délétère, ludique et bienveillante. C'est le propre aussi du phénomène de déracinement évoqué par Simone Weil, consubstantielle à la modernité, qui avec l'atomisation de la société et l'individualisme, est selon elle : « de loin la plus dangereuse des maladies des sociétés humaines » . Il s'agirait ici bien entendu d'un déracinement au sens ou l'individu serait privé de son identité intérieure et intime, en tant qu'être humain singulier. On se souvient que, dans La France contre les robots, Georges Bernanos accuse la civilisation moderne d'être « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ».
Si l'ouvrage s'attaque en particulier au règne de la technique engendré par l'âge industriel, c'est bien la mentalité moderne dans son ensemble qui doit être intégrée, car la civilisation des machines n'a été rendue possible que par un long processus : philosophique, anthropologique et économique. Une réflexion similaire pourrait être pertinente dans le contexte de la postmodernité tardive ou du règne de la technopolitique, le numérisme triomphant a forgé un nouveau mental, un nouveau discours technofuturiste et libéral émancipateur, voire un nouvel imaginaire numérique. On parle d'ailleurs d'identité numérique. En effet, la condition essentielle de la dignité humaine, le respect du for intérieur de l'âme humaine est bafoué par les technologies numériques de plus en plus invasives, l'ingénierie sociale, le conditionnement médiatique, les stratégies de la politique de peur, la profusion informationnelle, et surtout á l'ère des réseaux sociaux et d'Internet les stratégies de captation et de détournement de l'attention. Constituant la partie la plus vulnérable et intime de l'être, l'âme aussi a des droits, et ces droits devraient être imprescriptibles.
En effet, la nouvelle société de traces numériques dans laquelle nous vivons rend possible l'oubli, la discrétion comme le viol du secret d'une vie intérieure. L'impossibilité de supprimer et de manipuler abusivement les traces numériques suscite aujourd'hui les plus grandes craintes. En effet, dans le monde du numérique, il n'existe plus de document principal et de copies, mais une constante fragmentation des contenus, dans laquelle l'information s'adapte à chaque condition de lecture et d'écriture. L'entité numérique collecte les traces qui laissent nos connexions : requêtes, téléchargements, géolocalisations, achats, mais aussi des contenus produits, copiés, récupérés. Tout cela a créé une forme fragmentée de notre identité numérique, dispersée à travers les réseaux. Les opérateurs, les détaillants, les moteurs de recherche et l'intelligence artificielle en savent plus sur notre comportement numérique que nous, car ils ont la capacité d'archiver, de faire des références croisées et de modéliser. Il n'y a pas si longtemps, le philosophe tchèque Jan Patocka, développait dans son livre L'Europe après l'Europe, la thèse selon laquelle nous vivions dans le monde de l'après Europe, que Patocka situe dès la fin de la Première Guerre Mondiale. Une Europe dévoyée spirituellement par la « mondialisation marchande » et « l’ère planétaire ». S'interrogeant sur l'héritage européen, Patocka constate avec raison que l'Europe a renié son identité originale et sa vocation première – celle du « soin de l'âme » – en reprenant ce thème socratique, le sacrifiant à l'adoption généralisée et démesurée du seul calcul de la puissance et les reliquats de sa suprématie déchue.
Q.2. Le deuxième aspect, en reprenant les propos de John Kenneth Galbraith dans Anatomie du pouvoir, vous dîtes que : « le pouvoir … processus de conditionnement et d’asservissement mental par la persuasion et l’éducation … qui permet de réaliser la soumission ou l’obéissance. » (p.47). En quoi cela caractérise-t-il un pouvoir totalitaire d’autres exercices du pouvoir dans lesquels, peu ou prou, se jouent bien des conditionnements par l’éducation par exemple ?
Les relations entre pouvoir et éducation ont toujours été complexes et parfois extrêmement tendus. Comme Kant le soulignait : « Il y a deux choses qu'on peut regarder comme étant tout ensemble les plus importantes et les plus difficiles pour l'humanité : l'art de gouverner les hommes, et celui de les élever ; et pourtant il conteste encore sur ces idées ». D'autre part, de nombreuses politiques éducatives et modèles de droite ou de gauche d'enseignements conservateurs, autoritaires, pédagogiques, libéral-permissifs, ont longtemps été mis en œuvre comme participant des politiques globales avec des idéologies sous-jacentes. L'éducation a toujours constitué une pierre de touche fondamentale pour construire une société, un monde répondant non pas uniquement à des considérations d'acquisition de savoirs, mais aussi à une volonté de façonner les jeunes générations jusqu’au formatage ou l'endoctrinement dans les systèmes totalitaires.
La sociologie et la pédagogie se sont abondamment penchées sur la problématique du sens de l'éducation avec John Dewey, Maria Montessori, Célestin Freinet, Pierre Bourdieu, Edgar Morin et bien d'autres. Le grand mérite de Galbraith a été celui de mettre en exergue l'importance du rôle de la persuasion et de l'éducation (enseignement) dans le maintien et la reproduction du pouvoir social et politique. On peut d'ailleurs rappeler que pour Locke, ou Helvétius, l'éducation est toute-puissante. En effet, de tout temps, l'idéologie s'est invitée dans la sphère éducative et plus particulièrement dans les systèmes totalitaires ou l'éducation, l'école et les universités servent à construire et reproduire l'homme nouveau, par un endoctrinement idéologique poussé. La persuasion joue un rôle essentiel dans le domaine politique, religieux, mais aussi dans l'éducation et dans les relations sociales. L'influence sociale s'exerce à travers la persuasion perçue en tant que pouvoir diffus, est aussi le moyen de contrôle social le plus indolore dont disposent les gouvernements et les individus, surtout lorsque ce pouvoir de persuasion est institutionnalisé dans le cadre d'un système éducatif. Bien sûr, de nos jours certaines professions se sont spécialisées dans les techniques de l’influence dans le domaine commercial, du marketing, des relations publiques. La persuasion d'autre part était au cœur de la propagande et à la base des études de relations publiques et de management. On se souvient que dans son livre Propaganda (1928), Edward Bernays expliquait que la mentalité collective n'est pas guidée par la pensée mais « par l'impulsion, l'habitude ou l'émotion ». Au-delà de la simple transmission des savoirs, l'éducation, l'école les institutions d'enseignement constituent des instances majeures de socialisation politique, le lieu où l'on inculque un certain système de valeurs, une vision du monde particulier, ou se forme et se transmettent un certain habitus social, mais aussi une forme de reproduction des inégalités sociales que Pierre Bourdieu avait développée dans Les héritiers. D'un autre côté, consécutivement à l’héritage idéologique libertaire et anti-autoritaire de Mai 68, la déconstruction et le progressisme à l'œuvre dans l'enseignement dans la plupart des pays occidentaux ont abouti à une crise, non seulement de l'autorité du corps enseignant, mais aussi à une crise plus profonde de la culture, avec un défaut de transmission générationnelle des savoirs et de valeurs.
Q.3. Vous développez l’idée que « nous assistons à la réduction de toute forme de peur à une pathologie phobique. » (p.122, 123, 124) avec ses peurs légitimes et maladives et vous concluez par ces mots : « On assiste à une véritable pathologisation de la vie politique et sociale, et c’est ainsi que l’ennemi politique désigné, le simple contradicteur critique qui échappe au moule de la pensée dominante, se voit suspecté d’une déviation phobique quelconque. Parallèlement à la psychiatrisation croissante de la société, cette phobo-stratégie d’exclusion qui diabolise les opinions différentes et singulières, que l’on suspecte de pathologie mentale, légitime en quelque sorte les méthodes thérapeutiques de rééducation, d’autocritique et d’isolement qui ne sont pas sans rappeler les méthodes psychiatriques du régime totalitaire stalinien. » (p.125) Comment expliquez-vous que ces méthodes puissent émerger dans des sociétés démocratiques ? Quels en sont les ressorts, les stratégies et l’existence d’une certaine passivité de ceux qui les subissent ?
Les stratégies et les politiques de peur sont au cœur du politique depuis la nuit des temps, et il suffit de se reférer aux grands classiques de la science politique pour le constater, depuis Hobbes, pour lequel gouverner c’est gouverner par la peur, Machiavel et l' Etat Léviathan mais aussi Foucault et bien d'autres. Jacques Attali, lors d'un entretien, expliquait que « l'histoire nous enseigne que l'humanité ne se développe de manière significative que lorsqu'elle a vraiment peur ». Le sociologue Frank Furedi, dans son ouvrage Politics of Fear, estime qu'il s'agit de politiques qui utilisent la peur collective de la population pour adopter des mesures qui réduisent les libertés individuelles. Basées en même temps sur la tradition politique de Hobbes, de telles politiques sont présentes dans les systèmes et régimes autoritaires et démocratiques. Le XXe siècle, avec l'équilibre de la terreur de la guerre froide et la menace de la destruction mutuelle effectue politisation de la peur.
En effet, Henry Louis Mencken, célèbre critique de la culture américaine, considérait que « le but de la politique est de garder la population inquiète et donc en demande d'être mise en sécurité, en la menaçant d'une série ininterrompue de monstres, tous étant imaginaires ». L'actualité contemporaine avec son cortège de catastrophes, la peur du terrorisme, des maladies, de tout genre, semble le confirmer. D'autre part, ce qui a changé dans le cadre des stratégies de phobocratie, c'est le rôle des médias contemporains et de l'information, et surtout le rôle de la transmission en temps réel, qui a bouleversé la rythmique des actualités et notre rapport à la peur, en élevant la peur comme le constate Paul Virilio au rang d'environnement global « puisqu'elle permet la synchronisation de l'émotion à l'échelle mondiale ».
Pour ce qui est de la passivité et de l'acceptation de mesures liberticides, nous sommes au cœur d'une forme de servitude volontaire suscitée par une contagion de la peur et une certaine crise de représentation, qui résulte d'un besoin et d'une demande de sécurité évidente en contrepartie de laquelle un certain nombre de libertés fondamentales sont consciemment reniées. Le climat fortement anxiogène dans lequel est plongé l'Occident avec l'expérience de la crise sanitaire de la COVID, la menace d'une guerre nucléaire et de l'escalade de la guerre russo-ukrainienne vers une nouvelle guerre mondiale, la menace des grandes catastrophes naturelles qui réactivent les grandes peurs en Occident. En effet, on se souvient des leçons de Jean Delumeau dans La Peur en Occident et de sa distinction entre l'angoisse et la peur, et l'on peut très bien établir un parallèle entre la société de l'angoisse du début des temps modernes, avec notre propre époque hautement anxiogène : peur de la crise économique et du chômage, crise écologique et effondrement des écosystèmes naturels, immigration et déclin occidental, terrorisme, décadence morale et sécularisation. Pourtant, même avant le SRAS, le coronavirus, l'homme occidental était déjà un angoissé atavique. Or, une société paralysée par l'angoisse se dissout nécessairement. L'émancipation consistera alors à nommer la cause de la crainte, afin de transformer l'angoisse en peur.
D'autre part, gouverner par la peur dans les démocraties présuppose aussi l'existence d'un environnement social en stress, un degré de stress quotidien et permanent dans la population, qui rend impossible la prise de distance critique, la réflexivité, le calme de la lucidité indispensables au discernement. Or, la dispense de stress est aujourd'hui, comme le relève Peter Sloterdijk dans son ouvrage Stress et liberté, l'un des leviers des médias contemporains, qui se chargent de la distribution quotidienne du stress, par une graduation dans la sélection des informations et messages. Les registres du stress social sont multiples : le stress pédagogique et politique, événementiel lié aux catastrophes et aux accidents, le stress victime-coupable qui conduit à la judiciarisation et la moralisation des débats. Les dispositifs de stress fonctionnent comme des stimuli mobilisateurs, permettant la reproduction de certaines représentations idéologiques, à la fois sociétales et politiques. Le plus souvent, il s'agit d'attiser ou d'entretenir une polarisation sociale ou politique donnée, en provoquant et distillant quotidiennement, en temps réel, de nouveaux sujets d'hypersensibilisation, d'émotivité, d'envie, de rivalités, soit une offre de stress orientée vers le ressenti et la peur.
Dans ce large panel d'offres médiatiques et de produits stressants, on assiste, dans la sphère médiatique, à une sorte de gradation dans les priorités des contenus anxiogènes. Cet environnement neurotique de stress continu correspond très bien au modèle de la disruption, qui, sur le plan économique, signifie une perturbation du marché dans lequel des positions sont déjà établies, grâce à l'innovation et à de nouvelles stratégies, modèle qui a été transposé dans la sphère de la gouvernance politique. De nouvelles entreprises bien connues, telles que Tesla, Uber, Airbnb, SnappCarr, Nextdoor, Waze, Spotify, Picnic, HelloFresh, Zalando, Booking.com, Virgin et Amazon ont introduit des bouleversements dans de nombreux secteurs économiques de service. Cependant, on constate que parallèlement, la perturbation perturbe les mécanismes subtils, des liens de socialisation et de convivialité, du vivre ensemble. En plus de la dimension économique et technologique, ce phénomène de disruption a également un effet profond sur la perception collective et individuelle du monde, les représentations sociales et la construction de la réalité sociale. Ainsi, pour l'économiste Bertrand Stiegler, la disruption est une innovation accélérée implacable qui est aussi une forme de « barbarie douce » avec son cortège de stratégies de stress déstructurantes et de névroses sociales contagieuses, évoquées aussi par Jean Pierre le Goff, qui perturbent les longs et subtils processus de socialisation.
Q.4. Vous abordez un quatrième aspect très intéressant concernant la disparition des fins dont vous dîtes : « Parce que la politique technocratique moderne néglige et supprime la question du « pourquoi » et des buts ultimes, approuvant exclusivement la question des méthodes et des moyens, on peut dire qu’elle est une forme de despotisme technocratique. » (p.127). Comment expliquer que le politique qui ne cesse de débattre de réformes sociétales fondamentales pour l’avenir soit en même temps dans une sorte de scientisme technocratique que vous décrivez ? N’y a-t-il pas un paradoxe entre ces combats sociétaux et cette pratique technocratique ?
Retracer le chemin de l’émancipation, de la déliaison du politique par rapport au buts ultimes (telos) serait extrêmement long. Les experts ont toujours existé ; cependant, tout au long de l’histoire, leur statut social et leur place dans la société ont changé en fonction de la vision du monde politique et social dominante. La notion d’expertise est étroitement liée à l’émergence de la modernité et à la complexité croissante des relations sociales et du fonctionnement économique de la société. Le discours légitimant en faveur de l’expertise, qui adhère au principe général de la gouvernance technocratique au niveau de la « gouvernance mondiale », est que la complexité des défis de la mondialisation libérale impose aux acteurs politiques de transférer leur pouvoir de décision à la société civile et aux autres acteurs non étatiques du marché, étant donné que seuls les professionnels possédant des compétences spécifiques peuvent obtenir des résultats optimaux. Dans ce contexte, le cœur du problème de la technocratie et de l’expertocratie est dans leur incompatibilité avec les principes fondamentaux de la démocratie, puisqu’ils ne détiennent aucune légitimité populaire et représentative issue des élections.
Les racines philosophiques de l’expertocratie, tout comme celles de la technocratie, se retrouvent dans le constructivisme mécaniciste des Lumières puis chez les socialistes utopiques du XIXe siècle comme dans l’idéologie du saint-simonisme. Les thèses saint-simoniennes trouveront plus tard un terrain fertile dans la gestion et la technocratisation graduelle de la politique décrites par James Burnham dans La Révolution managériale. La notion d’expertise, née en Grande-Bretagne au XVIe siècle à travers les figures d’experts médiateurs, entre progressivement dans la sphère scientifique à travers les sciences sociales contemporaines dans le cadre des études scientifiques et technologiques qui analysent les relations entre technologie et pouvoir. La technocratisation du politique est en même temps un processus de dés-essentialisation de l’activité politique. Les politiciens se désengagent de plus en plus des questions délicates et complexes, transférant la responsabilité aux experts qui ne sont pas seulement là pour des conseils, mais aussi pour formater idéologiquement l’opinion publique. Il ne faut pas oublier qu’aucune science n’est totalement neutre et qu’elle est elle-même le fruit d’un processus idéologique complexe. Transférer la responsabilité de la sphère politique publique aux experts revient à dépolitiser la politique, ce qui s’apparente à un déni du politique. Depuis Aristote et Platon, l’homme s’interroge sur la place et le pouvoir de la politique dans la société. Aujourd’hui, la confusion des rôles et des fonctions est favorisée comme dans de nombreux autres segments sociaux, et l’action publique et politique est soumise au paradigme du « solutionnisme », au répertoire technique, ce qui signifie que la prise de décision politique est réduite au niveau du choix d’une solution particulière.
Dans ce contexte, « le gouvernement des choses remplace le gouvernement des hommes » : l’expertise est en fait le reflet de notre époque moderne où l’expert autonomise et s’approprie de plus en plus la fonction politique en fragmentant notre environnement social en domaines de spécialisation technocentrique. Avec la révolution numérique et l’intelligence artificielle, nous sommes entrés dans une nouvelle phase du capitalisme technopolitique qui est á l’œuvre et qui utilise la technologie pour instrumentaliser l’individu. Le rapport du capitalisme avec le désir humain n’est plus seulement de l’ordre de la répression par la domination ; il est désormais marqué par l’optimisation via l’usage de la technologie. Le pouvoir est au cœur des interactions qui sont de plus en plus intermédiées par le numérique. En effet, le développement croisé des algorithmes et des sciences cognitives a donné aux grandes entreprises une capacité inédite d’influence psychologique sur les individus. Il ne se contente plus seulement de satisfaire les désirs des individus, il les oriente et les renforce sur le fondement de recherches scientifiques. Dans cette nouvelle configuration, le pouvoir change de nature : le pouvoir instrumentarien s’impose. Ce dernier contraste avec le pouvoir financier : « le pouvoir était autrefois identifié à la possession des moyens de production. Il est maintenant identifié à la possession des moyens de modifications des comportements. »
Il convient de rappeler que la crise multidimensionnelle du Covid-19, qui a agi en tant que Game changer, a fonctionné comme un moteur disruptif d’une nouvelle politique post-libérale. En effet, on peut constater qu'après cette crise sanitaire, de nombreux régimes administratifs et juridiques d'exception sont devenues la norme. Giorgio Agamben parle de la nouvelle condition humaine et de la « vie nue » (homo sacer), laquelle a marqué l’entrée dans l’ère de l’anthropocène : ce moment où l’humanité s’est érigée en force géologique qui a transformé irréversiblement son cadre de vie. Il s’agit d’une rupture totale entre les vies politiques et biologiques de l’individu, et l’homo sacer, dans sa nouvelle condition biologique, se trouve soumis à la souveraineté de l’état d’exception. A cet égard, la pandémie a permis l’activation d'une gouvernance bio-politique et algorithmique, permettant la mise en place de stratégies de choc, dans la lignée des thèses de Schumpeter sur la « destruction créatrice », Ainsi, les transformations successives du libéralisme au cours des quarante dernières années cèdent aujourd’hui la place à ce post-libéralisme, en tant que nouvelle forme de gouvernement de transition, qui fait de l’économie un moyen de transformation anthropologique et transhumaniste de l’espèce humaine dans le cadre d’un nouvel « environnement hostile » planétaire.
En ce sens, l’analyse proposée par Barbara Stiegler dans : Il faut s’adapter, à partir des travaux de Walter Lippmann, connu pour sa thèse sur la « fabrique du consentement », démontre que le but du post-libéralisme n’est pas seulement de nature économique, mais aussi anthropologique. Il s’inscrit dans la filiation évolutionniste et constructiviste d’inspiration darwinienne, de l’espèce humaine, tandis que Walter Lippmann y ajoute un objectif politique : organiser massivement l’adaptation de l’espèce humaine au nouvel état du monde, imposé par la mondialisation du marché.
Q.5. Vous consacrez une partie à l’addiction sous toutes ses formes et y voyez la trace d’une société totalitaire. Vous écrivez par exemple que « cette pathologie collective du consommateur transforme progressivement le citoyen-consommateur en consommateur-toxicomane. » (p. 139) Une politique de l’addiction, une économie et des technologies de l’addiction sont-elles durables selon vous, générations après générations, et par comparaison à des sociétés qui échapperaient à cet abêtissement généralisé ?
Afin d’illustrer ce phénomène d’addiction surtout chez les jeunes générations, il n’y a qu’à se reporter aux statistiques sur ce qu’on appelle aujourd’hui le temps écran. Dans une société de l’hyperconnexion, une grande part de notre quotidien est connecté, via différents supports numériques : tablette, ordinateur, smartphone, télévision, consoles de jeux. Selon des études scientifiques, l’addiction de la jeune génération entraînerait une hausse des cas de dépression et d'anxiété. Ce taux de mal-être psychologique a augmenté de manière conséquente depuis quelques années, soit depuis l'introduction des smartphones sur le marché, et du développement de Facebook. La dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux et de l’internet est avérée chez les plus jeunes générations. Le temps passé sur une vidéo permet à la plateforme de détourner l’attention et de capter les envies via un algorithme, créant un cercle vicieux.
Selon, Jean Twenge, une psychologue américaine, les membres de la génération Z (nés entre 1995 et 2015) risquent de développer des troubles psychologiques et sociaux à cause de l’usage excessif des smartphones et des réseaux sociaux. Selon la chercheuse, ces changements s’expliquent en grande partie par l’omniprésence du smartphone dans leur vie. Aux États-Unis, 90 % des 12-17 ans en possèdent un. En France, c’est le cas de 80 % des 13-19 ans, qui passent en moyenne deux heures par jour sur Internet (et près d’une heure pour les 7-12 ans). L'industrie de la consommation n'épargne rien dans ce processus d'aliénation spirituelle, mentale et physique : études de consommateurs quantitatives et de qualité, analyse comportementale sociale, campagnes de communication et marketing expérimentales, neuro-marketing et analyse de l'effet cérébral généré par l'exposition publicitaire (IMRF) - par résonance magnétique fonctionnelle, font partie de l'arsenal pour ces machines de traitement de la dépendance. En 2011, Brian Knutson, un scientifique européen de l'Université de Stanford aux États-Unis, a prouvé qu'aujourd'hui, il est possible de prédire le choix d'achat d’une personne en activant les canaux neuronaux. Cette pathologie collective du consommateur transforme progressivement le citoyen-consommateur en consommateur-toxicomane.
En effet, le consommateur moyen d’aujourd’hui est en permanence insatisfait et toujours à la recherche de la dose requise. Son marchand de consommation est devenu à la fois un martyr et un sauveur. La dépendance transcende le domaine alimentaire pour manipuler le politique, le social et la culture. Facebook, Whatsapp, Snapchat, Twitter, Viber, Google, Amazon et Apple, le labyrinthe des réseaux sociaux, tous sont là : ces virus technomorphes quotidiens, pour nous solliciter, détourner, capter l’attention, dans un ordre souvent cacophonique et synchronique. Notre attention est le plus souvent extorquée et orientée vers des offres, voire des demandes pseudo-communicationnelles, ludiques et consuméristes, le tout paqueté dans un langage relationnel, interactionnel et prétendument créatif. Tel est bien l’enjeu de cette nouvelle économie de l’attention, dont le sociologue Gabriel Tarde rendait compte déjà au début du XXe siècle et dont Herbert Simon traçait des contours précis, dans le cadre contemporain de l’abondance d’information qui créait une rareté de l’attention. En effet, la surproduction du marché nécessite des formes de publicités qui puissent « arrêter l’attention, la fixer sur la chose offerte ». Bien sûr, ce phénomène ne date pas d’hier, et les stratégies publicitaires, le marketing des marques cherchaient à capter l’attention du consommateur sur tel ou tel produit, mais ce qui est nouveau aujourd’hui, avec l’explosion des applications internet et smartphone, c’est que l’attention est devenue une denrée rare, une ressource captable, une nouvelle monnaie qu’il est loisible de capitaliser et de stocker.
Q.6. Vous citez de très nombreux auteurs dont à plusieurs reprises Jean Vioulac décrivant le processus de totalisation du monde et du rôle de la science moderne. Que retenez-vous de cet auteur concluant que le principe de raison est un principe de mort avec un ouvrage marquant : Métaphysique de l’anthropocène : raison et destruction ? Que vous inspire-t-il ?
Oui, Jean Vioulac a le grand mérite de mettre l’accent sur la dimension métaphysique et anthropologique des grands bouleversements technopolitiques et scientifiques du XXIème siècle. La prétention messianique et quasi sotériologique du scientisme et du solutionnisme technologique de nos jours est l’un des avatars de ce processus de totalisation du monde, dont l’un des leviers est constitué par la convergence bio-numérique qui est au cœur de la 4ème révolution numérique, avec le fusionnement des technologies numériques et les systèmes biologiques. En effet, il s’agit d’un phénomène qui constitue une véritable révolution anthropologique qui bouleversera en profondeur notre rapport au monde, à l’humain, à la société et à notre corps. Il s’agit, en effet d’une triple révolution des sciences et technologies numériques, physiques et biologiques débouchant sur l’intelligence artificielle, la robotique, le Big data et son exploitation, ainsi que les biotechnologies avec, en toile de fond, la perspective transhumaniste. Cette mutation, qui se doit d’être pensée en termes de crise civilisationnelle et anthropologique, recèle en elle, un désir faustien et dystopique, de façonner et d’adapter le monde à une autre réalité artificielle, et c’est ce qui constitue bien une tentation éminemment totalitaire et totalisante.