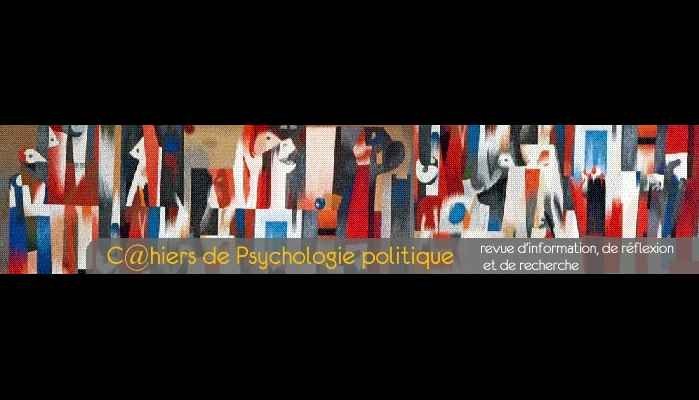Accéder à la norme ?
La norme n'est pas innée. Au contraire, elle est l'aboutissement d'un cheminement qui part de l'enfant pour aboutir à son dépassement dans la maturité psychologique. Une étape décisive se produit quand l'enfant, après s'être écarté de celui ou celle qui l'a fait advenir à la parole, quitte la situation fusionnelle avec cette personne pour comprendre qu'avec elle il fait partie d'un ensemble plus vaste incluant, au moins une autre personne, celle que Freud nomme le tiers, la Dritte Person.
Si cette inclusion n'a pas lieu, l'infans reste dans le fusionnel avec la faille psychique qui en est la conséquence. Il faut donc que l'enfant accède à cet espace psychique, indispensable pour devenir responsable dans ses actes et dans sa parole. Le passage est constaté par la société qui le nomme âge de raison.
Ce temps est ponctué par une nomination solennelle, faite dans un après-coup social, comme si on voulait s'assurer de la stabilité de cette acquisition, de cet équilibre nouveau pour entrer dans le monde des adultes. L'enfant, devenu adolescent, porte dès lors l'amorce d'un jugement sur sa vie et sur ceux qui le font exister. Dans toutes les cultures, c'est l'âge des premières démarches religieuses et des premières initiations.
Cette stabilité du sujet est celle qui tient la société. Elle est le fondement de ce que décrit Pierre Rosanvallon sous le nom "Les institutions invisibles" dans son nouvel essai édité au Seuil. Les Institutions invisibles reposent sur "trois composantes : la confiance, l'autorité et la légitimité." Il faut remarquer que ces composantes se développent progressivement, s'articulant l'une à l'autre. Chacune nécessite que les deux autres s'épanouissent simultanément.
Ainsi, dans leur rapport à l'autre dans la parole, elles fondent l'altérité et donc le lien social. C'est la spécificité du sujet humain d'être construit par l'effet du langage. II y a un saut dans le passage du Un au Trois. Le Un est le temps de la fusion en l'autre, temps de l'éprouvé exclusif. Le temps du Trois est celui de l'épanouissement des trois composantes décrites par Rosanvallon.
Le Trois impose un écart qui différencie. Temps intuitivement conceptualisé dans la Trinité divine, dans ce triptyque que construit P.Rosanvallon et dans l'espace trinitaire où se déploie l'inconscient. On le retrouve dans les créations sociales décrites par Montesquieu et Georges Dumézil. L'humain pense son espace de pensée et de vie, individuellement et collectivement, dans un cadre généré par le Trois, structurant l'inconscient. Il s'illusionne en se référant au Un idéal que promeut le monothéisme
Montesquieu ou Dumézil ont su comprendre que la société est construite sur une articulation entre trois termes qui ne doivent pas fusionner, le législatif, le judiciaire et l'exécutif pour l'un, le prêtre, le soldat et le producteur pour l'autre.
Ces trois composantes du pouvoir sur la scène sociale n'ont de force que séparées et différenciées. Dumézil nomme ces trois composantes la trifonctionnalité. Lacan en fait le constat en s'attachant à leur nouage qu'il qualifie de "borroméen". En dénouer une seule, c'est en même temps dénouer les deux autres. À contrario, si une seule composante fusionne avec l'une des deux autres, c'est l'ensemble qui perd son identité. Ainsi, dans la représentation que Montesquieu fait du pouvoir, la fusion du législatif avec le judiciaire devient l'arbitraire ou la tyrannie.
L'enfant élabore la confiance, dès la prime enfance, sous la forme d'une foi dans ceux qui veillent sur sa sécurité et son bien-être. Cette disposition, une fois établie, s’étend ensuite aux autres humains et à la société où il vit. A l'inverse, quand la défiance prédomine, la confiance absente, voire déçue, est reproduite sous la forme d'une relation négative. La méfiance, la persécution et le complotisme en sont les manifestations politiques, la sensibilité paranoïaque, l'expression individuelle.
La soumission à l'autorité se construit dans les pas de la mise en place du Surmoi. Elle exige la confiance. Établie dans la défiance, la soumission fait le lit de la rébellion. Un trait de révolte persiste et devient un trait de caractère ancré dans le narcissisme.
La légitimité impose une acceptation de la réalité, car elle est la continuité du cadre établi par les parents de l'enfant. Les jeunes enfants sont foncièrement conservateurs. Ce trait persiste ou s'aggrave quand ils deviennent des adultes. Le changement nécessaire impose donc de fixer l'attention sociale sur la permanence du cadre pour le faire évoluer de l'intérieur et non pas de le transformer brusquement par une identification à un mouvement colérique.
Ces trois jalons sont structuraux d'une prévention politique car ils sont le reflet et l'expression d'une organisation spécifique de l'humain. Montesquieu en avait l'intuition. Freud avait anticipé ce déploiement du Trois quand il écrivait que l'homme ne peut créer que ce qui préexiste dans son psychisme. Lacan a découvert qu'il le doit à l'expansion de la langue en lui.
Retrouver dans les productions humaines, la structure même du langage est donc logique. Il faut dès lors dévoiler ce qui est masqué par le refoulement et sa production, l'idéologie, qui s'est construite sur le Un.
Une première avancée dans l'idéologie s'est manifestée dans l'invention du Monothéisme. Dans la confrontation à la multiplicité des dieux, un seul a trouvé un écho chez des humains. Cette invention devenait nécessaire par contraste avec une forme de blocage de la société prise dans la répétition, pendant des siècles, des mêmes schémas de pensée, d'abord chez les Égyptiens de l'Ancien Empire, puis du Nouvel Empire. En revanche, dans l'Antiquité grecque, on peut reconstruire la filiation qui, depuis Platon, laisse la place au Christianisme.
Saint Augustin écrit en 416 le De trinitate. Cette mise en avant de la Trinité comme représentation divine est en rupture avec les représentations figuratives. Elle échappe à la figuration et est comme une épure du processus qui a conduit à la pensée. On comprend que cette évolution vers l'abstraction de la divinité devenue un principe de pensée ait suscité des courants d'opposition que l'on dirait aujourd'hui populistes.
De même, on peut constater que l'Islam ne pouvait que supprimer ces points de difficultés dans sa simplification du monothéisme pour pouvoir gagner l'adhésion de la planète entière. On assiste à un paradoxe qui ne peut se comprendre que par l'action du refoulement : la psyché est formée par une tripartition qui se constate dans les œuvres humaines nées de la pensée individuelle et collective, donc de la civilisation. Celle-ci se revendique inspirée par l'unité indivisible où chaque humain reconnait l'harmonie et le bien-être qui furent les siens quand il était porté par sa mère. Le bonheur illusoire du paradis perdu persiste chez tous les humains. Il devient l'aspiration à l'Unique du monothéisme. Lacan qualifie la religion chrétienne de "vraie" car elle assume cette division entre la Trinité, divine et tripartite, et l'unité monothéiste.
Il ne peut donc exister une norme qui s'imposerait à l'humain. Elle ne peut être que le résultat d'une tension entre le besoin d'une identification au Un de tous et la tension interne, liée à la nature même de l'inconscient tripartite, qui ne peut laisser toute la place à l'Imaginaire.
La norme devient ainsi une oscillation, un compromis inconscient dont le sujet doit s'émanciper. Sa construction est bien en référence à une masse, au sens de Freud. Une masse a besoin pour sa consistance de traits communs d'identification. Le Un, l'Unique, est alors partagé avec les autres par la parole échangée, formée et née de l'espace du Trois.
L'espace tripartite est celui qui est radicalement étranger à l'espace du « Un » parce que la place d'un vide, d'une absence est nécessaire pour une différenciation entre ses trois composants. Il est curieux de constater que la théologie de la Sainte-Trinité soit une illustration des propriétés mathématiques de l'espace du Trois. Chacun de ses éléments a les caractéristiques des deux autres mais ne peut se substituer à eux, puisqu'ils ne sont pas dans un ordre de succession temporelle ou de hiérarchie mais dans un rapport de proximité, de voisinage. Ils sont nécessaires entre eux bien que non substituables l'un par l'autre. Cette articulation logique constitue ce que la psychanalyse nomme l'énigme de l'inconscient et la théologie du Concile de Nicée, un mystère.
Lacan propose de nommer ces trois composants le Réel, le Symbolique et l'Imaginaire. Leur articulation au signifiant permet de construire les trois figures cliniques du discours où s'inscrit l'humain. Le vide intrinsèque, que Lacan nomme a, produit un quatrième discours, celui de l'analyste, qui n'est ni celui d'un Maître, ni l'énonciation d'un savoir constitué, ni une expression du corps. Il s'apparente à l'invention de l'artiste qui, de son existence, crée. Comme lui, dans sa pratique, le psychanalyste ne peut qu'être hors norme.